



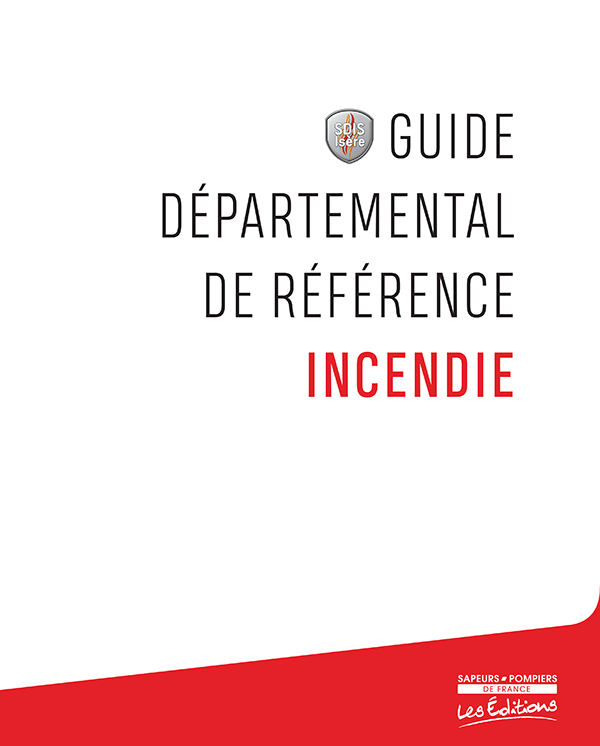
Guide Incendie
ÉDITORIAL
La doctrine opérationnelle relève de la compétence de l'État, en application de l'article L112-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette doctrine est édictée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) à travers la parution des différents guides de doctrines (GDO) et des guides de techniques opérationnelles (GTO).
Le « Guide opérationnel » du SDIS de l'Isère constitue le socle de la doctrine opérationnelle départementale iséroise.
Il est complété par les guides départementaux de référence (GDR) qui ont vocation à être les recueils des connaissances théoriques, pratiques et techniques applicables au sein du SDIS de l'Isère dans un souci d'uniformisation et de cohérence de la réponse opérationnelle.
Si les interventions liées aux incendies ne représentent que 9 % de l'activité opérationnelle, ces dernières demandent une technicité de plus en plus importante et sont de la compétence exclusive des services d'incendie et de secours.
Articulé en plusieurs chapitres reprenant la marche générale des opérations, constitué de fiches savoirs, techniques et matériels, ce document a été réalisé par un groupe de travail « incendie » constitué d'agents issus du pool des instructeurs incendie, des groupements Équipement, Prévision, Formation-sport et Opérations.
Révisable chaque année, un comité de suivi le fera évoluer en fonction des avancées de la doctrine nationale et des retours d'expérience.
Prenons le temps de le lire, de l'approfondir et de se l'approprier, pour maintenir une qualité de service à la hauteur des enjeux liés à la lutte contre les incendies.
Contrôleur général André Benkemoun
Directeur départemental du SDIS de l'Isère
FS 1 PG
GÉNÉRALITÉS SUR LES INCENDIES
GDO Interventions sur les incendies de structures
C'est une réaction chimique exothermique entre deux corps dont l'un est appelé combustible et l'autre comburant. Cette réaction ne peut avoir lieu qu'en présence d'une quantité suffisante et nécessaire de chaleur et sous l'effet d'une énergie d'activation, à une température donnée et produisant des produits de combustion.
C'est la manifestation visible de la combustion sous le contrôle de l'homme.
C'est une combustion qui se développe de manière incontrôlée dans le temps et l'espace.
Pour que la combustion se produise il faut rassembler les trois éléments de base.
C'est un corps susceptible de brûler et qui se présente initialement sous trois états (solide, liquide, gazeux). Solide : bois, papier, PVC, autres composés organiques et chimiques. Liquide : essence, pétrole, alcool, acétone… Gazeux : propane, méthane, butane, GPL…
C'est un composé chimique, qui en présence d'un combustible, permet et entretient la combustion. Le comburant le plus rencontré est l'oxygène contenu dans l'air.
C'est l'énergie permettant l'élévation de température afin d'atteindre le point d'inflammation. Elle peut être d'origine mécanique, électrique, calorifique ou chimique.
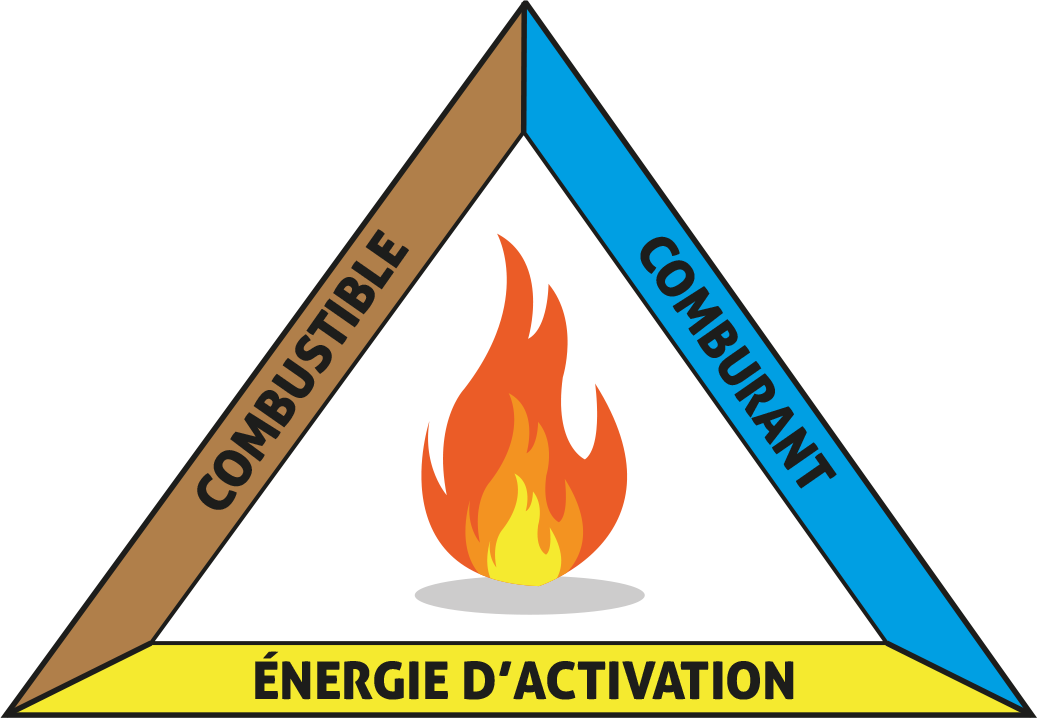
Lors de la combustion (réaction chimique), de nombreux éléments sont véhiculés par les fumées. Ces dernières sont composées de produits de combustion (CO, CO2, suies, particules etc.) ; de gaz de pyrolyse et d'autres produits chimiques inflammables (en fonction de la nature des matériaux).
Les fumées présentent 5 dangers résumés par les moyens mnémotechniques COMIX ou ROTIE :
Chaudes
Opaques
Mobiles
Inflammables ou explosives
ToXiques
Rayonnantes
Opaques
Toxiques
Inflammables ou explosives
Envahissantes
Deux types de flamme peuvent se produire lors d'une combustion :
- La flamme de diffusion : lorsque le combustible et le comburant ne sont pas mélangés avant la mise à feu. C'est le cas par exemple de la flamme d'une bougie.
- La flamme de prémélange : lorsque le combustible et le comburant sont déjà mélangés lorsque ils arrivent au niveau de la flamme. C'est le cas par exemple de la flamme du chalumeau.
| Réactifs / Type d'écoulement | Laminaire | Turbulente |
| Flamme de prémélange |  |
 |
| Flamme de diffusion | 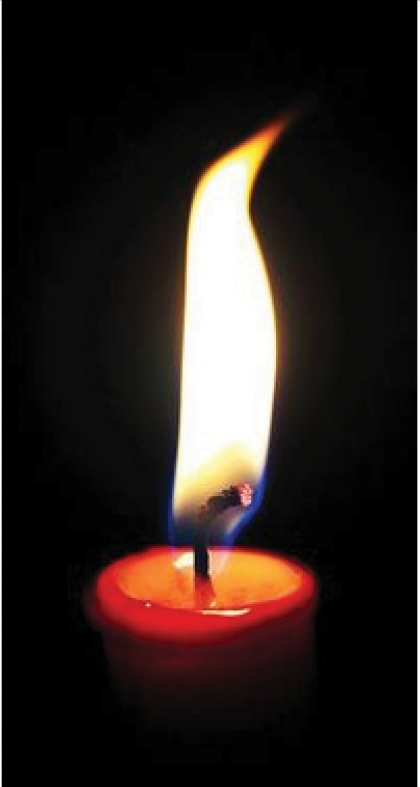 |
 |
| Classes de feux | Combustibles | Illustrations |
| Feux de classe A | Combustibles solides : charbon, bois, carton, papier, tissus, certains plastiques, matières organiques |
 |
| Feux de classe B | Combustibles liquides : essence, white-spirit, kérosène, pétrole, fuel, éther, acétone, dissolvants, dégraissants, alcools À cette liste, on ajoute les produits liquéfiables : graisse, beurre, cirage, encaustique, sucre, caoutchouc, certains plastiques |
 |
| Feux de classe C | Combustibles gazeux : gaz de ville, butane, propane, méthane, acétylène |
 |
| Feux de classe D | Métaux : magnésium, aluminium, sodium, potassium, baryum, lithium |
 |
| Feux de classe F | Auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson |
 |
En fonction de l'alimentation du feu en comburant, la combustion est :
- complète : si le foyer est correctement alimenté en oxygène grâce à un apport d'air suffisant ; les produits de combustion sont alors complètement brûlés. La flamme est souvent de couleur bleue ;
- incomplète : si le renouvellement d'air est insuffisant, les flammes sont oranges, très éclairantes, et les produits de combustion sont incomplètement brûlés d'où la production importante de fumée et de monoxyde de carbone (CO).
Ils se définissent pas leur vitesse de propagation.
- La combustion lente : par exemple l'oxydation (rouille), la fermentation (végétaux), la respiration cellulaire.
- La combustion vive : lorsqu'il y a émission de lumière (incandescence), chaleur, sans changement de pression.
- La combustion très vive ou déflagrante : phénomène d'explosion avec une propagation inférieure à la vitesse du son (340 m/s) et une pression de 2 à 3 bars.
- La combustion instantanée ou détonation : phénomène d'explosion avec une propagation supérieure à la vitesse du son 340 m/s et une pression de 20 à 30 bars.
Sans flamme (feu couvant) |
Avec flamme (vive) |
||
| Combustion lente (feu couvant) |
Combustion rapide (vive) |
Combustion très rapide (déflagration) |
Combustion instantanée (détonation) |
Flamme |
Explosion |
Explosion |
|
| Quelques heures à quelques jours Ex : braise d'un feu de bois |
Quelques minutes à quelques heures Ex : incendie |
Vitesse du front de flamme< vitesse du son Ex : flamme de chalumeau |
Vitesse du front de flamme> vitesse du son Ex : bombe |
| Combustion lente | Flamme de diffusion | Flamme de prémélange déflagrante Flamme de prémélange détonante |
|
- Point éclair : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote, la combustion s'arrête si l'on retire cette flamme.
- Point d'inflammation : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote, la combustion continue d'elle-même si l'on retire cette flamme.
- Point d'auto inflammation : température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme spontanément.
Il existe 3 familles :
- les embrasements généralisés éclairs (EGE) (cf. FS6 PG) ;
- les explosions de fumées (EF) (cf. FS7 PG) ;
- les inflammations ou explosions de gaz (Fire Gas Ignition - FGI) (cf. FS8 PG).
Les phénomènes, potentiellement dangereux, peuvent se présenter lors de différentes phases de l'incendie et intéresser plusieurs zones adjacentes au sein d'un même bâtiment.
Quantité maximale de chaleur que peut dégager l'unité de masse ou de volume pour une combustion entière de la dite matière.
(ex. 1 kg de bois a un pouvoir calorifique de 19 MJ/kg).
Quelques exemples ci-dessous :
| Combustible | Pouvoir calorifique en MJ/kg |
| Bois | 16 à 19 |
| Hydrogène | 121 |
| Pneus | 32 |
Quantité totale de chaleur que peuvent dégager l'ensemble des combustibles présents dans un espace déterminé.
(ex. 10 kg de bois = 10 x 19 = 190 MJ).
Charge calorifique rapportée à la surface au sol de l'espace considéré.
(ex. 10 kg de bois brûlent dans une pièce de 20 m², le potentiel sera de (10 x 19) / 20 = 9 MJ/m²). Utilisé essentiellement dans le cadre de la prévention.
Quelques potentiels indicatifs :
| Pièce, bâtiment, activité | Potentiel calorifique en MJ/m² |
| Chambre | 570 |
| Bibliothèque | 1 500 |
| Cuisine | 310 |
| Centre commercial | 600 |
Décomposition chimique irréversible d'un matériau produite par une élévation de température de celui-ci.
FS 2 PG
LES COMPOSANTS DU SYSTÈME FEU
GDO Interventions sur les incendies de structures
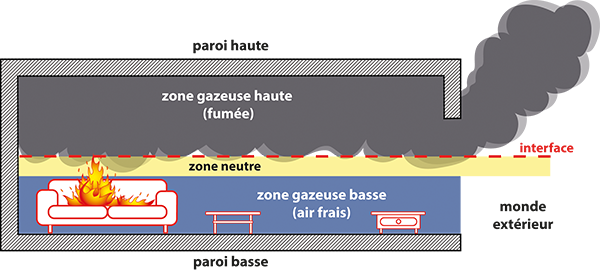
Le système feu est un système dynamique composé de mouvements gazeux.
Zone gazeuse basse : l'air frais se déplace de l'extérieur du local vers la base du feu.
Zone gazeuse haute : les gaz chauds sont évacués du local vers l'extérieur.
La zone de contact entre ces 2 zones s'appelle l'interface. Sous cette interface se trouve la zone neutre (quelquefois non visible) dans laquelle la pression est identique à l'intérieur comme à l'extérieur du volume (pression atmosphérique).
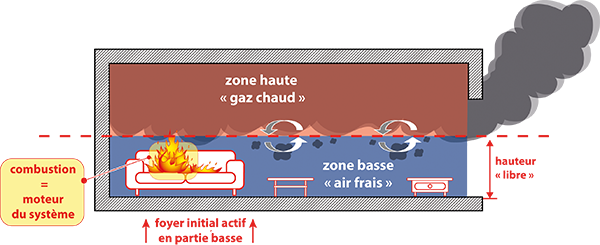
Cette représentation en deux zones permet de modéliser un feu dans un local avec un seul foyer localisé en partie basse. Il s'agit généralement de la phase de croissance du feu.
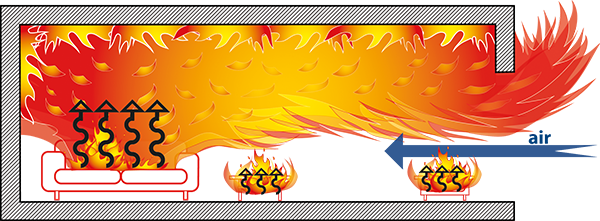
Cette représentation en une zone permet de modéliser un feu totalement développé dans un local.
FS 3 PG
LE DÉVELOPPEMENT DU FEU
Références : GDO Incendies de structures
La courbe classique d'évolution de la puissance d'un incendie dans un local ventilé est représentée dans la figure ci-après.
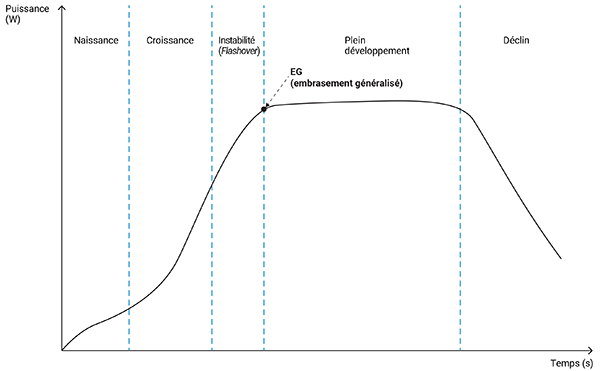
Cette phase initiale de la combustion est directement liée à la quantité de combustible. À ce stade le dégagement de chaleur est modéré et les fumées sont peu abondantes.
Seul le combustible influe sur le développement du feu. On dit que le feu est « limité par le combustible ».
À cette étape, le volume de la pièce dans laquelle se développe le sinistre n'a pas d'influence sur le comportement du feu.
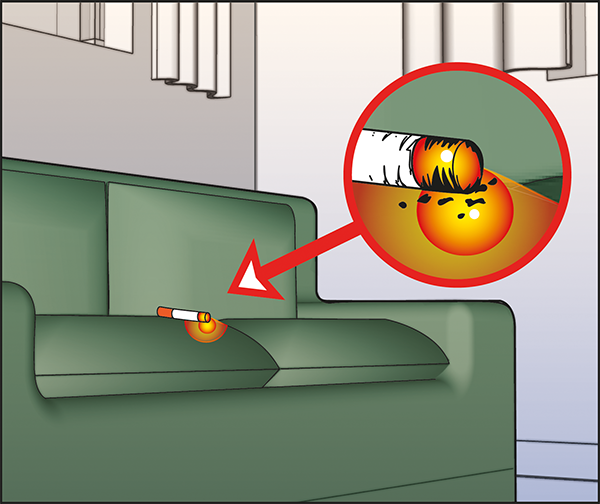
Au cours de cette phase, l'évolution du feu varie en fonction des éléments suivants :
- Conditions de ventilation ;
- Nature et état de dégradation des matières ;
- Autres facteurs (caractéristiques bâtimentaires, pièce concernée, situation du foyer…).
Les conditions de ventilation du sinistre conditionnent la poursuite du développement du feu.
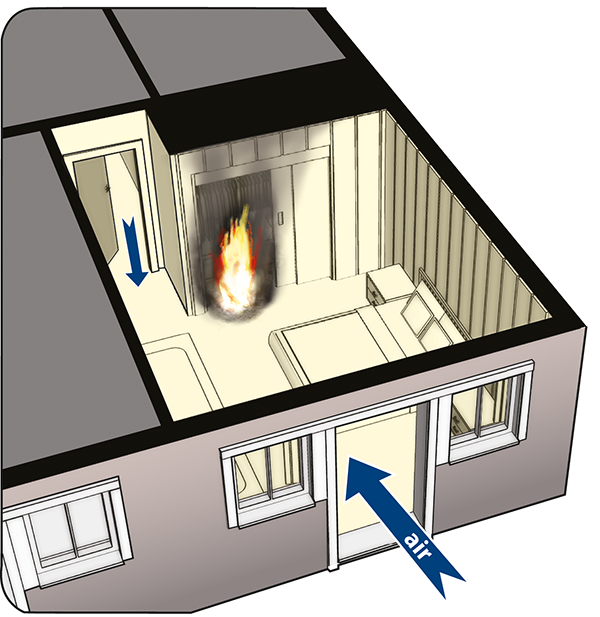
Pendant cette phase instable, le feu continue à se développer si l'apport en air au foyer est suffisant.
La puissance du sinistre augmente et s'accompagne d'élévation de température et de production importante de fumées. Le débit de gaz de pyrolyse augmente rapidement. Certains objets et/ou matériaux commencent à émettre des gaz sous l'effet du rayonnement. Rapidement tous les gaz, matériaux combustibles et mobiliers prennent feu (embrasement généralisé).
Cette phase « normale » de transition peut être extrêmement rapide et devenir très dangereuse pour les équipes engagées.

C'est une étape normale en feu de structure dans un espace ventilé. Il s'agit de l'inflammation de l'ensemble des combustibles de la pièce. Sa puissance et les risques de propagation sont au maximum au regard des conditions de ventilation. À cette étape, le feu est limité par la ventilation. Le plein développement est la conséquence immédiate d'un embrasement généralisé.
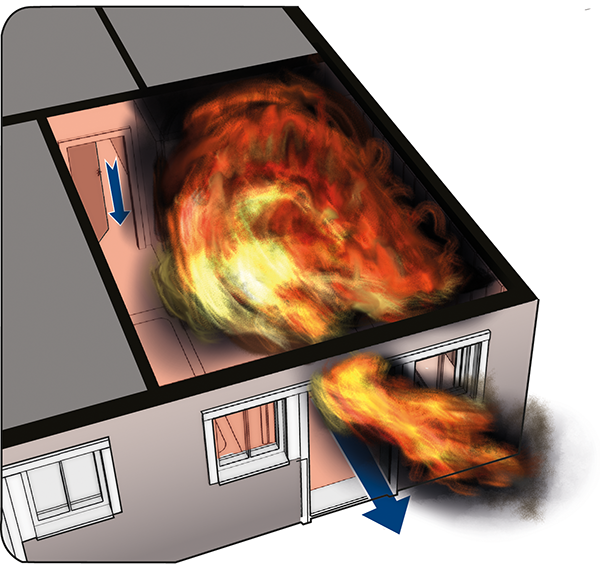
La phase de déclin correspond à la fin de la combustion des matériaux. La puissance du foyer et des phénomènes associés est en diminution. Les risques liés aux fumées restent présents. Le feu redevient limité par le combustible.
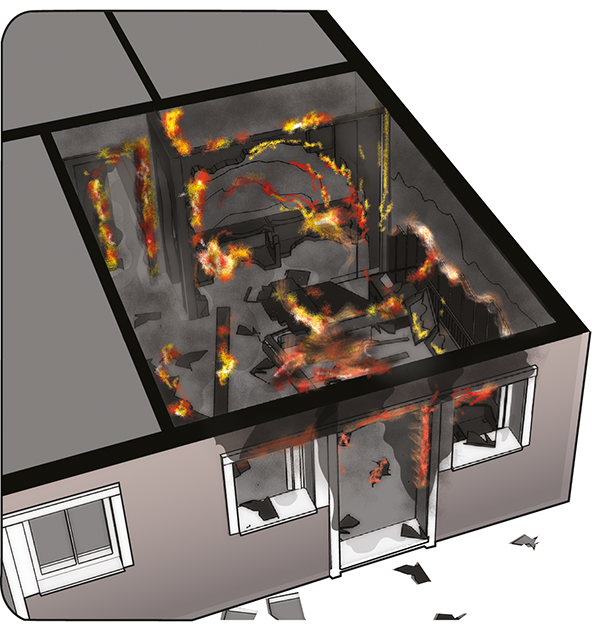
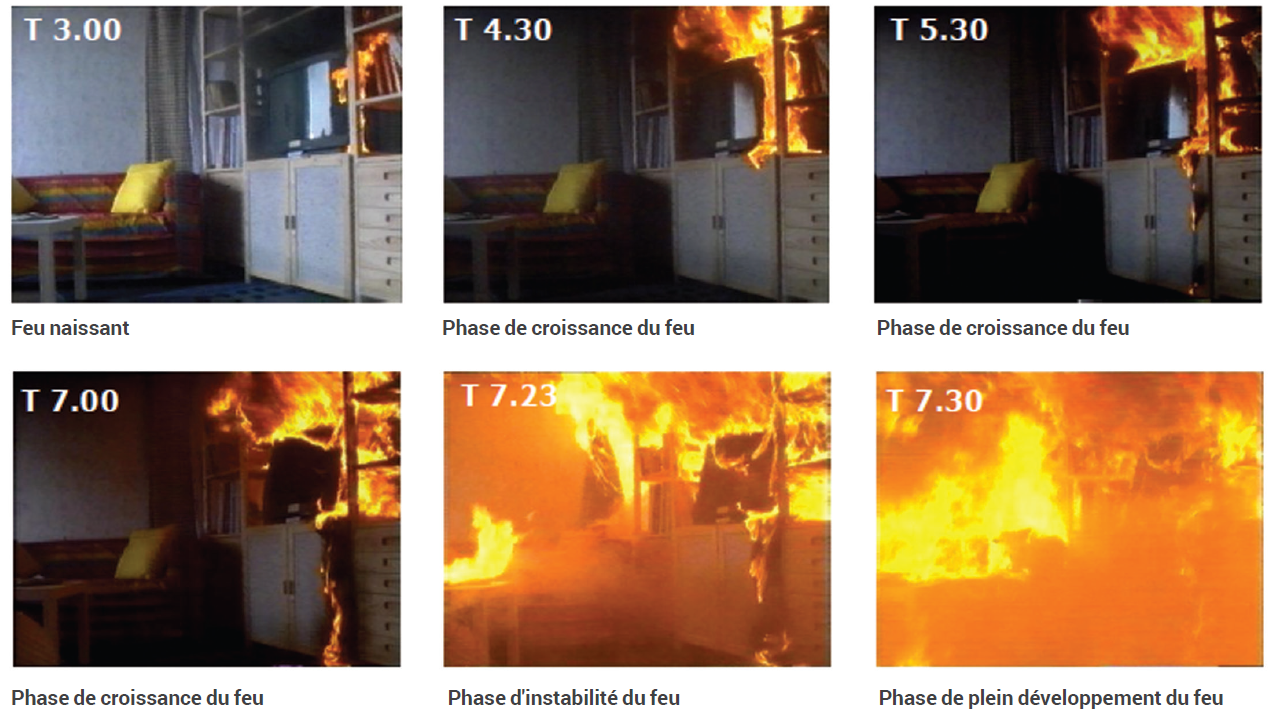
FS 4 PG
NOTIONS DE FEU LIMITÉ PAR LE COMBUSTIBLE (FLC) ET FEU LIMITÉ PAR LA VENTILATION (FLV)
Références : GDO Interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique (FSCI-CSF-4)
La puissance du feu est dépendante de la nature du combustible (pouvoir calorifique ΔHc en MJ/kg) et de la quantité de débit de pyrolyse : (ṁp en g/s). Dans ce cas, la formule de puissance est donnée par :
P = ṁp x ΔHc (en kW)
Seul le combustible influe sur le développement du feu. On dit que le feu est « limité par le combustible ».
À cette étape, le volume de la pièce dans laquelle se développe le sinistre n'a pas d'influence sur le comportement du feu.
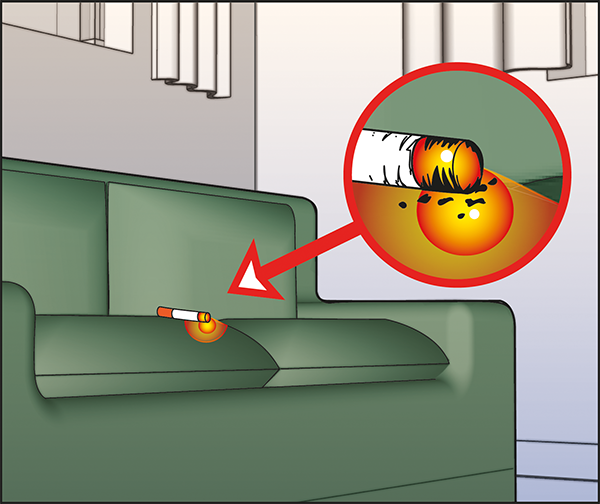
La puissance du feu est fonction des caractéristiques des ouvrants. On parle de feu limité par la ventilation ou FLV. Par « limité » il convient plutôt de comprendre une dépendance : la puissance du feu est dépendante de la ventilation, donc, de l'ouvrant. Dans ce cas la formule de puissance est donnée par :
P = 1 500.A.√H (en kW)
H représente la hauteur de l'ouvrant disponible (la hauteur de fumée sortante).
A représente la surface de l'ouvrant.
Fenêtre de 1 m x 1 m : A = 1 m² , H = 1 m.
P = 1 500 x 1 x √1 = 1 500 kW = 1,5 MW
(pour rappel, 1MW = 1 000 kW)

Porte de 1 m x 2 m : A = 2 m², H = 2 m.
P = 1 500 x 2 x √2 = 4 200 kW = 4,2 MW

Courbe de développement du feu et régimes de limitation
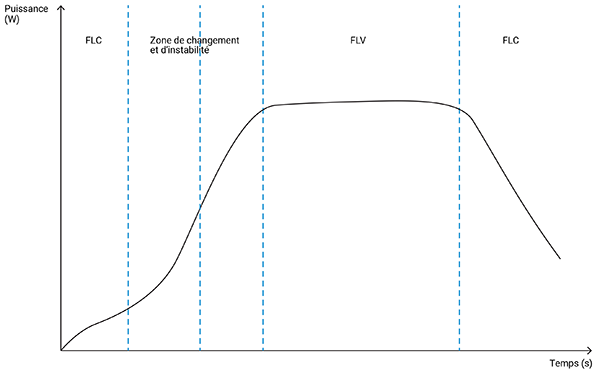
Dans certaines littératures les termes employés sont : Feu contrôlé par le combustible (FCC) ou Feu contrôlé par la ventilation (FCV).
FS 5 PG
LES TRANSFERTS DE MASSE ET DE CHALEUR
La quantité de fumées débitée par la combustion incomplète (ṁfumées) des réactifs (gaz de pyrolyse et oxygène de l'air) est égale à la somme du débit d'air entrant dans le volume (ṁair) et du débit de pyrolyse (ṁpyrolyse). Il est alors possible de résumer cette phrase par l'addition donnée ci-après :
ṁair + ṁpyrolyse = ṁfumées
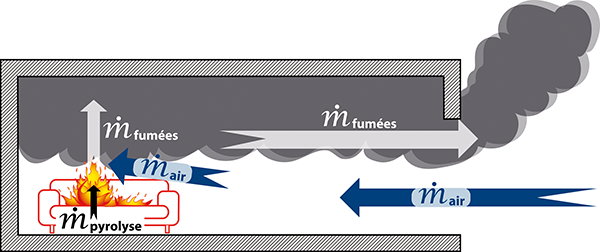
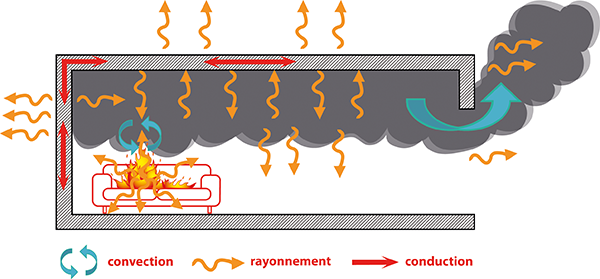
Convection : transfert de chaleur par le mouvement ascendant d'un fluide.
Rayonnement : transfert de chaleur par ondes électromagnétiques émises dans toutes les directions par un corps chauffé.
Conduction : transfert de chaleur dans la masse d'un matériau. La transmission de chaleur se fait de proche en proche sans aucun transfert de matière.
FS 6 PG
LES EMBRASEMENTS GÉNÉRALISÉS ÉCLAIRS (EGE)
Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-10
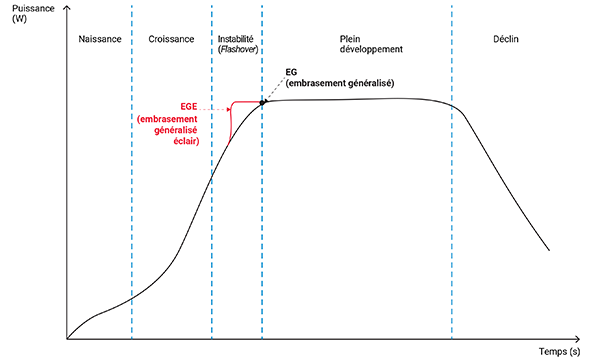
Pour que l'embrasement généralisé éclair (EGE) se produise, il faut que la température de la pièce soit suffisamment élevée. Pour cela, de l'énergie est nécessaire. Cette énergie est libérée par la combustion.
La surface occupée par le foyer va s'étendre et la quantité de combustible impliqué dans l'incendie va augmenter. La puissance de cet incendie s'accroît par cette extension du foyer. En d'autres termes, une plus grande quantité d'énergie est libérée. À un moment donné, un seuil critique va être franchi. Il y a alors beaucoup d'énergie libérée pour permettre à l'EGE de se produire.
Avant que l'embrasement généralisé éclair ne se produise, la température dans la pièce est limitée et doit encore augmenter. La quantité de combustible impliqué dans la combustion est également limitée et le foyer est encore localisé.
Le feu commence alors à s'étendre, impliquant de plus en plus de combustible, ce qui provoque la libération d'une plus grande quantité d'énergie. Le plafond de fumée devient plus dense, s'abaisse et s'enrichit en gaz combustibles. Brusquement, le plafond de fumée va s'enflammer à l'interface air/fumées (roll over/rouleaux de flammes).
L'apparition du roll over va fortement accroître le rayonnement thermique du plafond de fumée en direction des objets présents, ce qui contribue à une extension encore plus rapide de l'incendie. Quelques secondes plus tard, la totalité de la pièce est la proie des flammes. L'embrasement généralisé éclair a eu lieu.
| Signes annonciateurs du risque d'EGE et élément déclencheur | |
| Bâtiment et destination | Bâtiment où l'apport d'air est constant |
| Fumées | Abaissement brutal du plafond de fumées |
| Flammes | Foyer vif localisé. Flammes vives et véloces Présence de roll over (flammes à l'interface air-fumée) |
| Sons | Crépitements | Chaleur | Couche de fumées rayonnantes Accélération du dégagement de gaz de pyrolyse |
Élément déclencheur | Gaz de pyrolyse (combustible du triangle du feu) |
Les roll over sont le signe de l'imminence de l'embrasement généralisé éclair. Ils augmentent
le débit de gaz de pyrolyse. Le binôme confronté à ce phénomène doit adopter immédiatement
une attitude défensive et se replier en dehors du volume concerné.
FS 7 PG
LES EXPLOSIONS DE FUMÉES (EF)
Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-11
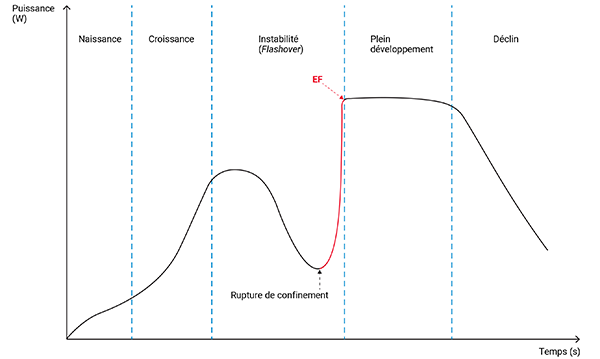
L'explosion de fumées est un phénomène thermique extrêmement rare. Il faut en effet réunir un grand nombre de paramètres avant qu'une explosion de fumées puisse se produire. Ce phénomène peut se révéler très violent et c'est probablement la raison pour laquelle il est très connu.
La condition pour que l'explosion de fumées puisse se produire est la suivante : il doit y avoir eu le feu dans la pièce. Ce feu a eu besoin de combustible et d'oxygène pour s'étendre. À un moment donné, le feu est stoppé dans son développement en raison d'un manque d'oxygène. Nous nommons ce type de feu, un feu sousventilé. En raison d'une augmentation déjà importante de la température dans le volume, les objets brûlants continuent à pyrolyser. Le feu s'étouffe. La combustion avec flammes s'arrête mais un feu braisant subsiste et une quantité de plus en plus importante de gaz de combustion et surtout de pyrolyse sont produits.
La concentration de gaz inflammables s'élève et contribue à créer un mélange trop riche. Ce mélange se trouve au-dessus de la limite supérieure d'explosivité (LSE).
Si un sapeur-pompier ouvre une porte ou si une vitre cède, de l'air pénètre à nouveau dans le volume. Le foyer se réenflamme et peut mettre le feu au prémélange à proximité s'il se retrouve entre les limites d'explosivité (LIE et LSE). L'explosion de fumées survient alors et une onde de pression va expulser les gaz de combustion à l'extérieur de la pièce via les ouvertures suivie d'une boule de feu
| Signes annonciateurs du risque d'explosion de fumées et élément déclencheur | |
| Bâtiment et destination | Volume généralement clos ou considéré clos Volume en surpression et/ou en dépression en fonction des conditions Apport d'air inexistant ou très faible Vitres noircies qui peuvent vibrer |
| Fumées | Fumées généralement grasses et chargées en produits de combustion et de pyrolyse Fumées couleurs inhabituelles (noirâtre, jaunâtre, verdâtre…) Fumées pouvant sortir sous pression par bouffées et être réaspirées |
| Flammes | Quasi absence de flammes visibles dans le volume concerné Maintien de source d'ignition dans le volume concerné |
| Sons | Crépitements | Chaleur | Sons généralement assourdis Absence de crépitements |
Élément déclencheur | Gaz de pyrolyse (combustible du triangle du feu) |
FS 8 PG
INFLAMMATION / EXPLOSION DES GAZ (FGI)
Références : GDO interventions sur les incendies de structures - Fiche scientifique FSCI-CSF-12
Ces phénomènes peuvent apparaître à toutes les phases de l'intervention. Ils surviennent de la même manière que les explosions de gaz qui se produisent à la suite d'une fuite de gaz naturel dans une habitation. Pour que le phénomène puisse se produire, la condition suivante doit être remplie : il faut qu'une quantité suffisante de gaz inflammables dans le volume à une concentration donnée soit supérieure à la limite inférieure inflammabilité/ explosivité (LII/LIE). Lors d'un incendie, ces gaz peuvent être formés par la combustion (gaz de combustion) et/ou par la pyrolyse (gaz de pyrolyse).
Si, lors d'un incendie, une grande quantité de gaz est produite dans un volume fermé, une surpression apparaît. Cette surpression contribue à pousser des gaz de combustion hors du volume par les fentes et les interstices existants. La fumée qui n'a pas été expulsée vers l'extérieur peut s'accumuler, mais il se peut également qu'elle s'accumule dans une pièce adjacente ou dans un volume « caché » : faux-plafond, plancher surélevé pour salles d'ordinateurs, fausses cloisons, autre volume...
Si on apporte une source d'ignition au sein du mélange, celui-ci peut alors s'enflammer.
La violence du phénomène (inflammation des gaz, flash fire ou explosion de fumée, smoke explosion) qui va se produire est déterminée par la concentration en gaz combustible comme décrit dans le schéma ci-dessous :
- Zone 1 : le mélange est trop pauvre (< LII/LIE).
- Zone de réaction : une inflammation de gaz (flash fire) avec des effets thermiques se produisant lorsque nous sommes proche de la LII et de la LSI, une explosion de gaz (smoke explosion) avec des effets mécaniques associés aux effets thermiques lorsque nous sommes entre la LIE et la LSE proche du point stoechiométrique.
- Zone 2 : le mélange est trop riche (> LSI/LSE). Attention au risque d'explosion suite à ventilation.
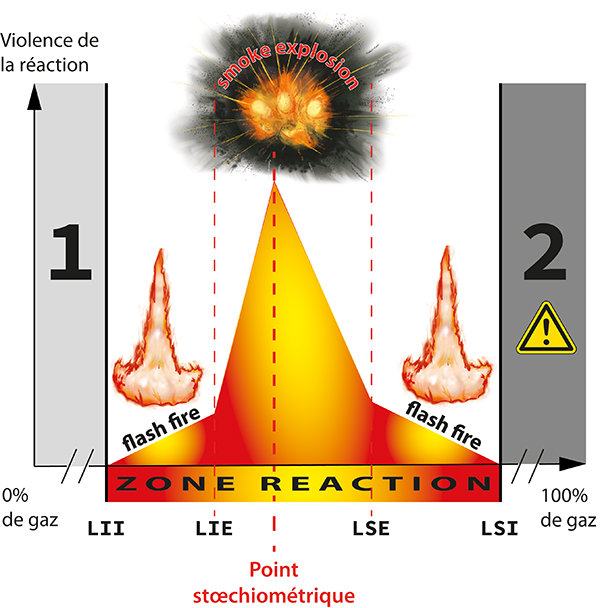
Au centre de la plage d'explosivité se trouve la concentration dite « stoechiométrique ». Il s'agit de la proportion de mélange idéale entre combustible et oxygène.
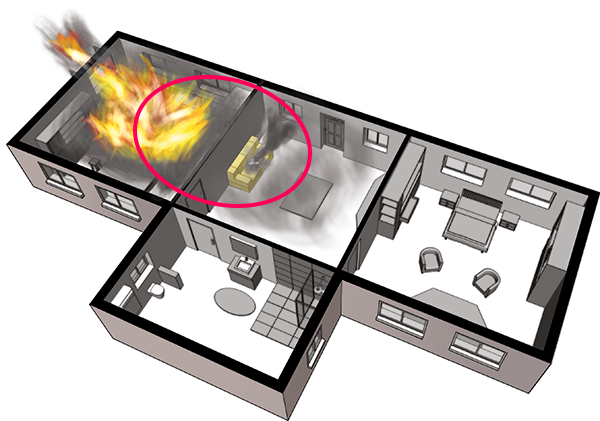
Exemple : le feu prend dans une chambre, le mur de celle-ci est chauffé de façon très intense et le canapé qui se trouve dans l'autre pièce, se met à dégager des gaz de pyrolyse, parce qu'il est chauffé au travers de la cloison. La pyrolyse dégagera beaucoup de gaz, très combustibles. En plus, le phénomène de pyrolyse ne consomme pas de comburant. Au bout d'un certain temps, le local sera donc rempli de fumées combustibles et de comburant. Il ne manquera plus que l'énergie pour démarrer la réaction. Cette énergie peut être apportée par le déplacement d'éléments chauds lors du déblai, par l'effondrement d'une partie de la cloison, etc.
De chaque côté des extrémités de la plage d'explosivité, les mélanges sont forcément moins idéaux. Bien qu'ils puissent encore être enflammés, l'inflammation de tels mélanges conduira plutôt à une combustion rapide. L'augmentation de pression sera alors très limitée dans le volume. Ce phénomène est décrit comme une inflammation de gaz combustible (flash fire).
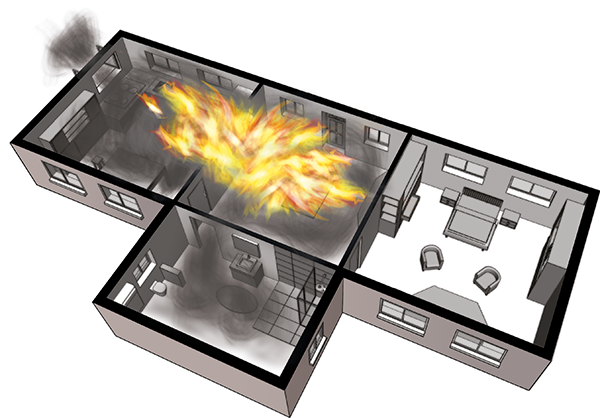
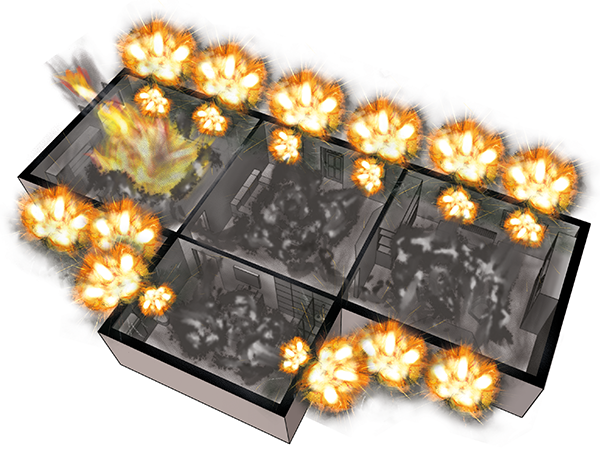
L'inflammation de gaz présentant une proportion de mélange idéale va donner lieu à une explosion puissante : une explosion de gaz combustible (smoke explosion).
L'explosion de gaz combustible (smoke explosion), correspond à l'inflammation de gaz (flash fire), mais sous une forme explosive.
Attention
Le mélange fumée-comburant n'a pas besoin d'être chaud pour prendre feu. Un tel phénomène peut donc se produire plusieurs heures après l'extinction du foyer qui se trouve dans un autre local.
| Signes annonciateurs du risque d'inflammation / explosion de gaz et éléments déclencheurs | |
| Bâtiment et destination | Volume généralement clos ou considéré clos Particulièrement possible dans le local sinistré (déblais) ou dans les locaux adjacents au volume d'origine du feu Possibles dans les lieux éloignés du volume sinistré (propagation des gaz via les communications existantes, mais aussi par des dispositifs techniques (gaines, conduits…) |
| Fumées | Fumées stagnantes dans un volume Fumées blanchâtres, voire jaunâtres, indiquant probablement des gaz de pyrolyse ; grises, voire noires, indiquant des résidus riches en carbone (produit de combustion) |
| Flammes | Absence de flammes visibles dans le volume concerné Contact du mélange avec une source ignition dans le volume concerné (braise, matériel électrique, déblai…) |
| Sons | Néant | Chaleur | Présente (gaz formés par la combustion) ou absente (gaz de pyrolyse) | Élément déclencheur | Énergie d'activation |
FS 9 PG
RÉSISTANCE ET RÉACTION AU FEU
La résistance au feu d'un élément de construction est son aptitude à conserver l'ensemble des propriétés nécessaires à son utilisation pendant une durée déterminée, malgré les effets d'un incendie.
Les éléments de construction pour lesquels un degré de résistance au feu peut être exigé sont les murs, les planchers, les portes, etc.
Les différentes classes :
| Critères | R (résistance mécanique) | E (étanchéité) | I (isolation thermique) |
| R (SF) | X | NC | NC |
| RE (PF) | X | X | NC |
| REI (CF) | X | X | X |
NC : Non Concerné
- Classement R (anciennement SF, stabilité au feu) : temps durant lequel l'ouvrage reste stable (Résistance mécanique). L'élément de construction conserve (durant le temps indiqué), ses capacités de portance et d'auto-portance.
- Classement RE (anciennement PF, pare-flamme) : en plus du classement R, l'élément testé doit être étanche aux flammes et aux gaz inflammables (Étanchéité). L'élément évite (durant le temps indiqué), la propagation des gaz de combustion et des fumées du côté non sinistré
- Classement REI (anciennement CF, coupe-feu) : en plus du classement RE, ce classement limite à 140° C (en moyenne) et 180° C (au maximum), l'élévation de température de la surface non exposée au feu (Isolation thermique). L'élément évite (durant le temps indiqué), la propagation de la chaleur du côté non sinistré.
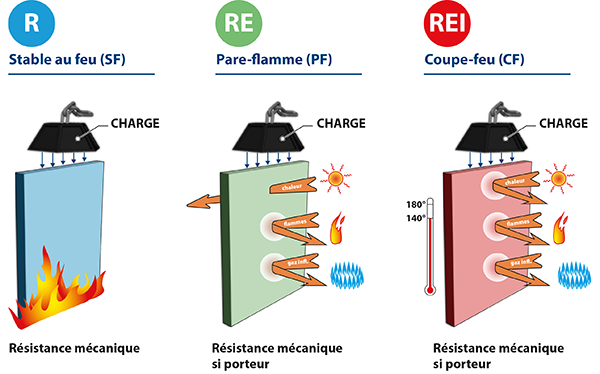
La réaction au feu d'un matériau est son aptitude à participer en tant qu'aliment, au feu auquel il est exposé.
La classification de réaction au feu s'étend de matériaux incombustibles à matériaux facilement inflammables.
| EUROCLASSES | Catégorie M | ||
| Critères d'inflammabilité | Indice de fumée (smoke) | Indice d'apparition de la gouttelette enflammée (drop) | Exigence nationale |
| A1 | _ | _ | Incombustible |
| A2 | s1 | d0 | M0 |
| A2 | s1 | d1 | |
| A2 | s2 s3 |
d0 d1 |
|
| B | s1 s2 s3 |
d0 d1 |
M1 M2 |
| C | s1 s2 s3 |
d0 d1 |
|
| D | s1 s2 s3 |
d0 d1 |
M3 M4 |
S = Production et opacité de fumées (quantité et vitesse) :
- s1 : faible quantité/vitesse ;
- s2 : moyenne quantité/vitesse ;
- s3 : haute quantité/vitesse.
D = Production de gouttelettes et débris enflammés :
- d0 : aucun débris (gouttelette ou particule) avant 600 secondes ;
- d1 : aucun débris dont l'enflammement persiste pendant plus de 10 secondes avant 600 secondes ;
- d2 : ni d0 ni d1 (ne satisfait pas les critères de classement).
FS 10 PG
DOMAINES D'UTILISATION DE LA CAMÉRA THERMIQUE
- Reconnaissance intérieure/extérieure.
- Localisation/recherche de victimes ou de sauveteurs.
- Progression et passage de porte.
- Évaluation des risques de phénomènes thermiques.
- État des charpentes (structures industrielles ou autre).
- Rechercher des itinéraires de repli ou des secours, des ouvrants.
- Feux de parking souterrain et tunnels.
- Feux de navire.
- Localisation de foyer (joint de dilatation…).
- Feu couvant et combustion spontanée (feu de paille…).
- Recherche de points chauds.
- Feux de cheminée.
- Ventilation : identification des entrants et sortants.
- Phase de déblai.
- Feux de silos agricoles.
- Emballement d'un pack batterie sur un véhicule à énergie alternative.
- Surveillance torchère hydrogène sur un feu de véhicule.

- Recherche de personnes.
- Recherche de personne en milieu aquatique : victime en surface avec des parties hors de l'eau.
- Secours routiers (immédiatement à l'arrivée sur les lieux : levée de doute sur nombre de victimes).
- Recherche de point d'échauffement sur machine ou tableau électrique.
- Localiser une ligne électrique haute tension et les conducteurs électriques.
- Niveau de citernes, fûts et bidons.
- Fuites de gaz.
- Localisation de nids d'hyménoptères à travers une paroi.
- Pollution : repérage de nappe et de son évolution sur l'eau.
FS 11 PG
DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)
Références : Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI)
Guide de le Défense Extérieure Contre l'Incendie du SDIS de l'Isère.
La défense extérieure contre l'incendie (DECI) se définit comme l'ensemble des aménagements fixes, publics ou privés, susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie.




Ce sont généralement des poteaux ou des bouches d'incendie, raccordés au réseau d'eau potable sous pression, avec une pression dynamique de 1 bar minimum et un débit fixé par le RDDECI en fonction du risque à défendre.



Il s'agit des points d'eau naturels et artificiels dont le volume est fixé par le RDDECI en fonction du risque à défendre. Le volume minimum non fractionnable du PEI NA est fixé à 30 m³.
Tout PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l'alimente.
L'analyse des risques est au coeur de la définition des ressources en eau pour l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie.
La méthode s'applique dans la continuité du SDACR et vise à distinguer la défense de bâtiments pour lesquels le risque d'incendie est susceptible d'être appréhendé par des mesures génériques (risque courant), de ceux dont les particularités vis-à-vis du risque d'incendie nécessitent une étude spécifique (risque particulier).
Pour cela, on distingue :
-
Risque courant faible : couvert par un volume d'eau de 30 m³ (ou un débit de 30 m³/h) disponible pendant 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre.
Les bâtiments concernés sont ceux dont la surface développée est limitée à 250 m2 (environ) et sans risque de propagation externe au bâtiment.
Il peut s'agir, par exemple, d'habitations individuelles ou jumelées ou encore d'immeubles à usage de bureaux R+1 maximum. -
Risque courant ordinaire : couvert par un volume d'eau de 90 m³ (ou un débit de 60 m³/h) disponible pendant 1 heure 30 à moins de 200 mètres du risque à défendre.
Les bâtiments concernés sont ceux présentant un potentiel calorifique modéré et/ou un risque de propagation aux bâtiments environnants faible ou moyen.
Il peut s'agir par exemple d'un lotissement de pavillons, d'un immeuble d'habitation collectif, d'une zone d'ha - bitats regroupés ne répondant pas à la condition d'absence de risque de propagation. -
Risque courant important : couvert par un volume d'eau de 240 m³ (ou un débit de 120 m³/h) utilisable en 2 heures à moins de 100 mètres du risque à défendre.
Les bâtiments concernés sont ceux présentant un potentiel calorifique fort et un risque de propagation aux bâtiments environnants élevés notamment en raison des matériaux de construction et de l'imbrication des immeubles.
Il peut s'agir par exemple de quartiers historiques (rue étroite, accès difficile, vieux immeubles où le bois prédomine) ou d'un territoire densément urbanisé composé d'habitations et/ou de locaux soumis au Code du travail à fort potentiel calorifique. - Risque particulier : nécessite une étude particulière et individualisée, compte tenu des enjeux humains, socio-économiques ou patrimoniaux.
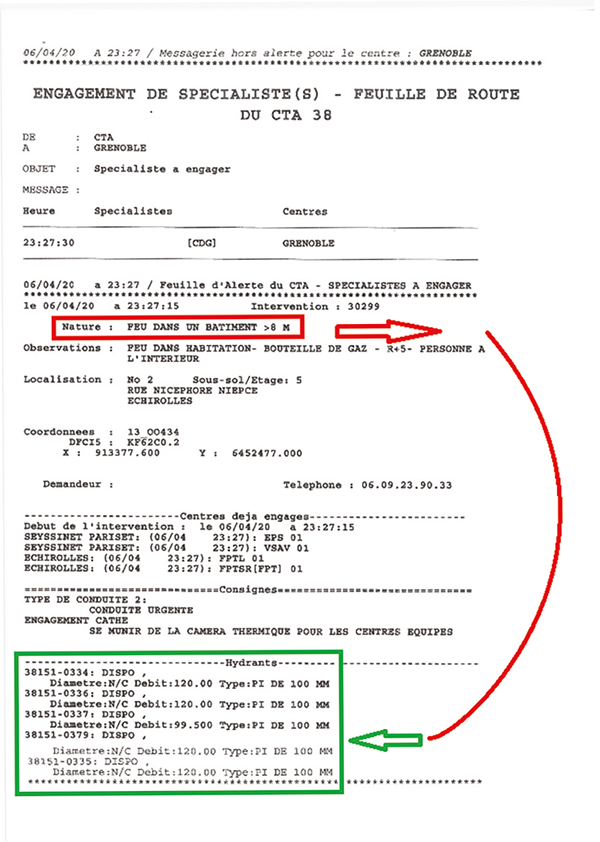
Sur le ticket de départ, 5 PEI disponibles
dans un rayon de 1 000 mètres
de la ZI sont indiqués.
Il appartient au chef d'agrès de choisir judicieusement la prise d'eau.
FS 12 PG
RÔLE DU BINÔME
Les personnels engagés doivent travailler en binôme. Un binôme est composé d'un chef et d'un équipier.


Le binôme est indissociable, particulièrement en zone d'exclusion. Un sapeur-pompier ne doit jamais s'engager seul.
Chaque membre du binôme participe à la sécurité de l'équipe, cela suppose :
- un contrôle mutuel des EPI ;
- une communication optimale au sein de l'équipe et également avec le CA ;
- le respect des consignes de sécurité données par le CA ;
- la maîtrise des techniques opérationnelles.
La gestion des efforts entre le chef d'équipe et l'équipier est un élément important à prendre en compte pour la bonne réalisation de la mission. Le binôme, par différentes actions concertées, agit sur le système feu afin de sauver les personnes et protéger les biens. Un changement de rôle au sein du binôme peut être fait en fonction des situations.
Par exemple, les équipiers doivent savoir manipuler les outils (halligan, lance...) et les adapter aux situations susceptibles d'être rencontrées afin de garantir un maximum d'efficacité pour le binôme.
Les missions des binômes peuvent être les suivantes :
- binôme d'exploration (reconnaissance ARI, cf. FT 1 RECO) ;
- binôme d'exploration (LSPCC) ;
- binôme de réception (LSPCC) ;
- binôme de remontée (LSPCC) ;
- binôme d'attaque (cf. FT 2 EXT) ;
- binôme d'alimentation (cf. GTO : établissements et techniques d'extinction) ;
- binôme de sauvetage (LSPCC) ;
- binôme de sécurité (cf. FT 3 PIC).
FS 13 PG
GDO Interventions sur les incendies de structures
- la dimension et l'implantation
- le mode constructif (préfabriqué, traditionnel…)
- le type de matériaux
- la présence de volume à risque
- la distribution intérieure
- le nombre et type d'ouvrants
- stratification
- débit
- couleur
- vélocité
- sens de tirage
- conditions aérauliques (vent, ouvrants existants ouverts ou fermés)
- volume
- emplacement
- couleur
- potentiel fumigène
- vélocité…
- nature
- assourdis
- crépitements…
- dégradation des matériaux
- présence de pyrolyse
- ressentis des équipes…
FS 1 PIC
GÉNÉRALITÉS SUR LES PROTECTIONS RESPIRATOIRES
La santé et la sécurité des intervenants doivent faire l'objet d'une attention permanente.
En amont de l'engagement opérationnel, le sapeur-pompier doit connaître le matériel à sa disposition.
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère dangereuse ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.
L'air respirable lui est fourni selon l'un des deux principes suivants : soit par l'apport d'air provenant d'une source non polluée (cas des appareils indépendants de l'air ambiant), soit après la filtration de l'air pollué à travers le dispositif protecteur.
Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. On y trouve également l'indication des caractéristiques propres à l'équipement, permettant à tout utilisateur entraîné et qualifié d'en faire un usage approprié.
Un appareil de protection respiratoire est un équipement de protection individuelle de catégorie III, qui permet d'assurer la protection du porteur contre les risques pouvant entraîner des lésions irréversibles ou mortelles.
Un appareil respiratoire isolant (ARI) autonome à circuit ouvert fonctionne avec une réserve d'air comprimé sous haute pression. Il permet à l'utilisateur d'être alimenté à la demande en air respirable provenant de la (ou des) bouteille(s) portée(s) sur le dos de l'utilisateur. L'air expiré est rejeté à l'extérieur par intermédiaire de la soupape d'expiration du masque.
Un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (ARICO) est obligatoirement constitué des éléments suivants :
- une réserve d'air : une ou plusieurs bouteille(s) d'air comprimé, avec ou sans housse de protection, équipée(s) de leur robinet ;
- un dossard et un harnais ;
- un détendeur HP/MP : haute pression (HP : 200 ou 300 bars selon les bouteilles), moyenne pression (MP : 6 ou 7 bars), équipé d'un dispositif d'échappement de l'air s'ouvrant automatiquement lorsque la moyenne pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d'une anomalie de fonctionnement ;
- un flexible moyenne pression reliant le détendeur HP/MP à la SAD ;
- une soupape à la demande (SAD) : détendeur MP/BP ; moyenne pression (MP : 6 ou 7 bars), basse pression (BP : légèrement supérieure à 1 bar, pour maintenir une surpression dans la pièce faciale) ;
- un manomètre d'air comprimé pneumatique ou électronique ;
- un flexible haute pression reliant le détendeur HP/MP avec le manomètre ;
- une pièce faciale (masque complet) ;
- un sifflet de fin de charge.
L'ARICO peut en outre être équipé de dispositifs optionnels, tels que :
- un détecteur d'immobilité (BSL) ;
- un indicateur de température ;
- un système d'enregistrement de données ;
- un boîtier d'instrument de contrôle et de sécurité (ICS) avec manomètre et afficheur d'autonomie, qui peut regrouper les dispositifs précédents ;
- un deuxième raccordement moyenne pression d'entrée utilisé pour l'alimentation en air du porteur de l'appareil à partir d'une autre source d'air moyenne pression extérieure ;
- un deuxième raccordement moyenne pression de sortie utilisé pour l'alimentation en air d'une seconde personne à des fins de sauvetage ou de mise en sécurité ;
- un deuxième raccordement moyenne pression combiné (entrée et sortie) utilisé pour l'alimentation en air du porteur de l'ARICO à partir d'une autre source d'air moyenne pression extérieure et d'une seconde personne à des fins de sauvetage ou mise en sécurité ;
- un dispositif de by-pass (permettant une arrivée d'air supplémentaire en cas de besoin).
L'air comprimé à haute pression (200 ou 300 bars) de la (ou des) bouteille(s) est ramené dans un premier temps à moyenne pression (6 ou 7 bars) par le détendeur HP/MP, puis passé en basse pression (légèrement supérieure à 1 bar) au moyen de la soupape à la demande.
Le masque complet qui permet la connexion de la soupape à la demande et l'échappement de l'air expiré, couvre la totalité du visage (bouche, nez et yeux).
La soupape à la demande est équipée d'un dispositif by-pass permettant de fournir, lors de l'utilisation, une arrivée d'air supplémentaire dans le masque. Il sert aussi à purger le circuit de l'appareil après son utilisation.
Ainsi, afin de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger
le sapeur-pompier, le masque complet doit être porté en contact direct sur une peau rasée.
Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert

Autres types d'appareils
Appareil respiratoire isolant (CO) bi-bouteilles
Chariot d'air multi-bouteilles
Les bouteilles employées avec les appareils respiratoires peuvent être métalliques ou composites :
| Type de bouteille utilisée pour les ARICO | Composition |
| Type I | Bouteilles métalliques |
| Type II | Bouteilles métalliques renforcées |
| Type III | Bouteilles composites avec liner métallique |
| Type IV | Bouteilles composites avec liner plastique |
Autonomie d'un ARICO
L'autonomie d'un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert dépend de la quantité d'air disponible ainsi que de la consommation du porteur, qui varie suivant l'individu et le travail effectué.
Il convient, pour simplifier, de considérer que la consommation « haute » d'un porteur d'ARICO lors d'un incendie est d'environ 100 l/min (effort intense).
Ainsi, pour un tel débit (100 l/min), un ARICO équipé d'une bouteille de 6,8 litres gonflée à 300 bars offrira une autonomie de 19 minutes environ.
Pour rappel l'autonomie se calcule à l'aide de la loi de mariotte :
T = (PxV)/Q
P = pression en bar
V = volume de la bouteille en litre
Q = débit du porteur en litre/minute
T = temps en minutes
Un appareil respiratoire isolant à circuit fermé permet de régénérer l'air expiré vicié pour le rendre à nouveau respirable. Ce type d'appareil est principalement utilisé dans les interventions nécessitant des autonomies importantes (explorations de longues durée, feux de navires, etc.).
Il existe différents types d'appareils à circuit fermé. Les modèles les plus utilisés par les services d'incendie et de secours sont :
- l'appareil à circuit fermé fonctionnant avec une réserve d'oxygène comprimé pur sous haute pression (principalement 200 bar) et une cartouche de chaux sodée de régénération (absorbeur de dioxyde de carbone) ;
- l'appareil à circuit fermé fonctionnant sans réserve d'oxygène comprimé, avec une cartouche de régénération de dioxyde de potassium (absorbeur de dioxyde de carbone et de l'humidité et générateur de l'oxygène).
Appareil respiratoire isolant à circuit fermé
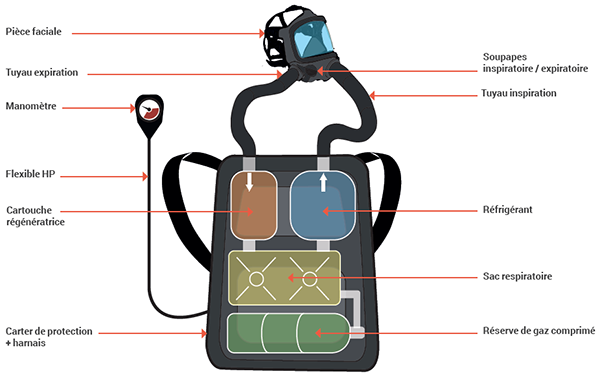
De manière générale, un appareil respiratoire isolant fonctionnant en circuit fermé est constitué par :
- le carter de protection et de portage avec harnais ;
- le sac respiratoire ;
- les tuyaux respiratoires inspiration et expiration ;
- la (ou les) cartouche(s) régénératrice(s) (chaux sodée ou dioxyde de potassium) ;
- la pièce faciale ;
- la réserve de gaz comprimé, qui peut être une bouteille d'air ou d'oxygène comprimé, équipée du robinet (ou un pack de bouteilles) ;
- le détendeur haute/moyenne pression (HP/MP) équipé d'un dispositif d'échappement de l'air s'ouvrant automatiquement lorsque la moyenne pression dépasse le seuil autorisé dans le cas d'une anomalie de fonctionnement ;
- les soupapes (inspiratoire et expiratoire) ;
- le manomètre de gaz comprimé pneumatique ou électronique ;
- le flexible haute pression reliant le détendeur haute/moyenne pression avec le manomètre ;
- le gaz réfrigérant, destiné à réduire la température de l'air inspiré et diminuer ainsi la contrainte physique de l'utilisateur…
L'utilisation des masques complets avec filtres anti-aérosols (solides ou liquides), filtres anti-gaz et filtres combinés répond à des règles strictes d'utilisation (en particulier une connaissance appropriée du milieu).
Ces filtres sont classés en fonction de leur efficacité :
- les filtres de classe P1 (ou classe 1) : qui arrêtent 80% des aérosols ;
- les filtres de classe P2 (ou classe 2) : arrêtent 94% des aérosols ;
- les filtres de classe P3 (ou classe 3) : arrêtent 99,95% des aérosols.

Un marquage supplémentaire indique la réutilisation possible à la suite d'une seule utilisation en ambiance de travail pendant 8 heures : R (réutilisable) ou NR (non réutilisable).
Il est important de garder à l'esprit que ces filtres se colmatent au fur et à mesure de leur utilisation,
en particulier dans le cas de travaux en ambiance empoussiérée.
Si l'intervenant sent une augmentation de la résistance au passage de l'air inspiré, détecte la présence d'un contaminant (fuite vers l'intérieur du masque respiratoire), ou détermine de toute autre manière que l'équipement n'assure plus la protection, il doit quitter la zone dangereuse immédiatement.
Dans certaines conditions, cette technologie de protection respiratoire peut être utile pour se protéger contre des gaz ou des vapeurs.
Généralement, ces filtres sont constitués de charbon actif. L'épuration de l'air inspiré repose sur le phénomène d'adsorption. Pour certains gaz ou vapeurs, ce charbon actif est dopé par l'ajout de réactifs chimiques.

| Type | Couleur | Domaine |
| A | Marron | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65° C |
| B | Gris | Gaz et vapeurs inorganiques |
| E | Jaune | Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides |
| K | Vert | Ammoniac et dérivés organiques aminés |
| HgP3 | Rouge et blanc | Vapeurs de mercure |
| N0P3 | Bleu et blanc | Oxydes d'azote |
| AX | Marron | Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65°C |
| SX | Violet | Composés spécifiques désignés par le fabricant |
Le temps réel de protection dépend d'un paramètre déterminant : le temps de saturation (ou temps de claquage ou de percée), mesuré dans des conditions expérimentales précises, qu'il ne convient pas de comparer avec les conditions opérationnelles.
Les tests sont en effet réalisés à une température de 20° C, une humidité relative à 70 %, un débit de ventilation à 30 l/min et une concentration connue du gaz d'essai. Ils permettent d'obtenir une courbe de claquage (ou de percée) de ce type :
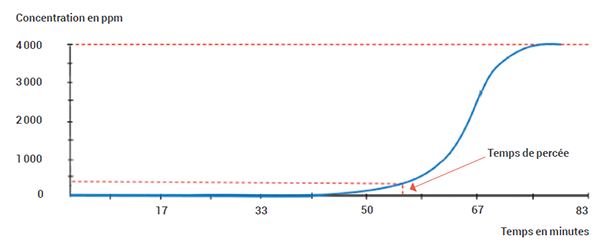
Le temps de claquage est défini comme le temps au bout duquel la concentration de polluant dans l'air filtré dépasse une certaine concentration critique, en général un 10e de la concentration d'entrée.
Les temps minimums de claquage sont définis par la norme NF EN 14387 +A1
Exemple pour une cartouche à « spectre large »
(20° C, 70 % humidité, ventilation 30 l/min)
| Type et classe de filtre | Gaz d'essai | Concentration du gaz d'essai (ppm) | Temps minimalde claquage (min) |
| A2 | Cyclohexane | 5 000 | 35 |
| B2 | Chlore Sulfure d'hydrogène Cyanure d'hydrogène |
5 000 5 000 5 000 |
20 40 25 |
| E2 | Dioxyde de soufre | 5 000 | 20 |
| K2 | Ammoniac | 5 000 | 40 |
Pour travailler en sécurité avec ce type de protection, l'INRS limite leur emploi dans les situations de travail, à une concentration connue inférieure ou égale à 60 fois la valeur limite à court terme (VLCT) propre à chaque toxique.
Exemple : VLCT du Chlore : 0,5 ppm, soit 30 ppm max pour utiliser un filtre à cartouche.
Le temps de claquage ou de saturation dépend et varie selon les conditions opérationnelles réelles :
- ce temps diminue si la concentration de produit, la température et le débit de ventilation augmentent ;
- le débit ventilatoire utilisé dans la norme (30 l/min) est bien inférieur à la moyenne constatée pour une activité de sapeur-pompier ;
- l'humidité relative du milieu (pluie, brouillard, vapeur), doit aussi être prise en compte. Les molécules d'eau auront tendance à occuper les sites d'absorption du matériau filtrant et donc à diminuer le temps de claquage.
En l'état des connaissances actuelles, il n'est pas possible de définir précisément la durée de vie d'une cartouche en utilisation réelle.
L'usage de ce type de protection doit rester réfléchie, nécessitant la connaissance exacte du
polluant, sa toxicité, sa concentration la plus élevée prévisible, etc.
La ligne de vie permet au binôme d'avoir un lien physique et continu avec le point de pénétration.
Ligne de vie = ligne guide + liaison personnelle
Il est à noter qu'un moyen hydraulique ou une commande peut être considéré comme la ligne guide dans certaines
conditions d'engagement
La ligne guide est une ligne enroulée sur un tambour ou lovée dans un sac. Elle a une longueur de 50 à 60 mètres et un diamètre de 6 à 8 millimètres. Elle peut comporter des repères de progression (olives) qui facilitent le travail du binôme. Les groupes d'olives sont séparés de 2,5 mètres.

Ces repères signifient :
- 1 olive isolée en 2e = en direction de la sortie : 31
- 3 olives successives en 2e = en direction du sinistre : 13

La ligne guide peut-être aussi réalisée par une lance alimentée. L'amarrage de la liaison personnelle au tuyau ne doit pas être un frein à la progression des intervenants.
La liaison personnelle permet le déplacement le long de la ligne guide mais également d'assurer un lien constant entre les intervenants.
D'une longueur totale de 6 mètres et d'un diamètre de 4 millimètres, elle peut être utilisée en version courte (1,25 mètre) ou en version longue (6 mètres).

Des dispositifs de dérivations permettent des ramifications le long de la ligne guide principale.
Clés de dérivation
Plaquettes de dérivation

Les dérivations sont principalement utilisées lors de reconnaissance de grands volumes. Il est à noter que jusqu'à 3 dérivations peuvent être effectuées sur la ligne guide.
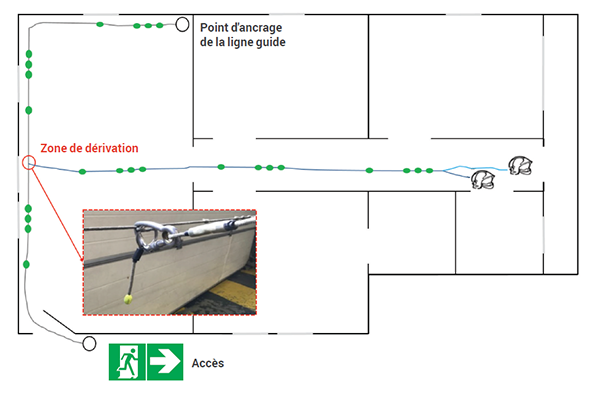
Elle permet d'assurer une veille pendant l'utilisation de l'ARI. Elle alerte de l'immobilité ou de la détresse du porteur si le manque de mouvement dépasse une période donnée en émettant simultanément des signaux sonores et lumineux. Elle peut être déclenchée manuellement si nécessaire.
La sécurisation des binômes est réalisée notamment par la mise en oeuvre de systèmes de communication.
Selon les modèles, ils doivent permettre d'assurer dans toutes les situations et à tout moment :
- la communication propre au binôme ;
- la communication entre les binômes ;
- la communication avec le contrôleur, gestionnaire du point de pénétration.
Ces moyens de communication peuvent être de différents types :
- signaux sonores ;
- signaux visuels ;
- moyens radios.

Dans le cadre de l'activité sous protection respiratoire, plusieurs facteurs limitent la capacité du sapeur-pompier.
Le port des appareils de protection respiratoire :
- modifie le centre de gravité des porteurs ;
- augmente le travail musculaire de l'utilisateur et sa dépense énergétique ;
- participe à la baisse des performances de son utilisateur ;
- limite les capacités de déplacement dans des passages étroits verticaux, horizontaux et lors des franchissements d'obstacles (échelle à crinoline, milieu effondré, etc.).
La condition physique du sapeur-pompier est donc primordiale, influençant directement son autonomie en air, et son ressenti des diverses contraintes liées au port d'un ARI.
La masse de l'ARI est un élément à prendre en compte dans l'altération des capacités physiques
du porteur.
La norme NF EN 137 relative aux appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert précise que la masse de l'appareil prêt à l'emploi ne doit pas excéder 18 kg indépendamment de la configuration multi ou mono bouteille.
La norme NF EN 145 fixe la limite de la masse des appareils respiratoires isolants à circuit fermé à 16 kg. Cette différence de masse prend en compte l'autonomie plus longue de ces matériels et donc la nécessité de soulager la contrainte physique du porteur.
L'espace mort est le volume d'air contenu dans les voies aériennes entre les cavités nasales et la jonction entre bronchioles et alvéoles. Il est d'environ 150 ml chez l'adulte. L'air contenu dans l'espace mort ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaires.
Lors du port d'un appareil de protection respiratoire, l'espace mort est artificiellement augmenté du volume mort imputable au masque, la totalité du masque n'étant pas reventilée à chaque cycle respiratoire.
Plus l'espace mort d'un masque est important, plus la concentration en dioxyde de carbone de l'air inspiré est élevée. On parle alors du phénomène de « ré inspiration » : une partie du CO2 expirée du masque est à nouveau inhalée lors de l'inspiration suivante.
L'augmentation du CO2 dans le sang induit un réflexe d'hyperventilation pouvant entrainer une surconsommation et donc limiter la tâche des porteurs d'ARI.
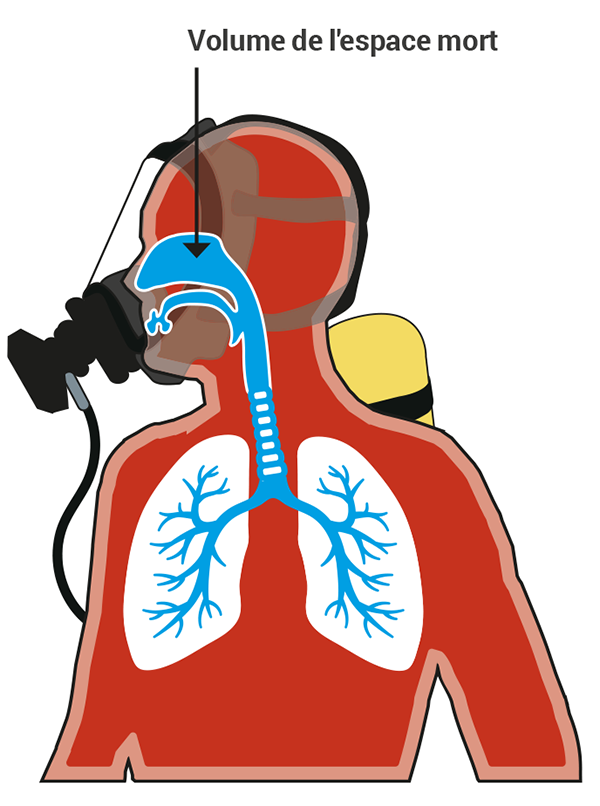
Le port d'un appareil de protection respiratoire entraîne une augmentation de la résistance de l'écoulement des flux aériens inspiratoire et expiratoire. Ainsi, le maintien d'une ventilation constante est obtenu par une augmentation du travail respiratoire.
Le port de l'appareil respiratoire facilite légèrement le travail inspiratoire par l'arrivée d'air sous pression
mais rend plus difficile le travail expiratoire,
ce qui peut engendrer une contre-indication dans le cas de certaines pathologies pulmonaires.Les débits de consommation du porteur ont été identifiés pour les différentes activités.
Ils varient entre 10 l/min au repos à 135 l/min pour un travail très intense.
Le travail respiratoire sous ARI est responsable d'un accroissement de la fréquence cardiaque.
La fréquence cardiaque étant également augmentée par le travail musculaire, la chaleur de l'environnement et le stress.
Les conséquences, outre un épuisement plus rapide, sont la déshydratation et l'hypoglycémie.
Le port d'un appareil entraine une sensation d'inconfort, liée en partie à l'effort expiratoire nécessaire pour vaincre la résistance respiratoire. Cette sensation d'inconfort est cependant variable selon les intervenants.
L'acceptabilité d'un masque de protection dépend à la fois du degré de confort offert par l'appareil, du psychisme du porteur et de la mission à réaliser.
La stabilité émotionnelle de l'utilisateur fait varier la consommation d'air : un sapeur-pompier qui perd son calme accélère son rythme respiratoire et épuise donc rapidement sa réserve d'air.
Par ces divers aspects, le port de l'ARI va entrainer une diminution de l'autonomie du porteur, et ce, d'autant plus que les conditions extérieures seront exigeantes.
Les conséquences peuvent également se ressentir par des difficultés de concentration.
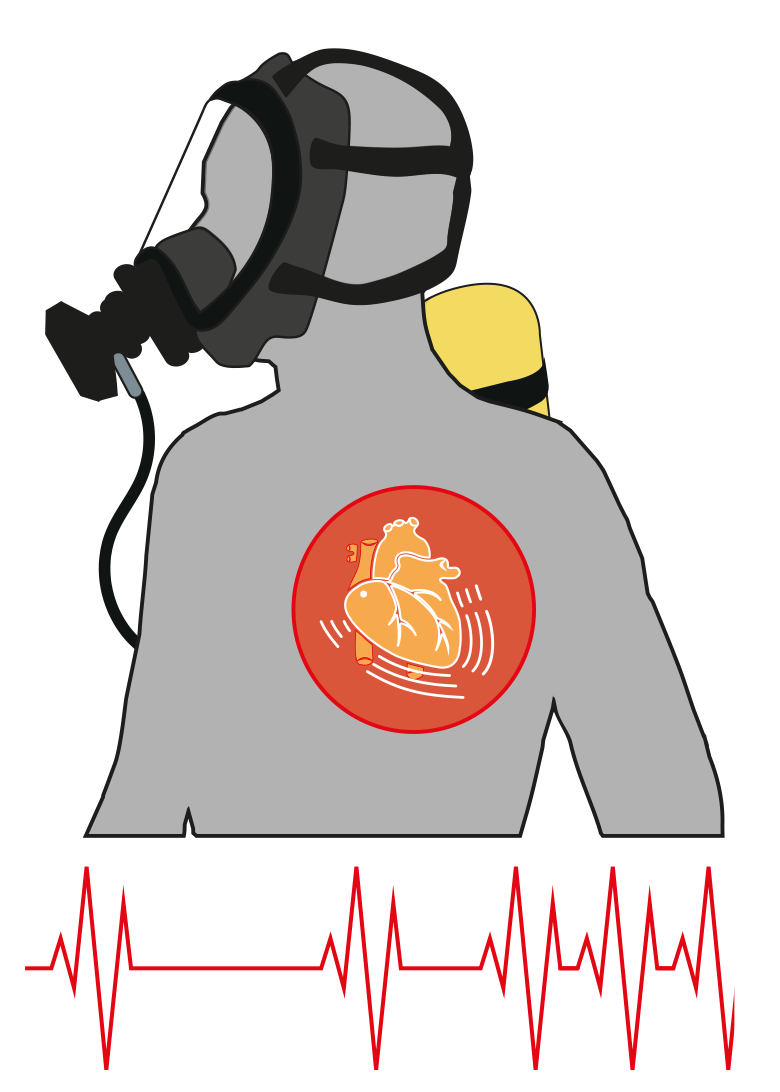
Le port d'un appareil de protection respiratoire modifie, perturbe et diminue profondément les capacités de perception de l'espace environnant ainsi que les capacités relationnelles.
Le porteur perçoit moins bien l'espace environnant (champ de vision réduit) et sa capacité à communiquer avec l'entourage est limitée même si son équipement peut comporter des solutions techniques pour limiter cette contrainte (systèmes de transmission et/ou d'amplification de la voix).
L'acuité auditive du porteur d'un appareil de protection respiratoire est toujours perturbée et réduite par la transmission des bruits respiratoires, des bruits de l'environnement, le port du casque et de la cagoule.
Le temps d'intervention des sapeurs-pompiers est limité par la quantité d'air disponible.
Ces limites sont liées à deux critères :
- la consommation du porteur pendant l'activité opérationnelle ;
- la capacité de stockage et la pression de service de la bouteille, mettant à disposition un volume d'air différent selon les modèles.
L'accoutumance, voire l'aisance en ambiance « opérationnelle » et l'entraînement physique
régulier sont des critères primordiaux qui permettent de retarder les effets de l'effort sous appareil de
protection respiratoire.
Par principe, les appareils respiratoires isolants autonomes doivent être utilisés en priorité, dans
tous les milieux où l'air est vicié (ou susceptible de l'être).
Le port d'un appareil respiratoire isolant est obligatoire dans les cas suivants :
- présence de produits toxiques ;
- qualité de l'air ambiant inconnue ;
- atmosphère appauvrie en oxygène ;
- présence de produits de combustion tels que le monoxyde de carbone ;
- milieu de l'intervention susceptible d'évoluer :
- embrasement,
- explosion.
L'utilisation d'appareils filtrants par les sapeurs-pompiers peut éventuellement être adaptée, sous conditions, dans certaines situations (exemple : reconditionnement du matériel à l'issue d'une opération d'extinction).
Si leur utilisation présente, au premier abord l'avantage de réduire largement les contraintes physiologiques par rapport à celles engendrées par le port d'un ARI, en revanche elle ne peut être envisagée par le commandant des opérations de secours que si les conditions suivantes sont réunies :
- la concentration de l'oxygène dans l'air est supérieure à 17 % (intervention à l'air libre ou dans un local largement ventilé) ;
- le polluant présent dans l'atmosphère viciée est identifié et la mesure de la concentration du polluant est réalisée ;
- la concentration la plus élevée prévisible du polluant est connue ;
- le choix du dispositif filtrant est adapté au polluant identifié ainsi qu'à sa concentration ;
- le risque de l'instabilité de l'atmosphère est évalué.
Si une des conditions citées ci-dessus n'est pas respectée, le port d'un appareil respiratoire isolant
est indispensable.
FS 2 PIC
LA TENUE DE FEU ET LE PORT DU CEINTURON

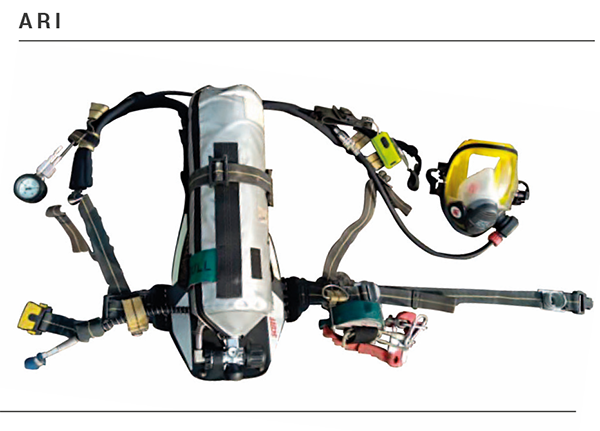
Description
- Composé d'une sangle coton tressée noire de 55 mm
- Avec boucle mâle et femelle à coulissement rapidement
- Présence d'un dé métallique soudé
- Avec un passant comprenant un mousqueton
- Bande rétro réfléchissante grise sur toute la longueur
- Résistance à la rupture de 800 kg pour la sangle et 2020 DaN pour la boucle en acier
- 2 tailles : 120 et 150 cm
- Fourni avec un porte-gants

Domaines d'utilisation
Ceinturon porte-outils individuel permettant notamment d'accrocher un porte-gants comprenant les gants d'intervention et la polycoise.
Attention, ce ceinturon est à différencier du ceinturon de maintien au travail.
Ne jamais utiliser pour s'arrimer ou arrimer une personne.
Le tableau ci-dessous décrit les conditions de port du ceinturon :
| Situation de travail | Consigne | Observations |
| Port de l'ARI | Interdit | Gêne au port de l'ARI avec la sangle ventrale |
| Intervention / action non urgente (travail en hauteur à poste fixe ou évolution en hauteur) | Interdit |
|
| Autres | L'analyse de la situation par le CA prédomine. Il pourra adapter la conduite à tenir par le collectif. | |
FT 1 PIC
PROCÉDURE AVANT ENGAGEMENT
L'engagement est le passage de la zone contrôlée à la zone d'exclusion. Il satisfait aux conditions minimales de sécurité, d'autonomie, d'enregistrement et de réengagement. Il s'agit du début de la mission du binôme (sauvetage, recherche, attaque de foyer, etc.).
Durant la phase d'engagement, la sécurité des intervenants dépend du respect des mesures préalables fixées par le commandant des opérations de secours. Ce dernier, après une analyse de la situation opérationnelle prend sa décision d'engagement de moyens humains en fonction des enjeux et des moyens à disposition, et fixe le niveau de protection adapté au risque. Ces mesures sont les suivantes :
| Fonction | Action |
| COS | Met en place un binôme de sécurité le plus rapidement possible |
| Fait identifier et sécuriser les itinéraires de repli et de secours (prépositionnement des échelles à coulisse ou des moyens aériens…) | |
| Définit un point de regroupement en cas d'évacuation | |
| COS / Contrôleur | Engage le binôme de sécurité sans préavis si le temps d'engagement prévu est dépassé et/ou si le détecteur d'immobilité des équipes intervenantes se déclenche |
| Contrôleur | Met en place un tableau de contrôle pour identifier les équipes, gérer les reconnaissances (horaires...) et gérer les missions |
| Établit / vérifie le code de communication au sein du binôme, entre le binôme et le contrôleur ainsi que le code général d'évacuation | |
| Fait respecter les temps d'engagement en fonction du milieu d'évolution, de l'autonomie des porteurs et des contraintes de l'intervention | |
| Binôme(s) d'exploration | S'habillent et réalisent un contrôle croisé de leur équipement |
| Respectent la mission donnée et les points de pénétration | |
| Rejoignent le point de pénétration à demi pression d'engagement en cas de cheminement complexe | |
| Rendent compte régulièrement de la situation | |
| Laissent la priorité au passage des binômes sortants | |
| Binôme de sécurité | Est mis en place le plus rapidement possible |
Avant tout engagement le RAPACE doit être effectué. L'armement de la balise sonore de localisation
doit être réalisé à la descente de l'engin et la clé sera laissée dans celui-ci.
NOTA : pression à l'engagement : 280 bar minimum.






L'agent aura préalablement revêtu sa tenue de feu (cagoule, veste de feu et sur-pantalon, gants et chaussants incendie).
S'agissant de la protection de la face et des voies aériennes, il est important de respecter le positionnement des trois protections de la tête (masque, cagoule et casque).
Deux modèles de masque coexistent actuellement dans le SDIS 38 (masques à filet ou masques à brides F1), Ce document distingue la procédure chronologique à suivre dans les deux cas.
| Ordre | Masque à filet |
| 1 | Positionner le masque complet de l'appareil de protection respiratoire |
| 2 | Positionner la cagoule enveloppant la tête, la fixation de la protection respiratoire et la jupe |
| 3 | Positionner le casque en coiffant les deux équipements précédents |
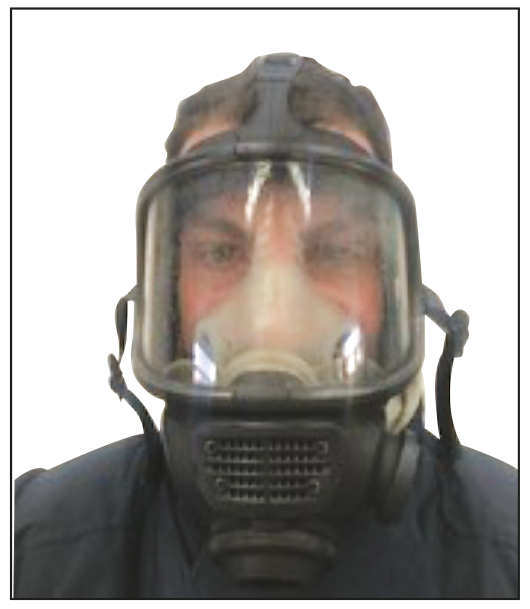
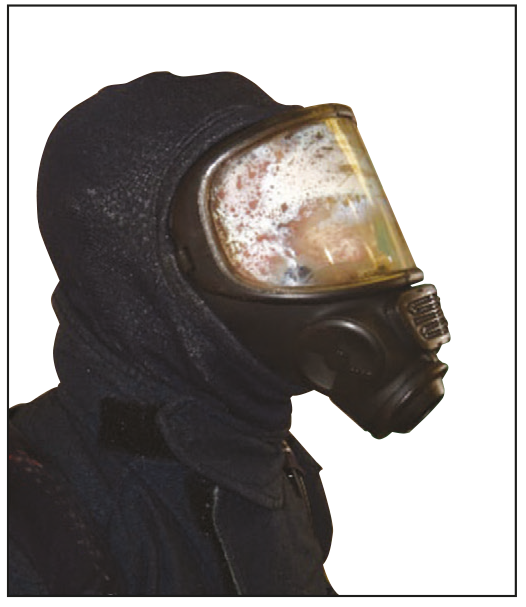

| Ordre | Masque à griffes (brides F1) |
| 1 | Positionner la cagoule de protection thermique |
| 2 | Positionner le casque |
| 3 | Positionner le masque complet de l'ARI et encliqueter les brides et faire en sorte de ne pas avoir de fuite en ajustant la cagoule. |


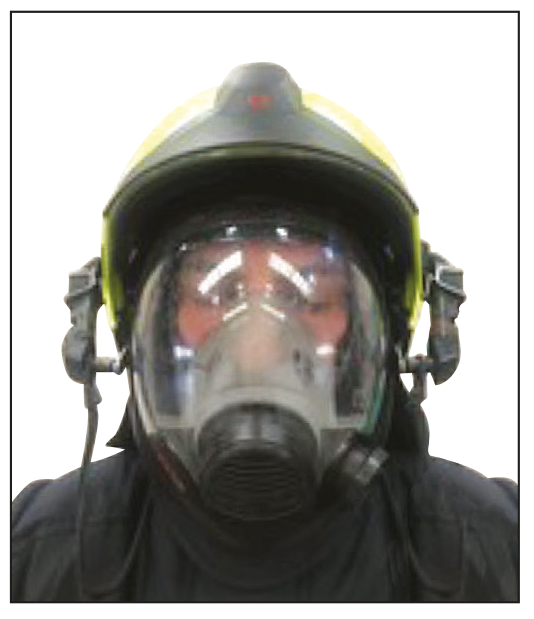



Le contrôle croisé intervient une fois l'habillage terminé. Il est obligatoire.
Il est réalisé en vis-à-vis, sous la responsabilité du binôme et validé par le contrôleur ou le chef d'agrès.
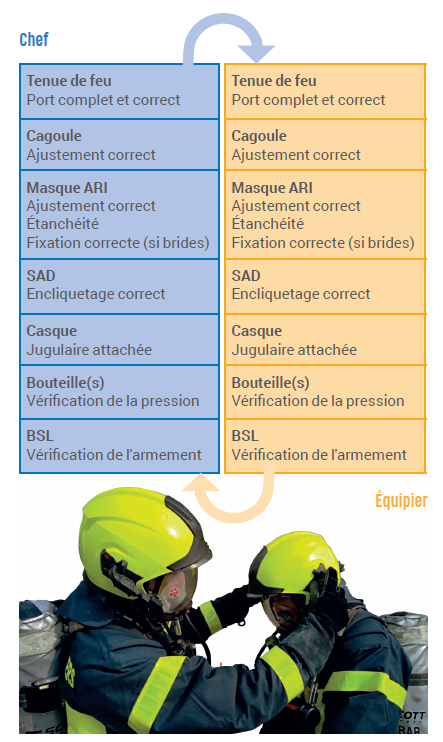
Le contrôle croisé valide les étapes d'habillage et garantit le niveau de protection du binôme.
Les personnels engagés doivent travailler en binôme. Ce binôme est composé d'un chef et d'un équipier.
Le binôme est indissociable. Un sapeur-pompier ne doit jamais s'engager seul.
Le travail en binôme est réalisé avec un contact permanent (physique, visuel ou verbal) entre les deux intervenants.
Avant leur engagement, le binôme vérifie l'état du matériel (ARI, exploration, etc.) et il procède aux vérifications individuelles lors du contrôle croisé.
Il établit avec le contrôleur un code de communication.
En cas d'évolution défavorable de la situation, le repli de tous les binômes est ordonné par la transmission du code général d'évacuation préétabli.
Il peut être réalisé par :
- un signal radio ;
- une corne pneumatique ;
- autres.
À ce signal, l'ensemble du personnel se désengage et se rassemble au point de regroupement prédéfini.
Après ouverture de leurs bouteilles, le binôme d'exploration doit capeler à l'air frais, et contrôler la pression au manomètre. Une fois capelés, les membres du binôme portent une attention particulière à leur consommation d'air.
Pendant leur progression, les porteurs d'ARI surveillent régulièrement leur autonomie.
Celle-ci doit permettre :
- la réalisation des trajets aller et retour ;
- l'exécution de la mission du binôme.
Si pour une raison indéterminée, un des sapeurs-pompiers n'est plus en mesure d'accomplir la mission, le sapeurs-pompiers n'est plus en mesure d'accomplir la mission, le binôme doit impérativement se replier

FT 2 PIC
RÔLE DU CONTRÔLEUR
Le contrôleur assure l'enregistrement des binômes. Il est chargé d'un seul point de pénétration (frontière entre la zone d'exclusion et la zone contrôlée). Il y assure la sécurité des binômes engagés.
Ce rôle peut être tenu par un chef d'agrès ou toute autre personne désignée par le COS, dans l'attente de la montée en puissance du dispositif.
Il doit :
- s'assurer du port correct des EPI, vérifier la réalisation correcte du RAPACE ;
- donner un indicatif radio à chaque binôme ;
- rappeler le code général d'évacuation* ;
- enregistrer les binômes avant leur engagement ;
- gérer au maximum 10 SP, soit 4 binômes et le binôme de sécurité ;
- assurer la gestion des reconnaissances (complète le tableau de contrôle) ;
- garder le binôme de sécurité à proximité immédiate, prêt à intervenir ;
- rester à l'écoute permanente des binômes engagés, si besoin, faire respecter le silence à proximité de l'accès à la zone d'exclusion ;
- rester en relation avec le COS et rendre compte de la situation au point d'accès du sinistre ;
- prendre sans délai les mesures d'urgence en cas de besoin et rendre compte au COS.
Il s'agit de la dernière étape de contrôle pour s'assurer d'un engagement sécurisé. Avant chaque engagement ou réengagement, le binôme doit s'enregistrer.
L'enregistrement se fait en zone contrôlée, auprès du chef d'agrès ou du contrôleur, à défaut par le binôme luimême (après avoir obligatoirement informé le chef d'agrès).
L'utilisation d'un tableau de contôle est préconisée.
Toutefois, tout autre support peut être utilisé (porte, mur…).
L'enregistrement comprend :
- l'identification des porteurs (noms) et la pression d'engagement ;
- l'inscription de l'heure d'entrée ;
- la remise des plaquettes d'enregistrement au chef d'agrès, au contrôleur ou laissées au point d'enregistrement (les clés des BSL se trouvant déjà dans les engins).
Tout au long de la phase d'engagement, le porteur d'un ARI contrôle et gère son autonomie
en air respirable.
Un engagement sous ARI comprend trois temps :
- temps « aller » ;
- temps « mission » ;
- temps « retour ».
Lorsque la pression dans la bouteille d'ARI descend en dessous de 55 bars environ, un
sifflet de fin de charge se déclenche, impliquant un retour systématique et immédiat du binôme
au point de pénétration.
* En cas d'évolution défavorable de la situation, le repli de tous les binômes est ordonné par la transmission du code général d'évacuation préétabli. À ce signal, l'ensemble du personnel se désengage et se rassemble au point de regroupement prédéfini.
FT 3 PIC
LE BINÔME DE SÉCURITÉ
Un binôme de sécurité est mis en place par le COS dès que possible lors de l'engagement d'une équipe en zone d'exclusion. Il est placé au niveau du point de pénétration en zone contrôlée. À défaut d'un binôme de sécurité, pour l'engagement limité d'un binôme d'attaque (BAT), le chef d'agrès peut assurer lui-même la sécurité du BAT, il reste en contact permanent et doit disposer d'un ARI.
Le binôme de sécurité est sous l'autorité du contrôleur
Formé au sauvetage de sauveteurs, son rôle principal est d'assister et de porter secours au(x) binôme(s) engagé(s). Dès sa mise en place, il signale sa présence par radio au(x) binôme(s) engagé(s).
Le binôme de sécurité dispose du même niveau de protection et d'équipement que les binômes engagés.
Un sauvetage peut justifier l'envoi
Dans ce cas, l'information du chef d'agrès est primordiale.
Le binôme de sécurité est amené à effectuer des missions particulières (sauvetages, extractions, secours, etc.). De fait, le COS doit choisir les personnels qui le constituent et leur rappeler le rôle prépondérant de cette fonction.
Pendant cette phase, les porteurs adoptent une position qui préserve leur potentiel physique tout en restant en alerte.
Durant cette phase, les deux personnels du binôme de sécurité doivent :
- se tenir à la disposition du chef d'agrès ou du contrôleur ;
- contrôler l'ouvrant d'engagement ;
- faciliter la progression et le repli des établissements ;
- assurer un contact avec les binômes engagés (visuel, radio…) ;
- assurer la pérennité de l'itinéraire de repli des binômes engagés ;
- veiller les alarmes sonores dans la zone d'exclusion ;
- faire remonter les informations au contrôleur.
Pour anticiper une éventuelle assistance au(x) binôme(s) engagé(s), le COS peut faire constituer un parc à matériel en fonction des outils disponibles :
- assistance respiratoire (ARI complet, cagoule de sauvetage…)
- moyens de forcement (halligan, ouvre-porte hydraulique, scie sabre…)
- moyen d'exploration (ligne guide, caméra thermique…)
- moyen d'évacuation (sangle, LSPCC…)
- moyen hydraulique (lance + tuyaux…)
- moyen d'éclairage (projecteur sur batterie, coudées…)
- tous autres moyens adaptés à la situation…
Pendant cette phase, le binôme de sécurité est équipé d'ARI en pression, la SAD encliquetée, le masque en attente, prêt à intervenir de façon immédiate.

Le binôme de sécurité est engagé sur ordre du chef d'agrès ou du contrôleur, dès que des difficultés sont rencontrées pour l'un des binômes engagés (compte-rendu radio sous la forme du NELAR, déclenchement du signal sonore de la balise de détresse...).
Les missions en phase « Action » du binôme de sécurité sont :
Des missions de sauvetage :
de victimes ; de sapeur-pompier(s) en difficulté.Des missions de soutien :
- aide à la sortie de victime ;
- assistance au binôme engagé (aide à la progression de tuyau, apport de matériels…).
Dès connaissance d'une difficulté ou d'un appel d'un binôme engagé, la mission du binôme de sécurité est de s'engager et de rendre-compte au chef d'agrès ou au contrôleur.
L'engagement d'un binôme de sécurité implique la désignation d'un nouveau binôme de sécurité en remplacement, au plus tôt.
FT 1 RECO
TECHNIQUES DE RECONNAISSANCE SOUS ARI
Références : GTO Engagement en milieu vicié
Dès que le binôme s'engage, il doit être enregistré auprès du contrôleur, détenir un moyen de communication, connaître l'itinéraire de repli et le code général d'évacuation.
Avant l'engagement, le sens « guide main droite » ou « guide main gauche » doit être défini au sein du binôme.
En entrant dans un local, les priorités sont de :
- lancer un appel verbal afin de localiser au plus vite une victime que serait encore consciente ;
- couper l'alimentation électrique sur ordre du chef d'agrès (…). En général, le disjoncteur se trouve dans l'entrée de l'appartement ou plus rarement à l'extérieur sur le palier.
En cas de découverte de victime, son sauvetage ou sa mise en sécurité doit être réalisé sans délai par tous les moyens à disposition (LSPCC, cagoule de sauvetage).
Si lors de la reconnaissance, le binôme découvre un danger (récipient sous pression, bouteille de gaz...), le chef d'équipe adaptera ses actions en fonction de son analyse de la situation et devra rendre compte sans délai au chef d'agrès.
Au cours d'une reconnaissance, le binôme doit :
- ouvrir tous les placards, rangements divers permettant d'accueillir une victime potentielle et relever les lits si nécessaire ;
- refermer la porte derrière lui (recloisonnement), et la consigner (FT méthodes de marquage) ;
- longer autant que possible les murs (risque d'effondrement). L'encadrement de la porte reste le lieu le plus sûr ;
- en présence d'un ciel gazeux chaud, privilégier une progression au plus proche du sol pour progresser en sécurité ;
- lorsque la visibilité est faible descendre les escaliers en marche arrière pour limiter les risques de chute.
La ligne guide ou la commande doit si possible être établie à hauteur de la taille, rester tendue et suivre scrupuleusement le cheminement utilisé par le binôme.
En cas de sortie ou de repli du binôme, la ligne guide doit être amarrée. Dans tous les cas, l'amarrage sera systématiquement vérifié par le chef d'équipe. Il peut, en fonction de la complexité et des difficultés lors de sa progression (changement de direction, clé de dérivation, obstacle…), rendre compte au contrôleur en utilisant son moyen radio.
La caméra thermique peut être employée lors des reconnaissances (recherche de victime, de foyer). D'autres outils peuvent être à disposition du binôme (Halligan, plan de masse, détecteur…).
Pour rappel, une commande, une ligne guide ou un moyen hydraulique forment avec la liaison personnelle la ligne de vie.
L'équipier est systématiquement relié à la ligne guide/commande/moyen hydraulique via sa liaison personnelle courte et garde un contact physique avec celui-ci.
Le chef d'équipe est systématiquement relié à l'équipier via sa liaison personnelle.
Le réengagement est conditionné par :
- l'autonomie en air ;
- l'état physique du binôme (validation par le chef d'agrès ou le COS).
En fonction de la situation rencontrée une ou plusieurs des techniques suivantes peuvent être employées.
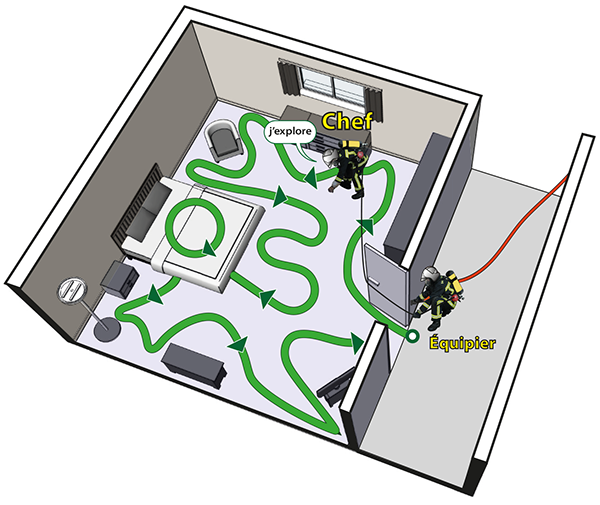
Lorsque le chef réalise la reconnaissance, l'équipier reste sur le seuil de la porte.
Elle consiste à explorer une zone située en parallèle de la première ligne guide établie. Par conséquent, la seule et unique mission du premier binôme sera d'établir la ligne guide. Il amarrera la ligne guide à l'extérieur du volume et progressera dans le volume en suivant un guide (mur par exemple). Le chef du binôme est relié à son équipier par sa liaison personnelle courte, tandis que l'équipier est relié à la ligne guide.
1. Le premier binôme s'engage
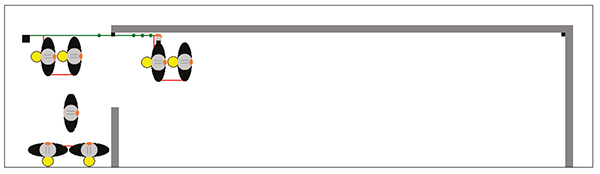
2. Le premier binôme amarre la ligne guide au changement de direction
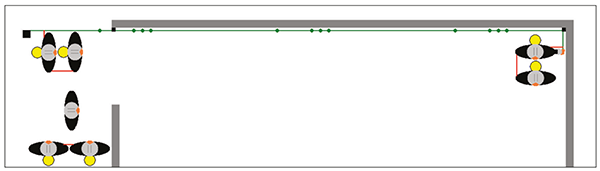
3. Le premier binôme continue d'établir la ligne guide, tandis que les suivants effectuent des reconnaissances latérales sur cette même ligne guide.
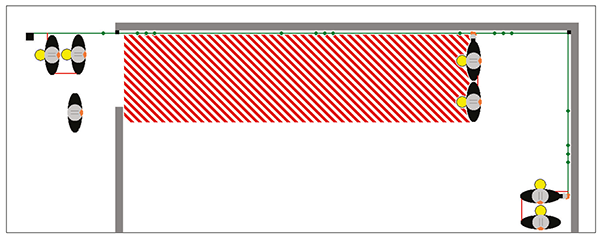
Son amplitude maximale est la longueur cumulée d'une liaison personnelle entièrement déployée et d'une liaison courte. L'équipier est en liaison courte et reste impérativement à la ligne guide, le chef est relié à son équipier, et peut se trouver à une distance de 6 m. Les deux sapeurs-pompiers gardent un contact verbal.
Les deux sapeurs-pompiers ne doivent jamais être en ! liaison personnelle longue en même temps.
Afin d'effectuer la reconnaissance de l'ensemble des locaux en un temps minimum, plusieurs binômes peuvent être amenés à travailler sur la même ligne guide. Des ramifications peuvent être installées à partir de la ligne guide principale à l'aide des dispositifs de dérivation.
Cette méthode consiste à explorer une zone de façon circulaire jusqu'à une profondeur correspondant à la longueur cumulée d'une liaison personnelle entièrement déployée et d'une courte, soit environ 6 mètres.
Le chef déroule d'une longueur de bras environ et maintient fermement sa liaison personnelle. L'équipier reste en point fixe et le chef se déplace de manière circulaire en gardant sa liaison personnelle tendue.
Arrivée au bout du volume ou de la partie à reconnaître, le chef revient à son équipier et ils continuent leur reconnaissance.
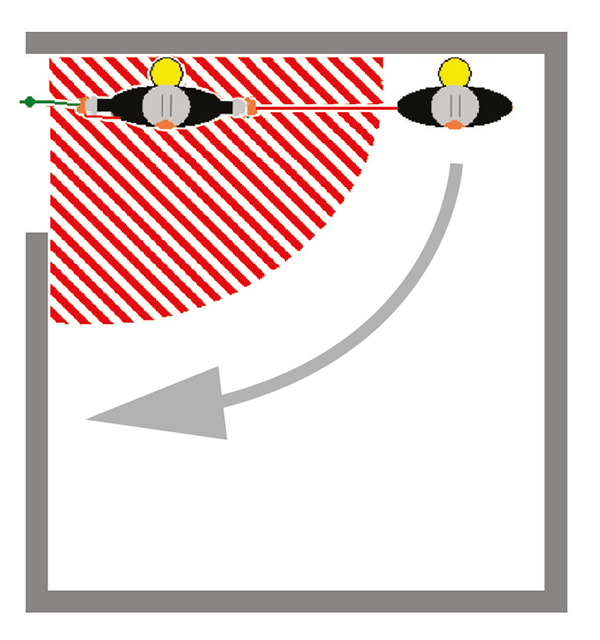
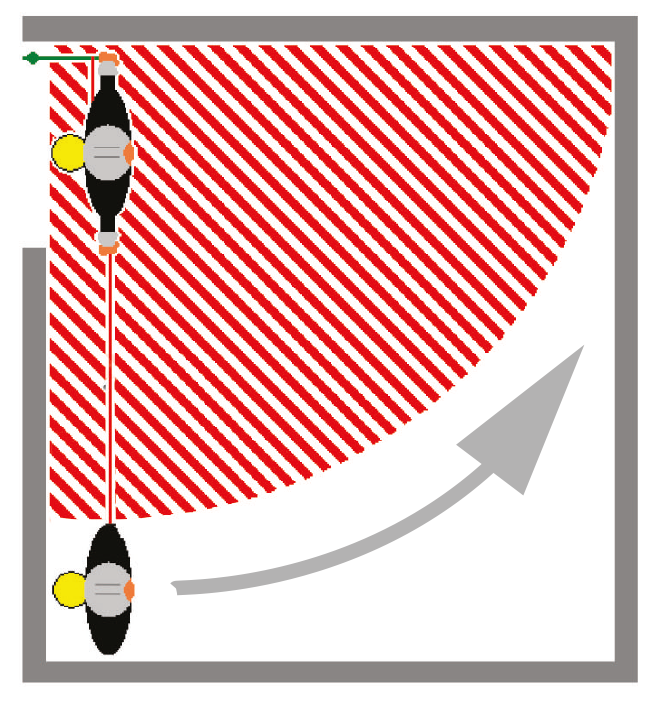
Dans un espace comportant des obstacles, cette technique peut être complétée par une méthode latérale.
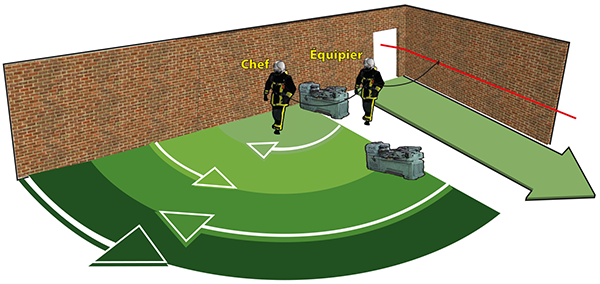
Une fois que la première ligne guide a été établie, il se peut que des pièces restent à explorer d'un côté ou de l'autre de celle-ci. Plusieurs binômes peuvent alors être engagés.
1.
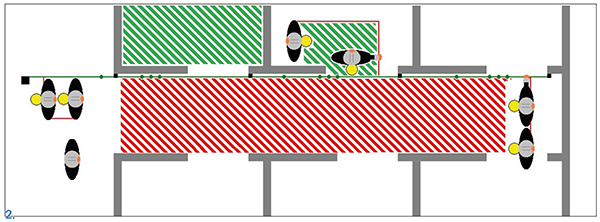
2.
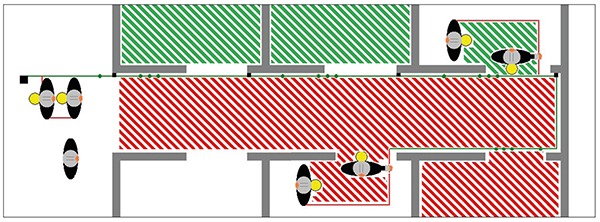
Afin d'effectuer la reconnaissance de l'ensemble des locaux en un temps minimum, plusieurs binômes peuvent être amenés à travailler sur la même ligne guide. Des ramifications peuvent être installées à partir de la ligne guide principale à l'aide des dispositifs de dérivation.

Le binôme sortant, se colle à la ligne guide et se baisse.
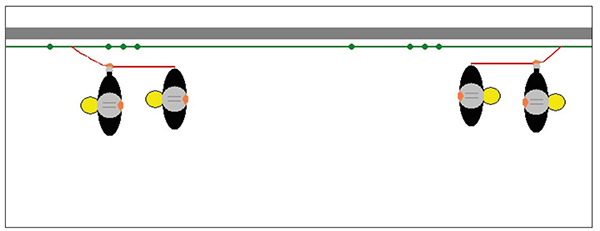
Le binôme entrant contourne le binôme sortant. L'équipier détache sa liaison personnelle sur ordre du chef lorsque celui-ci a en main la ligne guide, derrière le binôme sortant.
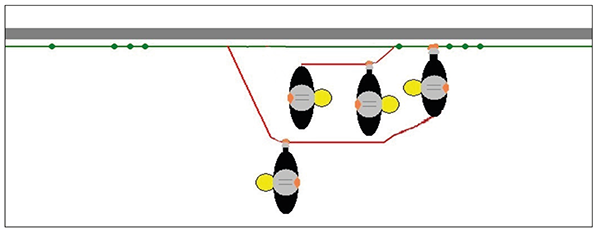
L'équipier du binôme entrant rejoint son chef et reconnecte sa liaison personnelle à la ligne guide.
Le binôme prioritaire ne se détache pas de la ligne guide, afin de ne pas perdre de temps. Le binôme sortant du volume est prioritaire sur le binôme entrant. Le binôme de sécurité est toujours prioritaire.
Lors de l'engagement avec la commande, seule la longueur maximale d'engagement diffère, les méthodes restent les mêmes.
La distance maximale d'engagement sera de 40 m à partir du point de pénétration. Le binôme peut se longer sur le tuyau en fonction de la situation. Seul le COS pourra valider un engagement au-delà.
Techniques d'amarrage sur le tuyau

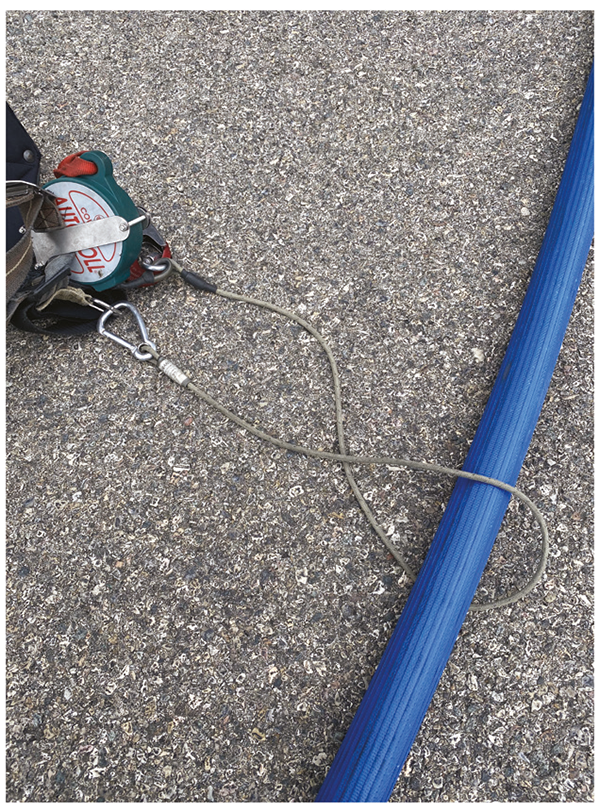

FT 2 RECO
LE COMPTE-RENDU D'UNE RECONNAISSANCE
À l'issue d'un retour d'engagement, un compte rendu doit être fait par le binôme au chef d'agrès ou au contrôleur.
Ce compte-rendu, graphique (schéma) et verbal a pour objectif d'expliquer et de clarifier l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la situation.
Dans ce compte rendu, les éléments suivants doivent ressortir :
- les accès (ceux empruntés et ceux possibles) ;
- le parcours emprunté (distance, obstacles, difficultés) ;
- les niveaux concernés et les pièces impactées (zone d'exclusion) ;
- les actions qui ont été menées ;
- les risques liés à la situation.
Pour permettre de retrouver l'ensemble de ces éléments dans un compte-rendu, un modèle peut se présenter sous la forme suivante :

Voici à titre d'exemple un compte rendu de retour d'engagement :
« Nous avons pénétré dans l'appartement totalement enfumé par la porte d'entrée main gauche.
Celle-ci donne sur un couloir long d'environ 6 mètres. Sur les côtés du couloir, Il y a trois pièces,
deux chambres à gauche et une salle de bain à droite. Le couloir donne sur un salon et une cuisine. La superficie totale est d'environ 60 m2.
L'ensemble du volume est enfumé et l'ambiance thermique n'est pas trop importante.
Nous avons procédé à l'extinction du foyer qui se trouve dans la cuisine. Il n'y a plus de risque de propagation.
Je propose de ventiler l'ensemble des pièces, pour permettre le déblai. »
Exemples de schéma
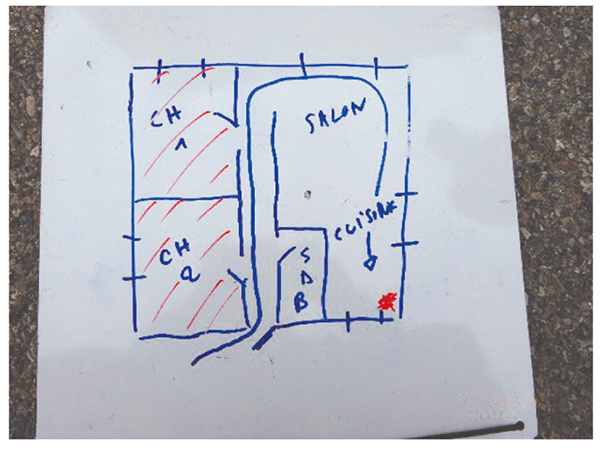
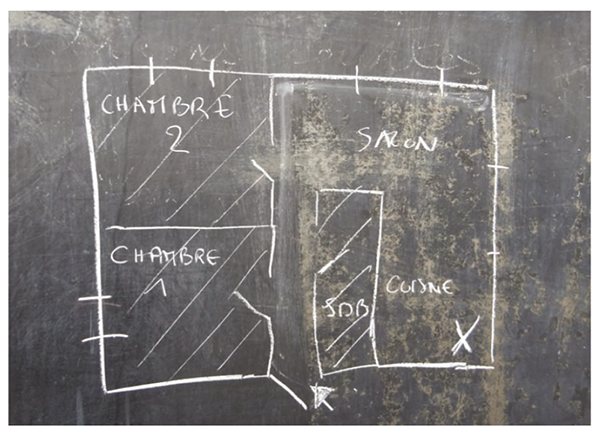
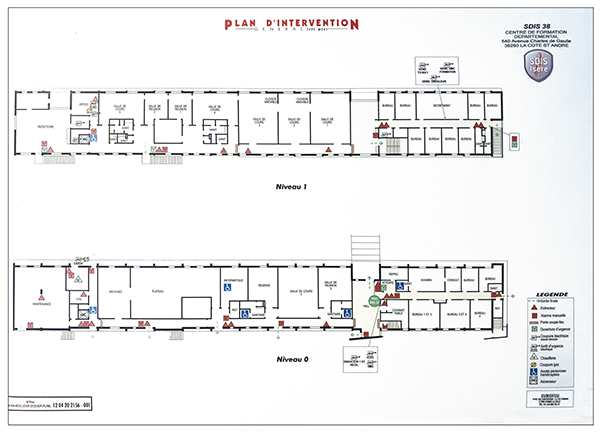
FT 3 RECO
RECONNAISSANCE D'UN IMMEUBLE
Lors d'une intervention pour feu dans un immeuble en général, le COS fait reconnaître les communications verticales. En fonction de l'ampleur du sinistre, il commande le recensement, l'évacuation ou le confinement des occupants. Afin que cette reconnaissance soit menée à bien, elle doit être faite de manière méthodique en respectant une certaine chronologie.
Ascenseur : le premier réflexe du binôme consiste à s'assurer que l'ascenseur est au rez-de-chaussée et que celui-ci est inoccupé et hors service.
Reconnaissance des niveaux : tous les paliers et parties communes doivent être reconnus et les binômes doivent frapper à tous les appartements en suivant une certaine chronologie :
- niveau concerné par le sinistre ;
- niveau directement supérieur au sinistre ;
- niveau supérieur de l'immeuble ;
- niveaux restant en partant du haut.
Schéma de principe de la chronologie des reconnaissances

Colonne sèche et humide : au fur et à mesure de leur progression dans les étages, les binômes vérifient la fermeture des robinets, de l'étanchéité et de l'intégrité de la colonne.
Ouvrants : sans ordre de la part du chef d'agrès, les binômes veillent à ce que tous les ouvrants donnant sur l'extérieur et toutes les portes palières soient fermés.
La gestion de la ventilation sur intervention reste de la responsabilité du COS.
FT 4 RECO
LES MÉTHODES DE MARQUAGE
Au fur et à mesure de sa progression, le binôme marque les portes des appartements visités au moyen d'une craie d'écolier uniquement.
-
Si personne ne répond, la porte reste vierge, aucune annotation
n'y est apportée.
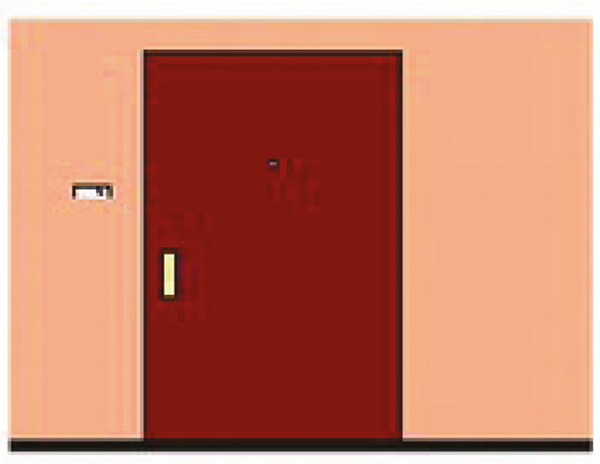
-
Si l'appartement est occupé, l'annotation « VU » doit être marquée
sur la porte, suivie de l'identifiant du binôme ayant effectué
la reconnaissance « fonction, engin ».
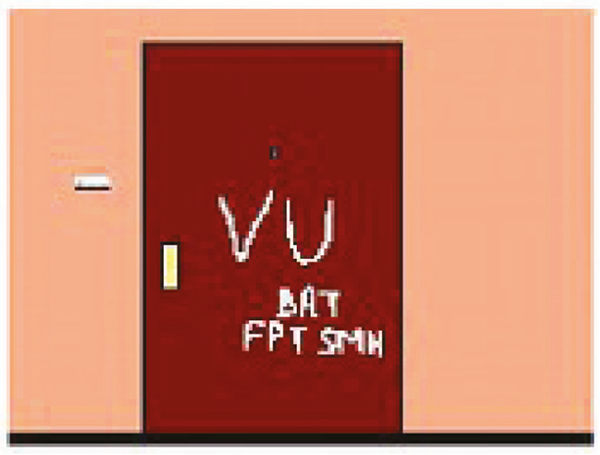
Le binôme consigne toute autre information importante (appartements non visités, nombre de personnes, d'animaux, personnes incommodées par les fumées, enfants en bas âge, asthmatiques, personnes impotentes...) dans un carnet et en rend compte au chef d'agrès si besoin.
FT 5 RECO
UTILISATION DE LA CAMÉRA THERMIQUE
Références : GUIDE OPS SDIS 38
Guide OPS M221 La procédure d'engagement caméra thermique
L'intensité du rayonnement infrarouge émis par la surface des matériaux traduite en image par la caméra dépend bien sûr de la température de surface mais également de l'émissivité propre à chaque matériau, c'est à dire sa capacité à émettre des infrarouges.
Afin d'effectuer une reconnaissance méthodique, trois zones doivent être définies.
En fonction de la situation et de la mission confiée, les zones seront balayées avec une priorisation différente.
La première zone dite haute, englobe le plafond et les angles de murs. Cette zone est reconnue par balayageafin d'estimer la température, ou encore la dégradation des matériaux.
La seconde zone dite médiane, contient le mobilier et les ouvrants potentiels.
Une troisième zone, dite "zone basse" est reconnue par balayage dans le cadre d'une recherche de victime ou de foyer.
Le champ de vision de la caméra thermique étant limité, il est indispensable de ne pas rester le nez collé sur l'écran et d'adopter un réflexe de vision périphérique, afin d'effectuer une reconnaissance efficace.
Le champ de vision naturel est réduit de par la pièce faciale de l'ARI et du champ de visée de la caméra (50 degrés).
Exemple : si nous comparons le champ de vision qui est offert à la taille d'une pièce d'une habitation, nous nous apercevons rapidement qu'il est impossible de voir la totalité du volume en une seule fois.
La température estimée d'une cible peut-être faussée par la qualité d'émission des rayons infrarouge des matériaux qui la composent (émissivité).
Une caméra thermique mesure le flux radiatif de la scène qu'elle vise. Cependant entre la scène et le détecteur de la caméra, un certain nombre de milieux ou d'éléments peuvent interagir avec le rayonnement thermique.
Lorsque qu'une mesure est effectuée avec une caméra thermique, la caméra ne perçoit qu'une partie du rayonnement qui est émis par la cible visée. En effet l'éloignement de la cible et la disposition géométrique entre la source et la cible sont des critères à considérer.
Attention aux fausses interprétations !
La caméra thermique reste un outil pouvant aider le personnel en situation opérationnelle. Elle ne se substitue en aucun cas à une analyse de l'utilisateur.
FT 1 AS
AUTO-SAUVETAGE
GÉNÉRALITÉS
Chaque année, plusieurs accidents graves provoquent la mort de sapeurs-pompiers.
Parmi ces accidents, certains ont une origine environnementale et d'autres humaine.
Les exemples de causes suivants illustrent l'importance de la formation sur l'auto-sauvetage :
- désorientation ou séparation d'un membre de l'équipe ;
- contraintes des nouvelles constructions (structures légères) ;
- fumée ou environnement dangereux (matériaux utilisés) ;
- bris d'équipement (accrochage) ;
- arrêt cardio-respiratoire (condition physique) ;
- erreur humaine (manque de connaissances ou d'entraînement) ;
- progressions rapides du feu (maisons BBC).
Situations problématiques
- embrasement généralisé
- explosion
- effondrement
- désorientation
- piégeage dans les fils et les câbles
- blessure / malaise
- bris d'équipement / fuite sur ARI
- manque d'air
- interruption de l'alimentation d'une lance
- en manoeuvre à l'intérieur
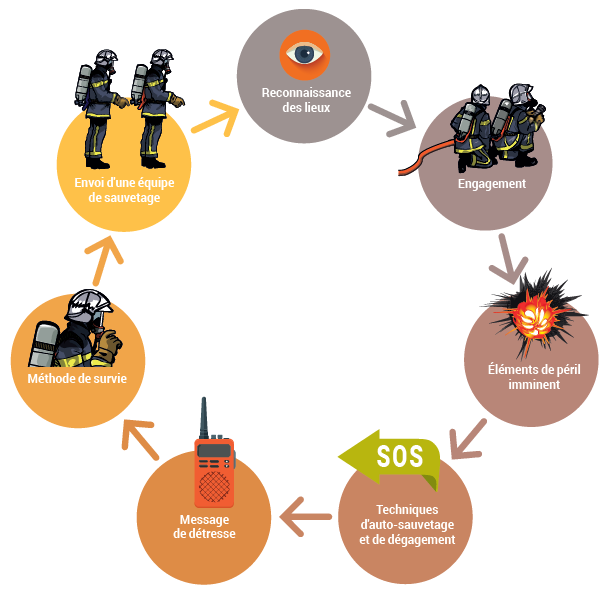
Définitions de l'auto-sauvetage
L'auto-sauvetage correspond à un ensemble de notions, comportements et techniques destinées à éviter de se mettre en danger, à s'extraire d'une situation de péril imminent ou à survivre pendant l'attente des secours.
Dès le départ, le sapeur-pompier doit prendre conscience que l'auto-sauvetage représente bien plus que des techniques. Il s'agit de développer une véritable compréhension des risques pour garantir sa propre sécurité.
L'attitude préventive est la clé du succès.
d'abord une question d'attitude !
- Porter ses EPI
- Toujours se munir d'un outil
- Anticiper les situations problématiques
- Évaluer les conditions du bâtiment avant d'y entrer (lecture du bâtiment)
- Reconnaître les signes de détérioration de la situation (cf. fiche lecture du feu FS 13 PG)
- Réfléchir avant de poser une action qui pourrait avoir des conséquences
- Savoir comment réagir (techniques d'auto-sauvetage)
- Être vigilant
Trois règles de base
- Ne jamais se trouver dans une position où l'on dépendrait de quelqu'un pour venir nous récupérer.
- Toujours connaître son itinéraire de repli.*
- Toujours connaître où se trouve son itinéraire de secours.*
* l'itinéraire de repli est le chemin d'accès initial, l'itinéraire de secours est un chemin supplémentaire en cas d'inefficacité ou d'obstruction de l'itinéraire de repli.

- l'alimentation (petit-déjeuner avant de prendre sa garde, alimentation équilibrée aux différents repas…)
- l'hydratation (hydratation régulière pendant toute la garde, surveillance de la couleur de l'urine, hydratation avant de partir au feu…)
- préparation physique générale (hors garde)
- préparation physique spécifique (opérationnelle)
- renforcement musculaire
- bonne nuit de sommeil avant de prendre la garde
- pas d'abus d'alcool
FT 2 AS
AUTO-SAUVETAGE
MESSAGE DÉTRESSE
- Perte des communications
- Interruption de l'alimentation d'une lance en manoeuvre à l'intérieur
- Désorientation
- Perte de coéquipier
- Malaise, inconfort
- Bris ou perte d'EPI
- Chute, blessure
- Manque d'air
- Piégeage (fils câbles ou autre)
- Dégradation des conditions de l'intervention (embrasement, effondrement…)
Comment savoir si je dois lancer un message de détresse ?
Réponse : « je me trouve dans une situation dangereuse de laquelle je ne peux m'extraire en 30 secondes »
- rester calme, ne pas paniquer ;
- rester avec son équipier et ne pas se dissocier ;
- vérifier son autonomie en air ;
- transmettre le message de détresse ;
- attendre la confirmation de la réception du message par le COS ;
- se signaler (balise sonore de localisation, faire du bruit, allumer son projecteur) ;
- chercher une zone refuge ou une sortie ;
- s'allonger perpendiculairement au mur pour faciliter sa localisation ;
- appliquer une méthode de gestion de l'air.
Message de détresse
« URGENT-URGENT-URGENT »
- Nom
- Engin
- Localisation
- Air
- Renforts nécessaires / Problématique Rencontrée
Si le binôme n'a pas de réponse à la suite de son message de détresse, il doit déclencher l'appel de détresse de son poste Antares (touche rouge du TPH700).
AIR
- Que puis-je faire avec l'air restant dans ma bouteille ?
- Quelle est la qualité de l'air ambiant : respirable ou pas ?
- Quelles actions puis-je prendre afin de minimiser ma consommation d'air ?
- Dois-je tenter une évacuation ou attendre les secours ?
OUTILS
- Quels outils puis-je utiliser ?
- Hache, Halligan, pince coupante…
- Comment peuvent-ils m'être utiles ?
- En posant un geste ou une action, quels en seront les bénéfices et quel en sera le coût en consommation d'air respirable ?
Réfléchir avant de passer à l'action
Est-il justifié de produire un effort intense pour s'en sortir seul rapidement ou dois-je passer en mode économie d'air pour donner du temps à d'autres sapeurs-pompiers de me venir en aide ?
Points à retenir
- Contenu complet du message (NELAR)
- Confirmation de réception du message
- Mise à jour de l'information selon l'évolution de la situation
FT 3 AS
AUTO-SAUVETAGE
AAALEERTER
La procédure AAALEERTER est un moyen mnémotechnique qui permet de rassembler l'ensemble des actions à faire lorsque l'on est en mode « survie ».
Le mode survie correspond à la période d'attente d'une équipe de sauvetage lorsque l'on est piégé ou perdu dans le bâtiment et que l'on a lancé un message de détresse.
Ce qu'il faut retenir
- Se positionner : allongé, perpendiculaire au mur, rechercher un ouvrant ou le tuyau…
- Se signaler : BSL, projecteur, faire du bruit, messages radio…
- Optimiser son air : techniques de respiration
| Air | Je regarde ma pression restante au manomètre |
| Alerte | Je passe un message d'alerte en applicant la procédure NELAR |
| ALarme | Je déclenche la BSL |
| Eclairer | J'allume mon projecteur |
| Economiser l'air | J'applique une méthode de gestion de l'air |
| Rester près du sol | Je me mets en position basse perpendiculairement le long d'un mur |
| Taper | Je fais du bruit |
| Explorer | Je balaye le sol pour retrouver le tuyau ou le mur pour trouver un ouvrant |
| Remonter la cagoule | Lorsque je n'ai plus d'air je remonte la cagoule sur le masque |
FT 4 AS
AUTO-SAUVETAGE
GESTION DE L'AIR
En cas d'événement imprévu, les sapeurs-pompiers peuvent être piégés.
Dans l'attente de l'arrivée du binôme de sécurité, les intervenants en difficulté doivent gérer leurs consommations d'air.
L'utilisation d'une technique de respiration a une incidence directe sur la consommation et donc sur l'autonomie en air pour le pompier piégé.
Afin de choisir la bonne technique de respiration pour gérer la consommation d'air, le sapeur-pompier doit évaluer s'il est en mode « effort intense » ou « économie d'énergie ».
- Un sapeur-pompier lors d'efforts intenses peut consommer de 90 à 100 l/min.
- La consommation moyenne d'un porteur ARI se situe entre 40 et 70 l/min.
- Un sapeur-pompier en mode économie peut réduire sa consommation jusqu'à atteindre entre 10 et 12 l/min.
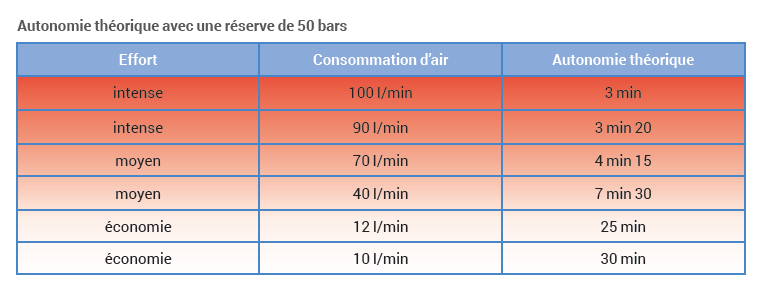
Il existe plusieurs techniques de respiration ayant pour but de réduire sa consommation en air :
- la méthode de Reilly ;
- la méthode de respiration en « carré » ;
- la méthode d'ouverture/fermeture du robinet en cas de bris sur l'appareil ;
- sauter une respiration.
1 Inspirer normalement.
2 Faire un bourdonnement tout en expirant lentement son souffle permettant d'augmenter significativement la durée d'expiration.
3 Recommencer le cycle.

1 Inspirer lentement sur une période de 5 sec.
2 Retenir son souffle sur une période de 5 sec.
3 Expirer lentement sur une période de 5 sec.
4 Retenir son souffle sur une période de 5 sec.
5 Recommencer le cycle.
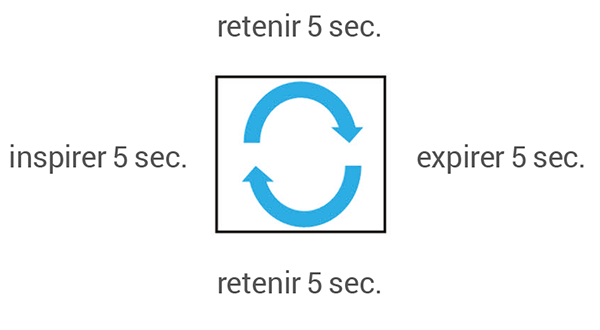
Le cycle représentant 20 secondes, cette technique permet de réaliser théoriquement 3 inspirations par minute.

Lorsque survient un bris d'équipement (partie faciale, tuyau, détendeur…), il peut être nécessaire de contrôler le débit d'air à partir du robinet de la bouteille.
1 Ouvrir le robinet de la bouteille et inspirer
2 Fermer le robinet de la bouteille et retenir sa respiration jusqu'au seuil de limite
3 Expirer lentement
4 Recommencer le cycle.
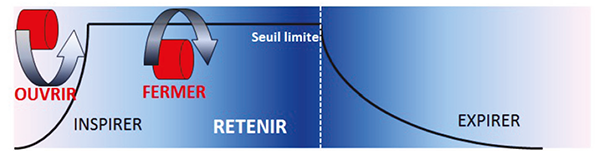
D'autres méthodes de respirations plus personnelles sont possibles, comme par exemple la technique qui consiste à sauter une respiration. Il est cependant recommandé de ne pas réaliser d'apnée prolongée en raison du risque de malaise.
FT 5 AS
AUTO-SAUVETAGE
PASSAGES ÉTROITS
Les techniques listées ci-dessous seront à utiliser lors d'une situation extrême d'auto-sauvetage.
Exemple d'enchevêtrement de fils et de câbles pouvant bloquer la progression.

Méthode
- progresser sur le flanc ;
- soulever les câbles avec son bras pour les faire glisser au-dessus de soi ;
- l'utilisation d'un outil (OFD, hache plate, Halligan Tool) permet également de soulever les câbles avec le manche.

Exemple d'ouvrant nécessitant des techniques pour se dégager rapidement

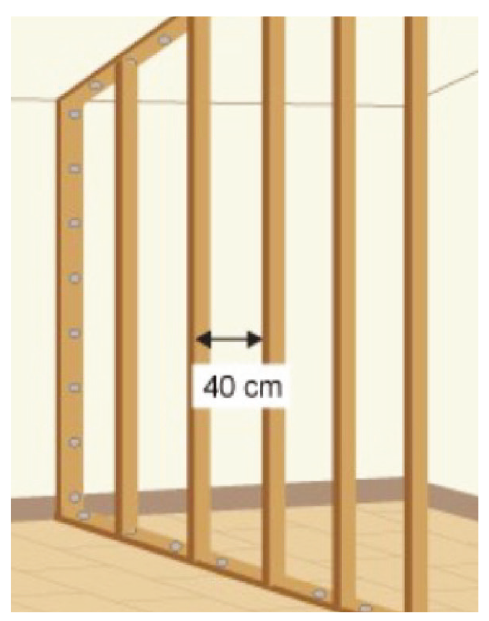
Face à l'obstacle

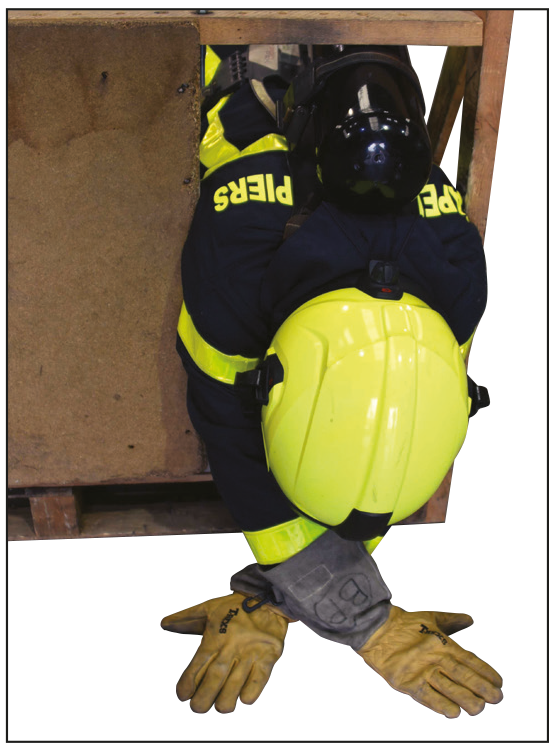
Méthode
- Comment savoir si l'on passe sans retirer l'ARI ?
- Positionner ses mains à plat pouces écartés.
- Croiser les bras afin de réduire la largeur des épaules.
Dos à l'obstacle

Méthode
- Se placer dos à l'ouverture ;
- engager dans l'ordre : bras / tête / bras.
Passage étroit horizontal


Méthode
- Desserrer une bretelle ;
- placer la bouteille sur le flanc ;
- s'engager à plat ventre.
En retirant totalement le dossard



Méthode
- Pour retirer le dossard en conservant la soupape à la demande, retirer la bretelle gauche, puis la droite ;
- 2 techniques pour remettre le dossard (comme une veste ou par-dessus la tête).
FT 6 AS
AUTO-SAUVETAGE
UTILISATION D'OUTILS
- Création d'une brèche dans un mur avec la hache / Bris de vitre.
- Évacuation depuis un sous-sol avec la hache ou l'Halligan Tool en marchepied.
- Sonder l'environnement au cours des reconnaissances / Tester la résistance du plancher.


Points à retenir
Progresser en milieu enfumé peut exposer les intervenants à des chutes de hauteur (garde-corps endommagés par l'incendie, escaliers difficilement visibles, plancher fragilisé)
L 'utilisation des outils pour sonder l'environnement limite ce risque :
- ils peuvent être une aide en cas de difficulté ;
- ils peuvent s'utiliser seuls ou les deux associés pour le forcement.

FT 7 AS
AUTO-SAUVETAGE
POSITION D'ATTENTE FENÊTRE
Dans l'attente de la mise en place d'une échelle à coulisse, le sapeur-pompier pris dans un embrasement peut adopter une position d'attente sur le rebord de la fenêtre. Elle permet de limiter l'exposition du corps au flux thermique.
Les moyens aériens, à l'issue des sauvetages et des mises en sécurité, peuvent être mis en oeuvre pour assurer
un itinéraire de secours

Points à retenir
Une main et une jambe en crochet à l'intérieur permettent de maintenir la position en limitant les efforts.
Important en formation
- Ne réaliser cette technique qu'en présence d'un formateur TASSS.
- Assurer les manoeuvrants contre les chutes (LSPCC, stop chute).
- Respecter les points-clés ci-dessus.
FT 8 AS
AUTO-SAUVETAGE
ITINÉRAIRE DE SECOURS
En cas de signes précurseurs d'effondrement de structure, d'évolution rapide et très défavorable du sinistre, de problèmes quelconques, les équipes engagées dans des bâtiments (binômes d'attaque ou de reconnaissance) peuvent avoir besoin de se dégager très rapidement du volume sinistré.
D'où la nécessité de prévoir des itinéraires rapides et sécurisés afin de quitter la zone.
Les binômes ont emprunté les communications existantes, des escaliers pour leur cheminement : c'est le premier itinéraire de repli, la marche arrière. Il a été reconnu et doit être libéré de toute entrave pour une évacuation rapide des lieux. Cet itinéraire est à utiliser prioritairement. Il permet le repli avec les moyens hydrauliques.
Dans certains cas, ce chemin normal, utilisé pour le cheminement initial n'est plus fonctionnel : obstacles, effondrement de la cage d'escalier, fumées trop importantes, flammes éventuelles, etc. Un « itinéraire de secours » doit alors être identifié par le COS.
Cette action doit être menée dès que possible.
Si le sinistre se trouve dans les niveaux supérieurs, les échelles à coulisse ou les moyens élévateurs aériens peuvent être dressés, afin de permettre aux personnels en danger d'y accéder. Il est nécessaire d'anticiper la création de ces itinéraires.
Au rez-de-chaussée, des itinéraires de secours peuvent être créés en déverrouillant les accès (portes de service, fenêtres) et/ou tronçonner les barreaux aux fenêtres.
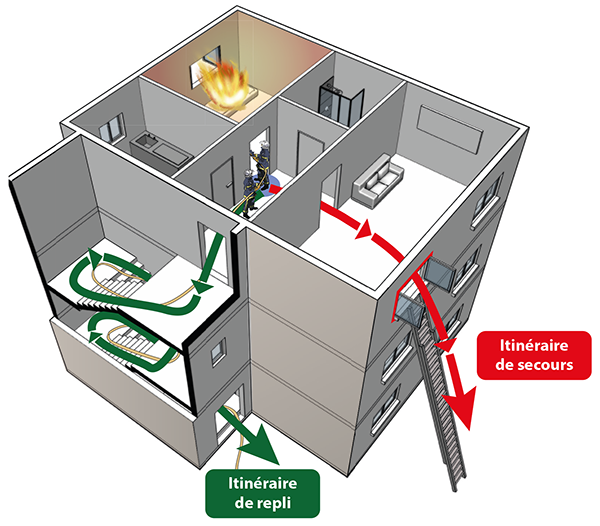
Positionnement de l'échelle à coulisse en configuration « Itinéraire de secours »
- Positionner les montants au ras de la fenêtre afin de pouvoir disposer de la totalité de l'ouvrant pour pénétrer et sortir du volume.
- Adoucir le pied d'échelle afin de faciliter une sortie en urgence.
- Assurer la stabilité de l'échelle (amarrage du pied d'échelle ou maintien à deux SP obligatoire)
- À défaut, si l'itinéraire de secours n'est pas évident, il convient de positionner l'échelle (aérienne ou à coulisse) en attente à proximité immédiate de la façade. Les binômes engagés sont informées de l'emplacement de l'échelle.
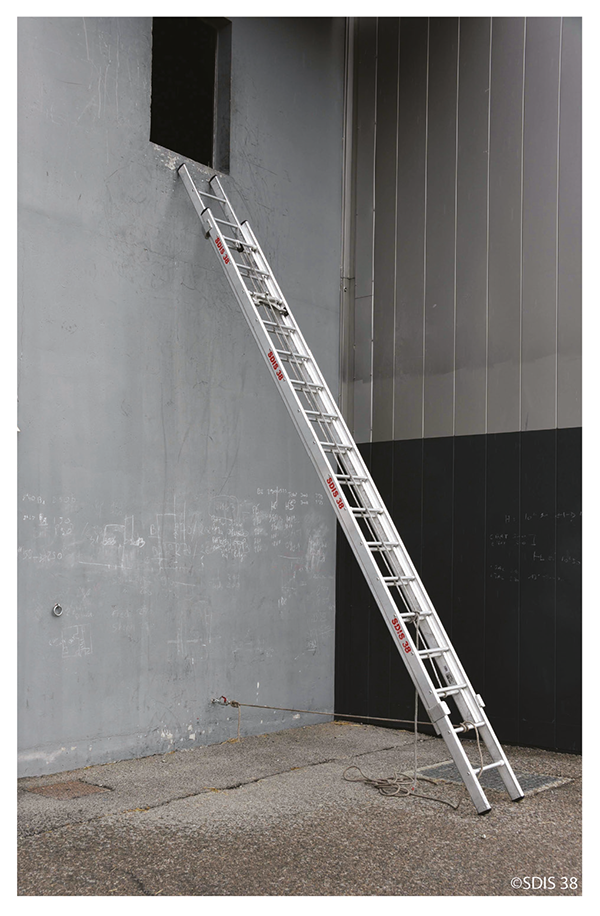
Important en formation
- Ne réaliser cette technique qu'en présence d'un formateur TASSS.
- Assurer les manoeuvrants contre les chutes (LSPCC, stop chute).
- Respecter les points-clés ci-dessus.
FT 9 AS
AUTO-SAUVETAGE
SORTIE D'URGENCE PAR UNE FENÊTRE SUR ÉCHELLE À COULISSE
Cette méthode est utilisée en cas d'évolution rapide du feu, elle permet de s'extraire en restant au ras de la fenêtre pour éviter la zone la plus chaude.
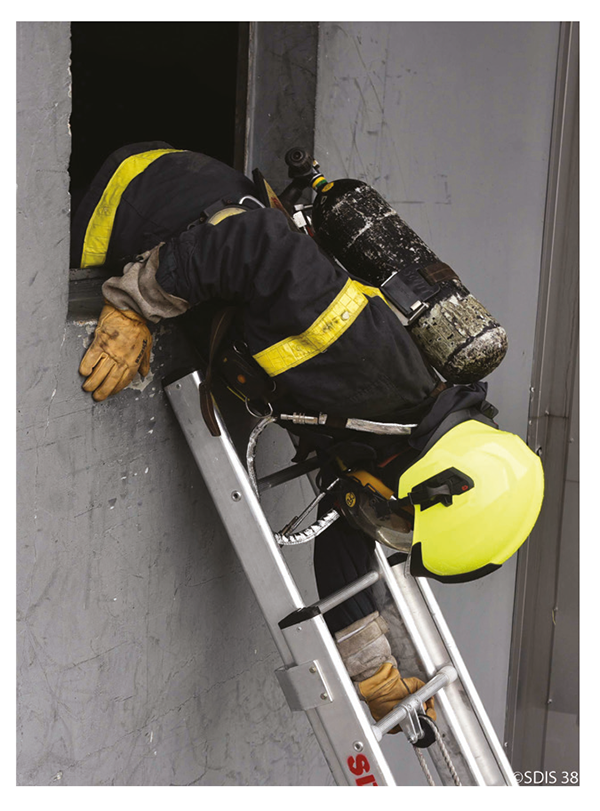
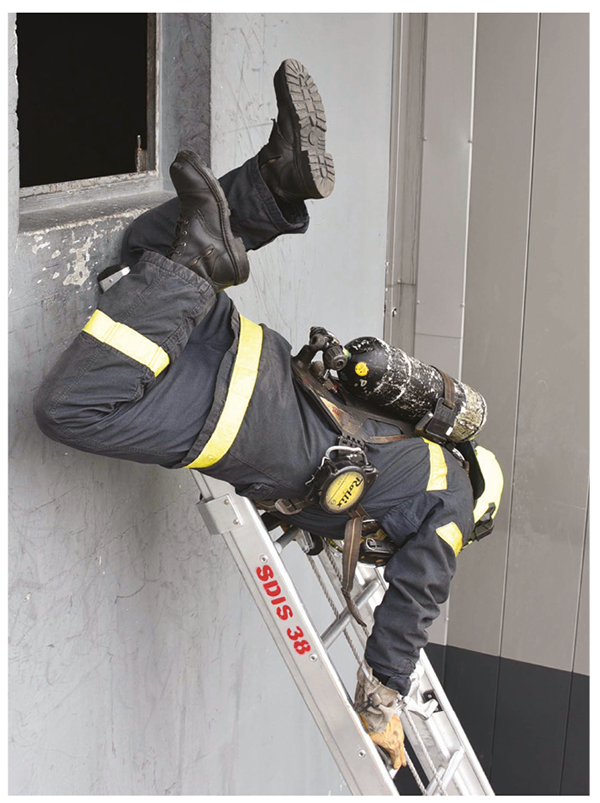

Points à retenir
- L'échelle doit être positionnée en itinéraire de secours (voir fiche FT 8 AS).
- Enrouler le bord de fenêtre.
- Pour se retourner placer 1 bras en supination (sous l'échelon) + 1 bras en pronation (2 échelons plus bas, du même côté).
Important en formation
- Ne réaliser cette technique qu'en présence d'un formateur TASSS.
- Assurer les manoeuvrants contre les chutes (LSPCC, stop chute).
- Respecter les points-clés ci-dessus.
FT 1 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
GÉNÉRALITÉS
En cas de péril imminent, mettant en jeu sa sécurité ou celle du binôme, tout sapeur-pompier doit être capable de s'extraire ou d'extraire son équipier d'un environnement dangereux (GDO Interventions sur les incendies de structures).
Les techniques de sauvetage de sauveteur permettent :
- d'être évacué rapidement par le binôme de sécurité par l'itinéraire de repli ou de secours ;
- de prendre en compte l'environnement immédiat pour mettre en pratique les techniques de déplacement et d'assistance en air ;
- d'évacuer son équipier par l'itinéraire de repli ou de secours en cas de sauvetage au sein même du binôme.
Rôle du binôme de sécurité
- La mise en place du binôme de sécurité doit être réalisée le plus rapidement possible.
- À disposition du COS ou du contrôleur, le binôme de sécurité est mobilisable immédiatement pour porter secours aux sapeurs-pompiers en détresse.
- Son rôle et ses missions sont définis dans la fiche FT 3 PIC.
FT 2 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
ABORDAGE
L'abordage correspond à la première étape de prise en charge d'un équipier blessé ou inconscient. C'est au cours de cette phase qu'un premier bilan de la victime va être réalisé avant de préparer le déplacement vers un point d'extraction.
Retourner la victime si elle est allongée sur le ventre.
Il est nécessaire de stopper l'alarme afin de pouvoir écouter ce que pourrait dire la victime ou encore passer un message de détresse par la radio.
Écouter en faisant une pause ventilatoire pour détecter le bruit d'une respiration dans l'ARI, ou appuyer sur la SAD quelques secondes pour déclencher un apport d'air continu.
Saisir le manomètre et lire la pression restante dans la bouteille. A la lecture de la pression correspond le degré d'urgence de la situation. En effet, si la pression dans la bouteille est faible, la problématique de l'autonomie en air de la victime va s'ajouter aux problématiques d'extraction.
L'assistance en air peut se réaliser entre équipiers au moyen des prises auxiliaires ou par le biais d'un ARI supplémentaire acheminé par l'équipe de sécurité.
Le conditionnement consiste à préparer la victime au déplacement dans le cas où le cheminement pour l'extraction est complexe (virages, escaliers, longue distance).
En passant la sangle ventrale de l'ARI sous la cuisse de la victime, et en serrant les bretelles dorsales de l'ARI, le harnais de l'ARI fait corps avec la victime, cela facilite l'extraction.


Il existe une technique simple pour faire demi-tour à un corps allongé au sol : relever les jambes à 90° en saisissant les chevilles et pivoter le tout à 180°.
Cette technique permet de déplacer un corps en limitant l'effort. Elle peut s'appliquer à un sauveteur comme à une victime.

Le retrait du dossard peut faciliter l'extraction de la victime en allégeant l'ensemble. Elle est envisageable dans certains cas :
- plus d'air dans la bouteille et assistance en air impossible ;
- obligation de passer dans des passages étroits ;
- extraction par un ouvrant permettant le passage à l'air libre.
FT 3 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
DÉPLACEMENT D'UNE VICTIME AU SOL
Avantages avec la sangle :
- sollicitation des membres inférieurs ;
- mains libres ;
- utilisation d'une sangle pour déplacer une victime sans harnais.
Traction d'une victime par la bretelle du dossard ARI.



Traction d'une victime non équipée d'ARI.


Traction de la victime par les bretelles du dossard ARI.

Utilisation de sangles pour faciliter le travail de déplacement.

Technique du « pousse et tire » : un sauveteur pousse (jambe de la victime sur son épaule) pendant que l'autre tire en saisissant une bretelle par une bretelle du dossard ARI de la victime. L'action se réalise de façon coordonnée.

En formation
Réaliser ces exercices sur sol lisse ou placer un tapis sous la victime pour préserver le matériel d'une usure prématurée.
FT 4 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
DÉPLACEMENT D'UNE VICTIME DANS LES ESCALIERS
Utilisation d'une sangle pour favoriser le travail au niveau des membres inférieurs du sauveteur à la tête. Le deuxième sauveteur place les jambes de la victime sur ses épaules.
La sangle est passée entre le dossard et la bouteille du sauveteur elle vient ensuite prendre les bretelles de l'ARI de la victime.
Sauveteur seul

2 sauveteurs
Cette méthode s'applique aussi à la descente

Technique de descente à 1 sauveteur : maintenir la tête de la victime pour protéger son rachis et rester le plus proche possible des marches en cas de chute.



En formation
Le formateur se place en parade pour éviter la chute d'un équipier.
FT 5 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
ÉVACUATION SUR UNE ÉCHELLE À COULISSE
Contexte
Ces techniques permettent l'évacuation d'un sapeur-pompier dans l'incapacité de s'extraire seul d'un bâtiment.
Elles sont une alternative dans le cas où la mise en oeuvre du LSPCC est rendue impossible : développement rapide du feu, forte chaleur, fumée importante.
-
L'échelle est positionnée en itinéraire
de secours (voir fiche technique FAS-8 Itinéraire de secours).
- L'équipe située à l'intérieur pose la victime sur le bord de fenêtre.
- Le sauveteur sur l'échelle saisit les jambes de la victime 1, les places sur ses épaules en tenant les montants de l'échelle 2.
- La descente est contrôlée en saisissant les montants, l'équipier peut se plaquer sur la victime pour freiner ou stopper la descente 3.



- Soulever le sapeur-pompier victime et le poser sur le bord de fenêtre 1.
- Transférer la victime en travers sur l'échelle 2.
- Le sauveteur sur l'échelle passe une main sous l'aisselle et l'autre main entre les cuisses.
- La descente est contrôlée en saisissant les montants 3.


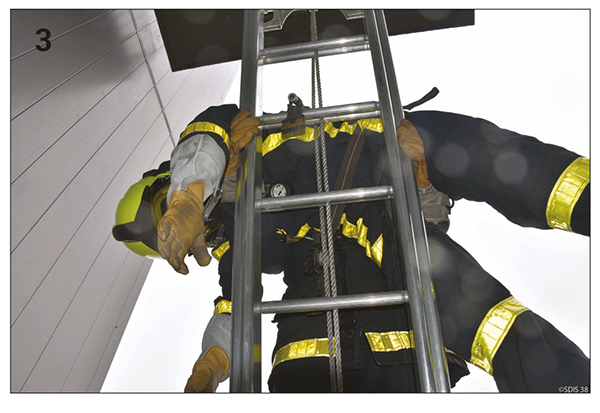
Important en formation
- Ne réaliser cette manoeuvre qu'en présence d'un formateur TASSS.
- Assurer les manoeuvrants contre les chutes (stop chute ou LSPCC).
- Assurer le maintien de l'échelle.
- L'équipe située à l'intérieur maintient l'équipier en difficulté jusqu'à ce qu'il soit correctement installé sur l'échelle.
FT 6 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
EXTRACTION AU MOYEN D'UN TUYAU
Cette technique consiste à se servir d'un tuyau en eau sous pression pour réaliser le dégagement d'un sapeur-pompier tombé dans une excavation de faible hauteur.
Une boucle du tuyau est envoyée par le trou au niveau de la victime et vient envelopper la victime munie de son ARI.
Il est possible de sécuriser l'ensemble tuyau-victime en utilisant une sangle de sauvetage.
Un sauveteur doit descendre au niveau de la victime pour réaliser les amarrages.
Cette technique permet d'assurer le dégagement d'un pompier inconscient avec seulement un tuyau, une sangle et des « bras ».


Description de la technique
1 Serrer la sangle ventrale de l'ARI.
2 Placer la boucle du tuyau en eau entre le dossard de l'ARI et le bas du dos de la victime.
3 Placer les bras de la victime à l'extérieur de la boucle.
4 Au moyen d'une sangle, à hauteur de la tête de la victime, solidariser les 2 brins du tuyau.
5 Tirer sur chaque brin du tuyau de façon coordonnée pour élever la victime verticalement.
Un minimum de 4 pompiers est nécessaire pour réaliser la remontée dans de bonnes conditions.
Important en formation
- Ne réaliser cette manoeuvre qu'en présence d'un formateur TASSS.
- Assurer les manoeuvrants contre les chutes (LSPCC, tapis).
- Respecter les points-clés ci-dessus.
FT 7 SS
SAUVETAGE DE SAUVETEUR
DÉSHABILLAGE
Le déshabillage d'urgence permet de prendre en charge un pompier en tenue de feu complète (avec ARI) victime d'un ACR, d'un malaise ou d'un coup de chaleur.
Pour être efficace, la technique nécessite au moins 2 sauveteurs. L'un s'occupe du haut du corps et l'autre du bas.
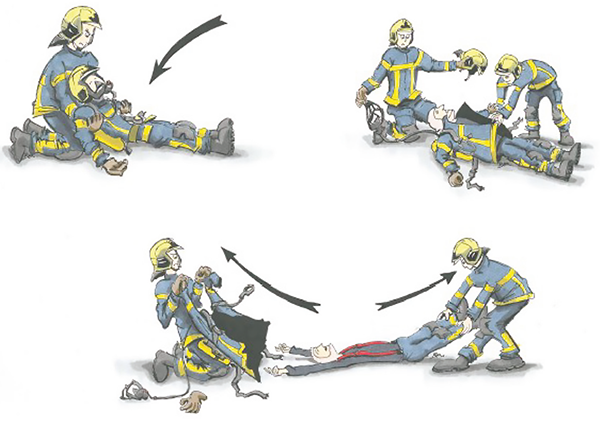
Equipier 1 :
- retire le masque et le casque de la victime ;
- retire les gants ;
- saisit les poignets.
Equipier 2 :
- desserre les sangles dorsales de l'ARI et retire la sangle ventrale ;
- ouvre la veste de feu ;
- saisit les chevilles et tire.
Remarque : pour un déshabillage d'urgence efficace, la fermeture éclair de la veste de feu doit être remontée sans activation du cran de secours.
FT 1 ETB
LES ÉTABLISSEMENTS DE TUYAUX
Un établissement est toujours relié à une prise d'eau désignée par le chef d'agrès.
Division
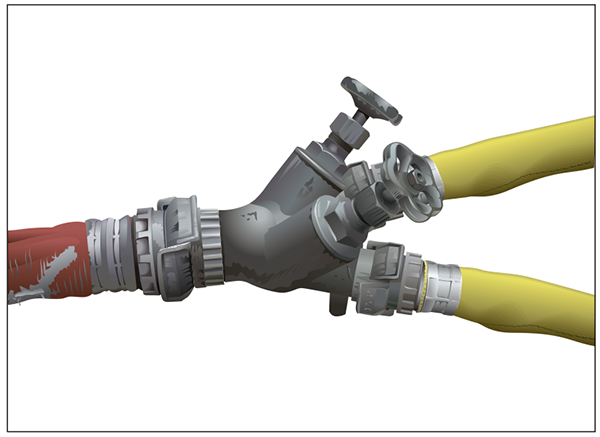
Engin

Poteau incendie

Colonne sèche
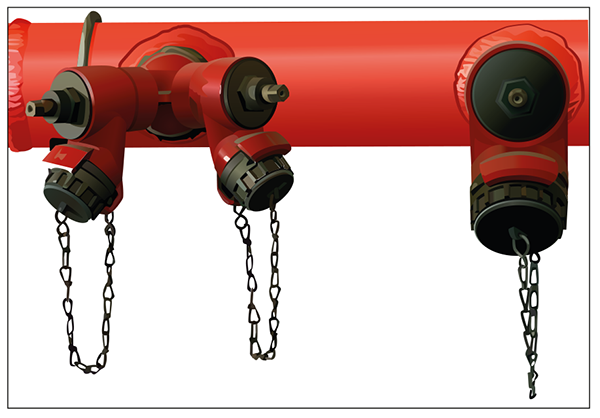
Il existe trois types d'établissements de tuyaux :
- Horizontal : les tuyaux reposent sur un sol horizontal ou sur un plancher.
- Vertical : les tuyaux s'élèvent dans une cage d'escalier, ou le long d'une paroi (mur, façade).
- Oblique : les tuyaux reposent sur un plan incliné tel qu'un escalier.
Établissement horizontal

Établissement oblique

Établissement vertical

Rappels
1 Les établissements sont réalisés en fonction des reconnaissances et des circonstances, du point d'attaque au point d'eau ou dans l'autre sens.
2 Les tuyaux peuvent être déroulés :
- de bas en haut, à l'aide d'une commande ;
- de haut en bas ;
- horizontalement.
3 En principe, les gros tuyaux sont établis à l'extérieur des bâtiments, sauf si les circonstances imposent le contraire.
4 Dans une maison d'habitation, en fonction de l'époque de construction, on compte par étage :
- 3 à 4 mètres de longueur de tuyau pour un établissement vertical ;
- 6 à 8 mètres de longueur de tuyau pour un établissement oblique.
5 Jusqu'au 3e niveau, il est généralement plus rapide d'établir par les communications existantes. Après il est possible d'établir par l'extérieur.
- employer le moins possible de tuyaux ;
- éviter l'enchevêtrement, les plis, les coudes, les torsions ;
- disposer d'une réserve au point d'attaque (au moins une longueur de tuyau) ;
- serrer le plus possible la bordure du trottoir ;
- éviter de couper les rues (emploi des dispositifs de franchissement) ;
- amarrer les raccords de tuyaux en cas d'établissement vertical, entre eux et à l'étage.
Règles pour la protection du matériel
- Faire attention aux matériels coupants, pointus et décombres brûlants.
- Mettre les établissements à l'abri de la chute des matériaux.
- Fermer et ouvrir doucement les vannes et robinets pour éviter les coups de bélier.
- En période de gel, tenir la lance partiellement ouverte.
- Éviter de détériorer les raccords.
FT 1 ETB
PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE
Selon les prescriptions du règlement opérationnel départemental, un engin peut-être servi (ou armé) par plusieurs binômes :
Engin à 4 : chef d'agrès / conducteur / un binôme.
Engin à 6 : chef d'agrès / conducteur / deux binômes.
Le chef d'agrès a la possibilité d'organiser le positionnement de ses binômes dans l'engin dans un objectif d'efficacité et de sécurité (motif de l'intervention et analyse de la ZI, agencement technique de l'engin).
Lors du déplacement vers le sinistre, le chef d'agrès désigne les binômes.
Schémas de principe de positionnement dans la cabine de l'engin
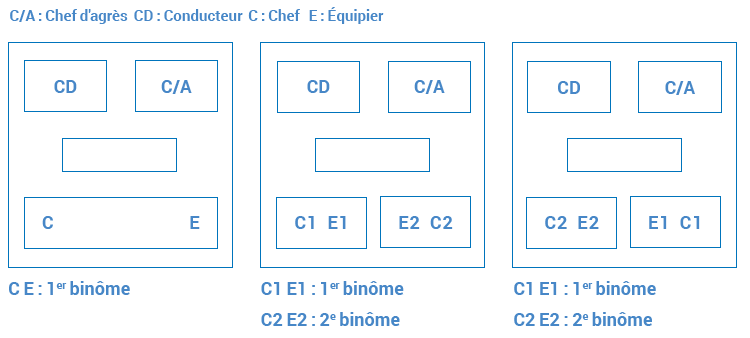
Sauf ordre contraire, au cours du trajet, le premier binôme s'équipe d'ARI.
Avant tout engagement le RAPACE doit être effectué. L'armement de la balise sonore de localisation (BSL) doit être réalisé à la descente de l'engin et la clé sera laissée dans celui-ci.
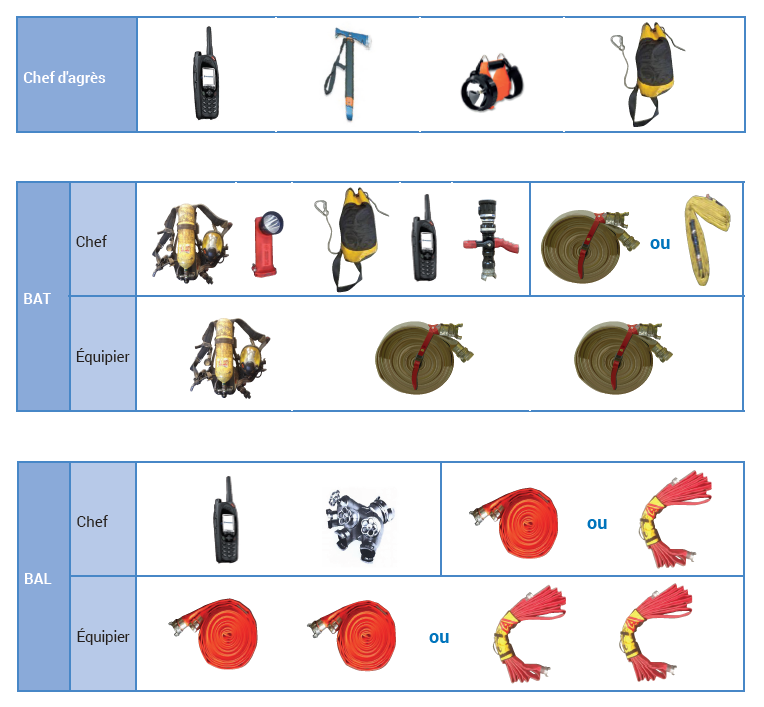
Remarque
Tout autre matériel supplémentaire (autres tuyaux, dévidoir, échelles, outil Halligan, caméra thermique…) sera pris sur ordre.
Emplacement : à l'adresse de départ en laissant la place au moyen aérien et en respectant les consignes de sécurité d'éloignement par rapport au feu.
Mission : sauvetages et attaque du feu.
Personnel : 1 chef d'agrès, 1 conducteur, 1 ou 2 binômes.
Alimentation : PEI ou alimentation par l'engin d'appui.
Emplacement : désigné en concertation avec le COS.
Mission :
- Prise de contact avec le COS avant toute action.
- Apporter si nécessaire une prise d'eau ou alimentation de l'engin d'attaque.
- Compléter l'action de l'engin d'attaque (marche générale des opérations).
Personnel : 1 chef d'agrès, 1 conducteur, 2 binômes.
Suivant la situation lors de la présentation de l'engin, le chef d'agrès peut effectuer sa reconnaissance seul ou avec son personnel, il dispose alors de deux types de commandement :
« Groupe de reconnaissance ! »
Le chef d'agrès effectue la reconnaissance avec le premier binôme équipé d'ARI.
« En reconnaissance ! »
Le chef d'agrès effectue la reconnaissance avec 2 binômes et leurs matériels de base. Le premier binôme devient BAT, le deuxième binôme devient BAL. Le choix du dispositif (en écheveaux ou roulés sur eux-mêmes) sera précisé par le chef d'agrès.
Si la situation le permet un ordre préparatoire peut être donné dans l'engin par le chef d'agrès.
Au retour de la reconnaissance, le chef d'agrès donne la fonction de chaque binôme suivant son idée de manoeuvre.
Les ordres pour la réalisation des manoeuvres doivent :
- être suffisamment précis pour qu'il n'y ait pas d'autre latitude d'action que celle voulue par le chef d'agrès. Les ordres doivent pour autant rester concis.
- correspondre en principe à une seule action. A l'issue de celle-ci ou en cas de besoin, les binômes rendent compte de leur action et peuvent se voir affecter une autre mission.
Commandements préparatoires
Ayant pour but de déclencher le réflexe de prise de matériel adapté pour chaque équipier et de solliciter le (les) binôme(s) concerné(s).
Exmple: « Binôme d'attaque et binôme d'alimentation, pour l'établissement d'une LDV 500 avec échele à coulisse, EN RECONNAISSANCE ! »
Le binôme d'attaque prend son matériel de base.
Le binôme d'alimentation prend l'échelle à coulisse.
Commandements de déplacement
Le personnel est rassemblé vers l'engin et a pris son matériel.
- À l'engin, « EN AVANT ! »
- Au point d'attaque, « HALTE ! »
Commandements exécutoires en règle générale
| Ce que je veux : QUOI ? | Ex : LDV 500, |
| À quel endroit : OÙ ? | Point d'attaque ici, |
| Accès : PAR OÙ ? | Prise d'eau la division mixte, |
| Mission : COMMENT ? | Attaque du foyer principal, |
| « ÉTABLISSEZ ! » | « ÉTABLISSEZ ! » |
Nota : au besoin le chef d'agrès précisera le débit dans son ordre executoire.
FT 2 ETB
LES TUYAUX EN ÉCHEVEAUX
L'ensemble des matériels mis à disposition dans les engins pompe constitue la boîte à outils du chef d'agrès. Suite à sa reconnaissance, selon son analyse de la situation et pour atteindre ses objectifs, il peut utiliser les tuyaux roulés sur eux-mêmes, les dévidoirs, ou encore les tuyaux en écheveaux pour les engins pompe qui en sont équipés.
Au sein du SDIS de l'Isère, plusieurs types de tuyaux en écheveaux sont utilisés :
- Les tuyaux dits « épaulés » : pliés en « O » pour le tuyau de 45 mm (1).
- Les tuyaux dits « épaulés » : pliés en « Z » pour tuyau de 70 mm (2).
- Les tuyaux dits « préconnectés » de 110 mm disponibles au sein du Dévidoir Automobile (3).



Les dispositifs « écheveaux » sont garants :
- de disposer d'une réserve pré-constituée au point d'attaque ;
- de rapidité et facilité d'utilisation ;
- des gestes et postures correctes tout en développant l'ergonomie des véhicules ;
- d'avoir les mains libres lors des phases de déplacement ;
- de l'établissement d'une division au plus près du sinistre ;
- de la coupure de l'alimentation à la division pour remplacer ou prolonger l'établissement ;
- de l'établissement d'une ligne de 70 mm en cas d'indisponibilité d'une colonne sèche ou humide ;
- de diminuer les pertes de charge et les « coups de bélier ».
L'établissement des tuyaux peut se faire du point d'attaque vers la prise d'eau ou inversement en fonction de la reconnaissance et de l'analyse de la zone d'intervention.
Il est indispensable de disposer d'un moyen radio pour sa propre sécurité et la mise en eau des établissements.
- Le chef d'agrès doit être vigilant lors de sa reconnaissance initiale pour adapter au mieux la manoeuvre selon la configuration des lieux.
- La complexité et la méconnaissance de certains bâtiments doivent faire l'objet d'une anticipation de sa part sur le nombre de tuyaux à utiliser et sur le sens d'établissement.
- Doit veiller à la permanence de l'eau et à garder en tout temps le contact radio avec son équipe.
-
Il lui revient d'évaluer les points suivants avant ses commandements :
- l'accès au bâtiment ;
- la distance entre l'engin-pompe et l'accès au bâtiment ;
- le type de cage d'escalier (avec un vide, demi-niveau, encloisonnée, ouverte sur l'extérieur…) ;
- la configuration des circulations (distance, compartimentées) ;
- la présence d'une colonne sèche ou d'une colonne humide ;
- le moyen hydraulique nécessaire selon l'incendie.
- Dans son ordre préparatoire le chef d'agrès devra préciser les types de tuyaux utilisés (écheveau ou roulés sur eux mêmes) ou dans son commandement de reconnaissance (exemple : EN RECONNAISSANCE avec les tuyaux en écheveaux).
Pendant la phase de reconnaissance initiale, le chef d'agrès doit être en mesure d'estimer rapidement le nombre de tuyaux nécessaires pour réaliser l'attaque.
Cette estimation est une base qu'il convient d'adapter aux configurations rencontrées.
Cette notion élémentaire doit être connue par l'ensemble des utilisateurs.
En règle générale, le nombre de tuyaux est obtenu de la manière suivante :
1 tuyau pour deux étages
+
1 tuyau au moins de réserve au point d'attaque.
Exemple : 4 étages = 2 tuyaux + 1 tuyau soit 3 tuyaux
Le tuyau en « O » permet une mise en oeuvre rapide, notamment par l'adoption d'une technique de pliage qui permet une mise en forme sous le seul effet de pression de l'eau.
Il permet de disposer d'une réserve efficace dans les endroits exigus tout en limitant la création de coudes (perte de charge), et de faciliter la progression des binômes grâce au déplacement du tuyau (système de ressort).
En cas d'établissement à l'intérieur d'un bâtiment, le chef d'équipe peut appliquer le tuyau au mur avant ouverture de manière à ce que le tuyau en « O » soit disposé sur champ lors de la mise en pression.
Dans le cas où le chef BAT souhaite rentrer la réserve dans le volume avec le tuyau sur le champ, il convient de dépasser l'ouvrant de 2 ou 3 mètres afin de limiter le risque d'obstruction de l'ouvrant et de blocage de l'itinéraire de repli en cas de chute du tuyau au sol.
Les avantages de rentrer le tuyau dans le volume sont :
- une meilleure gestion de l'ouvrant (contrôle de l'apport d'air) ;
- de rentrer l'ensemble du tuyau en une seule fois au sein du volume ;
- de limiter le dégagement des fumées dans les circulations ;
- une progression plus facile ;
- moins de risques de séparation du binôme.
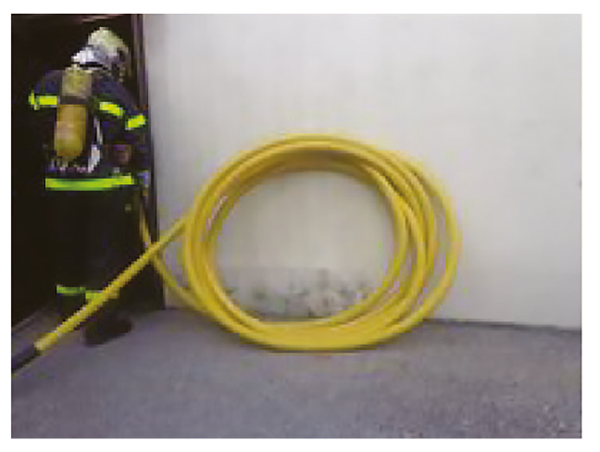
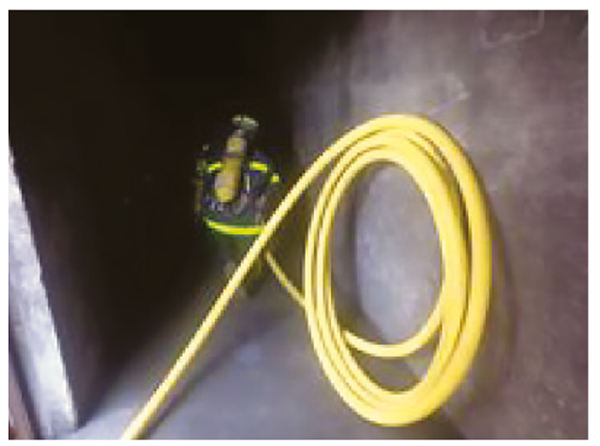
Ce tuyau sera utilisé à l'attaque. A l'emplacement désigné par le chef d'agrès, poser son tuyau et défaire les colliers ou les rubalises et écarter le tuyau afin qu'il prenne la forme d'un « O ».


Saisir la lance, placer au minimum un pied à l'intérieur du tuyau et ordonner l'ouverture de l'eau.

Surveiller la mise en pression
Remarque
Après la mise en pression du tuyau en « O » (lance fermée), chasser l'air et procéder au réglage du jet.
Vous disposez d'une réserve de 20 mètres sur un minimum d'espace et l'effet ressort garantit au porte-lance une progression plus rapide avec moins d'effort.
Pendant l'intervention le tuyau est facilement déplaçable et peut être positionné verticalement contre un mur pour faciliter le passage.
Se positionner à l'emplacement désigné.
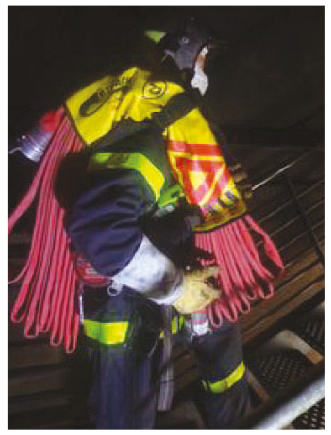
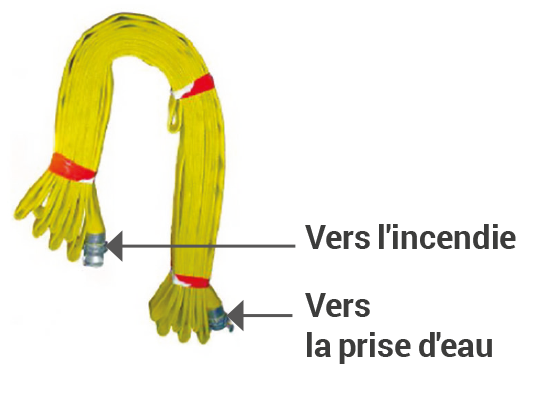
Défaire les systèmes de serrage du manchon afin de faciliter le déroulement du tuyau.

Effectuer le raccordement au demi-raccord du tuyau ou à la prise d'eau.

Maintenir le raccord ou la prise d'eau au départ et arranger la disposition des tuyaux au fur et à mesure du déroulement du dispositif.


Plusieurs techniques de pliage des tuyaux en écheveaux sont possibles. Les techniques seront choisies en fonction des contraintes techniques et du terrain.
Le tuyau de 70 est plié en « Z » et maintenu dans un manchon souple (ou rubalise) à poser sur l'épaule. Une poignée permet de le maintenir vers l'avant durant l'établissement.
Le tuyau de 45 est plié en « O » ; le serrage se fera par un collier ou de la rubalise.
Afin de faciliter le maintien sur l'épaule et éviter au mieux les contraintes lors des déplacements la mesure doit être comprise entre 1,65 m et 1,80 m.
Toutes les techniques de pliage des tuyaux en écheveaux sont réalisables à un ou deux sapeurs-pompiers.
- Vérifier l'état général du tuyau (propre et testé sous pression et présence des joints sur le demi-raccord).
- Veiller à chasser un maximum l'air tout au long du pliage.
- Réaliser des boucles de longueurs différentes pour réduire l'épaisseur de l'ensemble.
- Utiliser le système de serrage afin de permettre un bon maintien du tuyau.
- Vérifier la position des demi-raccords.
- Privilégier le pliage du tuyau sur un sol lisse afin de limiter l'usure de ce dernier.
Le pliage des tuyaux en écheveaux est un point essentiel au bon déroulement des manoeuvres.
« Plus il y aura d'air, plus le tuyau sera épais et instable à porter ».
Dérouler entièrement le tuyau afin de faciliter l'évacuation de l'eau et de l'air.
Positionner le manchon à hauteur du demi-raccord.

Mesurer deux fois la longueur du manchon.

Débuter le pliage en prenant soin de réaliser des boucles de longueurs différentes pour réduire l'épaisseur de l'ensemble.
Conserver une main en appui sur le tuyau afin de chasser l'air.

Plier la dernière boucle de manière à ce que le demi-raccord se positionne à l'extrémité opposée de celui posé au sol.

Fermer le manchon à l'aide des dispositifs de fermeture.
Attention à ne pas scratcher le manchon au maximum (difficulté d'établissement).

Dérouler entièrement le tuyau afin de faciliter l'évacuation de l'eau et de l'air.
Mesurer deux fois la longueur de la barre Halligan.
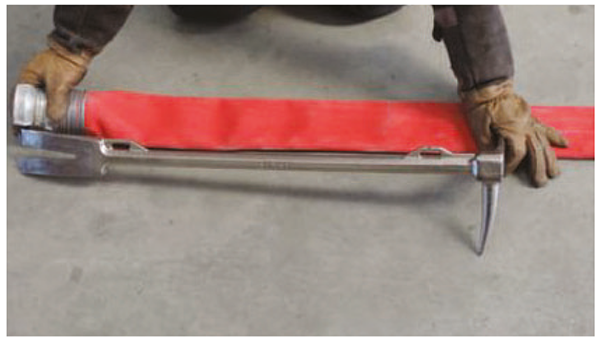

Débuter le pliage en prenant soin de réaliser des boucles de longueurs différentes pour réduire l'épaisseur de l'ensemble.

Conserver une main en appui sur le tuyau afin de chasser l'air.
Plier la dernière boucle de manière à ce que le demi-raccord se positionne à l'extrémité opposée de celui posé au sol.

Mettre le dispositif écheveau sur le manchon.
Fermer le manchon à l'aide des dispositifs de fermeture.
Attention à ne pas scratcher le manchon au maximum (difficulté d'établissement).

Dérouler entièrement le tuyau afin de faciliter l'évacuation de l'eau et de l'air.
Le pliage s'effectue, position à genoux, dos droit.
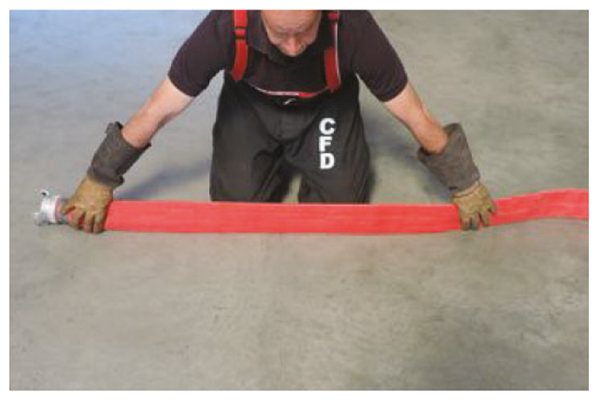
Placer le demi-raccord au niveau de la cheville.
Maintenir le demi-raccord et faire glisser le tuyau contre soi jusqu'à l'autre cheville.


Réaliser une première boucle et en la maintenant, repartir en sens inverse jusqu'au demi-raccord et répéter jusqu'au pliage complet.
Penser à réaliser des boucles de longueurs différentes afin de réduire l'épaisseur de l'ensemble.
Chaque extrémité doit avoir un demi-raccord, réajuster l'écheveau si besoin.

Mettre le dispositif écheveau sur le manchon.
Fermer le manchon à l'aide des dispositifs de fermeture.
Attention à ne pas scratcher le manchon au maximum (difficulté d'établissement).

Variante : si utilisation des colliers de serrage ou de la rubalise ; plier le tuyau et commencer la mise en place des colliers par le centre et aux deux extrémités.


Dérouler entièrement le tuyau afin de faciliter l'évacuation de l'eau et de l'air et connecter la lance.
Mesurer deux fois la longueur de la barre halligan à partir de la lance.

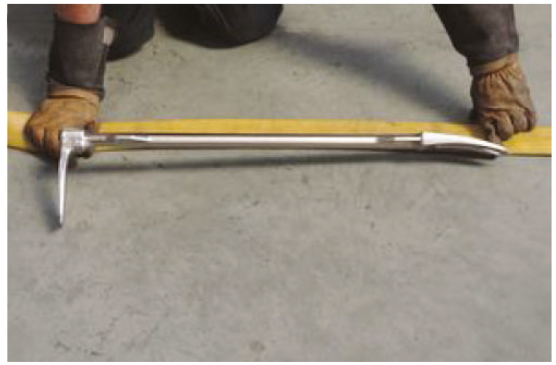
Aligner le tuyau en maintenant l'écartement et réaliser une première boucle vers l'intérieur du tuyau.

Enlever la lance en gardant la mesure.


Débuter le pliage en « O » demi raccord vers l'intérieur.
Maintenir la boucle, chasser l'air.
Reprendre le mouvement jusqu'au demi-raccord opposé.


Raccorder la lance à l'intérieur du dispositif en « O ».

Plier le tuyau afin de positionner les colliers de serrage ou de la rubalise afin d'anticiper sur la position « épaulé ».
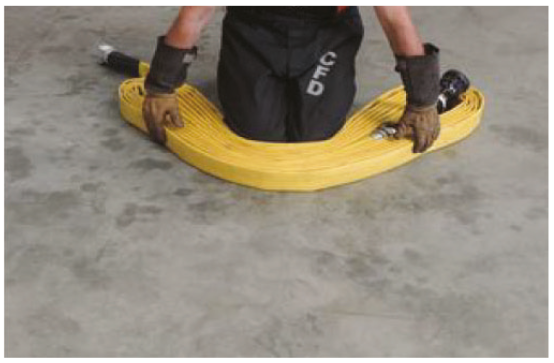
Finir la mise en place des colliers de serrage ou de la rubalise en commençant par le centre et aux deux extrémités.


Dérouler entièrement le tuyau afin de faciliter l'évacuation de l'eau et de l'air.
Mesurer deux fois la longueur de la barre Halligan.

Écarter le tuyau en maintenant le demi-raccord.

Faire pivoter l'ensemble afin de créer un espace pour connecter la lance.


Plier le tuyau afin de positionner les colliers de serrage ou de la rubalise afin d'anticiper sur la position « épaulé ». Finir la mise en place des colliers de serrage ou de la rubalise en commençant par le centre

FT 3 ETB
LES MANOEUVRES INCENDIE
| Binômes concernés | Manoeuvre | Nature |
| BAT | M 1 | Établissement de la LDT ou d'une lance sur dévidoir de 45 |
| BAL | M 2 | Alimentation d'une prise d'eau avec dévidoir |
| BAL | M 2 a | Alimentation d'une prise d'eau |
| BAL | M 2 b | Alimentation d'une prise d'eau au moyen de plus de 3 tuyaux en écheveau |
| BAT | M 3 | Établissement d'une lance à main |
| BAT et BAL | M 3 a | Établissement d'une lance par l'extérieur avec une commande |
| BAT et BAL | M 3 b | Établissement d'une lance avec une échelle |
| BAT et BAL | M 3 c | Établissement d'une lance de haut en bas |
| BAL | M 4 | Alimentation de l'engin |
| BAT et BAL | M 5 | Établissement d'une lance à mousse (engin sans injecteur fixe) |
| BAT et BAL | M 6 | Prolongement / remplacement d'un tuyau |
| BAT et BAL | M 7 | Établissement d'une lance canon |
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque, avec la LDT, ou la lance sur dévidoir de 45 EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! ». Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « LDT, point d'attaque…, accès…, mission…, ÉTABLISSEZ ! ». |
| Actions du binôme d'attaque | |
| Chef | Équipier |
|
|
|
|
|
|
Remarques
- Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'action, un ou plusieurs binômes peuvent s'intercaler judicieusement : l'ordre préparatoire devient : « Binôme d'attaque, binôme d'alimentation, avec la LDT, EN RECONNAISSANCE ».
- Le prolongement de la LDT reste le rôle du conducteur (dès que le 3e raccord est atteint).
- Le raccordement du dévidoir de 45 reste du rôle du conducteur.
- La manoeuvre avec le dévidoir de 45 peut être faite avec un tuyau en « O» »à ce moment la lance est enlevée et remplacée par le tuyau en « O ». Dans ce cas, la prise du tuyau en « O » sera précisée dans l'ordre préparatoire.
- Pour une lance, l'ouverture se fera sur ordre « OUVREZ » du chef BAT.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'alimentation, pour l'alimentation d'une division avec dévidoir, EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Division…, Emplacement…, Prise d'eau…, ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'alimentation | |
| Chef | Équipier |
|
|
|
|
|
|
Remarques
- Pour les établissements courts (moins de 60 m), le dévidoir sera remplacé par des tuyaux roulés sur eux-mêmes (cf. manoeuvre M2a).
- L'alimentation d'une colonne sèche ou d'une autre prise d'eau est possible avec cette manoeuvre.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'alimentation, pour l'alimentation d'une division, EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Division, Emplacement… (ici), Prise d'eau… (le fourgon), ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'alimentation | |||
| Chef | Équipier | ||
|
|
||
|
|
||
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « Z »
|
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « Z »
|
Remarques
- La manoeuvre tuyaux en écheveaux peut également être réalisée du point d'eau au point d'attaque (à l'inverse de la manoeuvre type).
- Pour les établissements longs (à plus de 60 m), les tuyaux roulés sur eux-mêmes ou en écheveaux seront remplacés par le dévidoir (voir manoeuvre M2).
- L'alimentation d'une colonne sèche ou d'une autre prise d'eau est possible avec cette manoeuvre.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'alimentation, pour l'alimentation d'une division, au moyen de plus de 3 tuyaux en écheveaux EN RECONNAISSANCE ». CONDUCTEUR : « VOUS ÉTABLISSEZ UNE DIVISION À 20 MÈTRES DE L'ENGIN ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Direction à atteindre…, Prise d'eau… (la division), ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'alimentation | |
| Chef | Équipier |
|
|
|
|
|
|
Remarques
- Le conducteur de l'engin positionne une division (prise dans un autre engin si besoin) à 20 m de son engin en direction du point d'accès ; cette dernière sera la première prise d'eau de l'équipier BAL.
- Cette manoeuvre est préconisée pour des accès difficiles (établissements rampants dans circulation verticale, front de neige, impossibilité d'utilisation du dévidoir ou d'une colonne sèche ou humide...), elle nécessite une reconnaissance approfondie, ainsi qu'une bonne communication entre les différents intervenants.
- Ces établissements longs (à plus de 80 m) peuvent être complétés par un autre BAL ; dans ce cas les CA prendront soin de se concerter afin de coordonner la manoeuvre.
- Attention : cette manoeuvre demande une communication permanente entre les différents intervenants avec utilisation des moyens radios. La mise en eau de l'établissement se fait au fur et à mesure dès la mise en place d'une division.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque, pour l'établissement d'une lance, EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Lance, Point d'attaque (ici), Prise d'eau..., Accès..., mission..., ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'attaque/td> | |||
| Chef | Équipier | ||
|
|
||
|
|
||
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « O »
|
|
|
|
|||
Remarques
- Pour les établissements de 45 et sous certaines conditions favorables (plein air, ARI non coiffé) le BAT peut établir deux lances (chef : 1re lance et après l'équipier : 2e lance).
- Le moyen hydraulique peut servir de ligne de vie.
- Pour l'établissement d'une lance à mousse, le chef d'agrès précisera dans son commandement préparatoire « BAT, pour l'établissement d'une lance à mousse ou d'une lance avec embout polymousse en reconnaissance » et dans l'exécutoire le débit de la lance et le foisonnement à adapter.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque et binôme d'alimentation, pour l' établissement d'une lance par l'extérieur avec la commande EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Une lance par l'extérieur, Emplacement pour être hissée…, Point d'attaque (l'étage, etc.), Prise d'eau…, Accès…, Mission…, ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'attaque | Actions du binôme d'alimentation | ||||||
| Chef | Équipier | Chef | Équipier | ||||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « O » |
|
Tuyaux roulés sur eux- mêmes
|
Tuyau en « O » |
|
||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
Remarques
- Amarrer la partie haute de l'établissement à l'étage.
- Si possible, amarrer les tuyaux de l'établissement entre eux.
- Si un seul binôme est disponible, le chef suivra le chef d'agrès à l'étage au commandement exécutoire, l'équipier restera au RDC pour faire l'établissement et accrocher la lance ou le demi raccord à la commande.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque et binôme d'alimentation, pour l'établissement d'une lance avec l'échelle à coulisse EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Emplacement de l'échelle pour être dressée..., lance, Point d'attaque…, Prise d'eau…, Accès…, Mission…, ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'attaque | Actions du binôme d'alimentation | ||||||
| Chef | Équipier | Chef | Équipier | ||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « O »
|
|
|
|
|||
|
|||||||
Remarques
- Amarrer la partie haute de l'établissement à l'étage.
- Si possible, amarrer les tuyaux de l'établissement entre eux.
- L'échelle doit être considérée avant tout comme un moyen d'accès.
- Si l'échelle doit servir temporairement de point d'attaque, celle-ci et le porte lance devront être amarrés.
- Si un seul binôme est disponible, après avoir apporté son matériel, l'équipier du BAT s'occupera de l'échelle à coulisse, le chef établira seul.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | Préparatoire « Binôme d'attaque et binôme d'alimentation, pour l'établissement d'une lance de haut en bas et l'alimentation d'une division. EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « BAL Division…, Prise d'eau…, ETABLISSEZ ». À l'étage, « BAT, Une lance, Point d'attaque…, Prise d'eau…, Accès…, Mission…, ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'alimentation | Actions du binôme d'alimentation | ||||||
| Chef | Équipier | Chef | Équipier | ||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
Tuyaux roulés sur eux-mêmes
|
Tuyau en « O »
|
|
|
|
|||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Remarques
| Commandements chef d'agrès | |
| Exécutoire | « Binôme d'alimentation, ALIMENTEZ l'engin ». |
| Actions du binôme d'alimentation | |
| Chef | Équipier |
|
|
Remarques
- Le chef d'agrès désigne la prise d'eau.
- Attention : si l'alimentation est inférieure à 20 m, le conducteur l'effectue à l'aide de tuyaux roulés sur eux-mêmes.
- Si l'alimentation est inférieure à 60 m, le binôme d'alimentation l'effectue avec des tuyaux roulés sur eux-mêmes, sans oublier le matériel BI/PI préparé par le conducteur.
- L'alimentation de l'engin est possible par l'établissement (manoeuvre combinée M2 et M4).
- En aspiration, l'alimentation est effectuée par le conducteur aidé d'un binôme d'alimentation par ligne d'aspiration.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque et binôme d'alimentation, pour l'établissement d'une lance à mousse, ou polymousse, EN RECONNAISSANCE ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | Exécutoire « Une lance à mousse, Débit…, Point d'attaque…, Prise d'eau…, Accès…, Mission…, ÉTABLISSEZ». |
| Actions du binôme d'attaque | Actions du binôme d'alimentation | ||
| Chef | Équipier | Chef | Équipier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques
- Le BAL se chargera de l'alimentation en émulseur et du fonctionnement de l'injecteur.
- Si la prise d'eau est l'engin, l'injecteur sera raccordé à celui-ci au moyen du tuyau d'au moins deux mètres.
- Si un seul binôme est disponible, le fonctionnement de l'injecteur et l'alimentation en émulseur seront assurés par le conducteur (distance maxi entre l'engin (prise d'eau) et la lance à mousse de 60 m).
- Si l'alimentation d'une prise d'eau est nécessaire, l'ordre devient : « BAT et BAL, pour l'établissement d'une lance à mousse et l'alimentation d'une prise d'eau, En Reconnaissance ! ». Le BAL prend son matériel de base, alimente une division (soit : M2, M2a ou M2b). Le BAL retourne à l'engin et monte les bidons d'émulseur à l'injecteur. Le chef BAL assure le fonctionnement de l'injecteur et l'équipier BAL le ravitaillement en émulseur.
| Commandements chef d'agrès | |
| Il n'y a pas d'ordre du chef d'agrès. Le binôme agit de sa propre initiative. | |
| Actions du binôme | |
| Chef | Équipier |
|
|
Remarques
- Le binôme procédera de manière identique pour le remplacement d'un tuyau (le tuyau sera déroulé parallèlement au tuyau endommagé).
- Le binôme agit de sa propre initiative à la vue d'un tuyau percé ou d'un établissement trop court.
| Commandements chef d'agrès | |
| Préparatoire | « Binôme d'attaque, pour l'établissement d'une lance canon au débit de… au moyen de deux lignes d'alimentation EN RECONNAISSANCE ». « Binôme d'alimentation Alimentez l'engin pompe ». |
| Déplacement | À l'engin : « EN AVANT ! » Au point d'attaque : « HALTE ! ». |
| Exécutoire | « Lance canon…, Débit…, Prise d'eau…, Mission…, ÉTABLISSEZ ». |
| Actions du binôme d'attaque | Actions du binôme d'alimentation | ||
| Chef | Équipier | Chef | Équipier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Remarques
- Le matériel (tuyaux et lance canon avec collecteur raccordé) est positionné sur le dévidoir pour aller au point d'attaque. Les tuyaux de 70/20 m servent de réserve à la lance afin de faciliter un déplacement si besoin.
- Attention : si l'alimentation de l'engin est inférieure à 20 m, le conducteur l'effectue à l'aide de tuyaux roulés sur eux-mêmes.
- Si l'alimentation de l'engin est inférieure à 60 m, le binôme d'alimentation l'effectue avec des tuyaux roulés sur eux-mêmes, sans oublier le matériel BI/PI préparé par le conducteur.
- Si l'engin incendie est intégré dans un dispositif avec une cellule émulseur (CFEMU), la manoeuvre M61 du GDR « GROUPE D'APPUI INCENDIE » s'applique pour l'établissement d'un canon à mousse.
| Thèmes | Binômes | Matériel | Observ. | Dispositif binôme manoeuvre à réaliser |
| Établissement de la LDT ou lance sur dévidoir de 45 | BAT | LDT ou lance sur dévidoir de 45 | 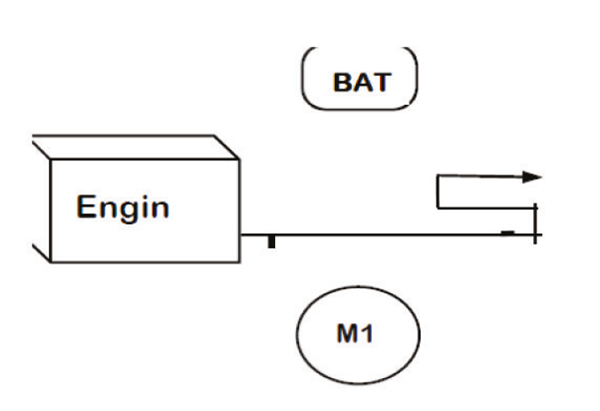 |
|
| Établissement de la LDT ou lance sur dévidoir de 45 avec cheminement difficile | BAT BAL |
LDT ou lance sur dévidoir de 45 | BAL sans matériel | 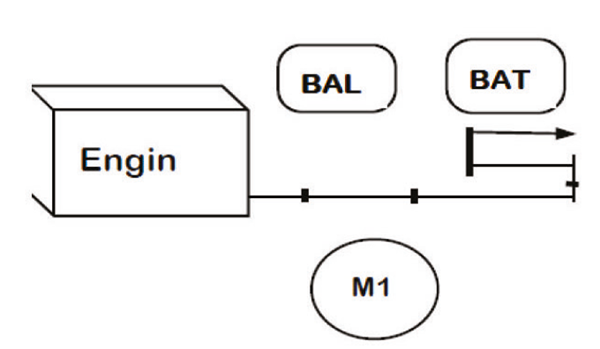 |
| Établissement d'une lance à main directement sur une prise d'eau | BAT | Lance | 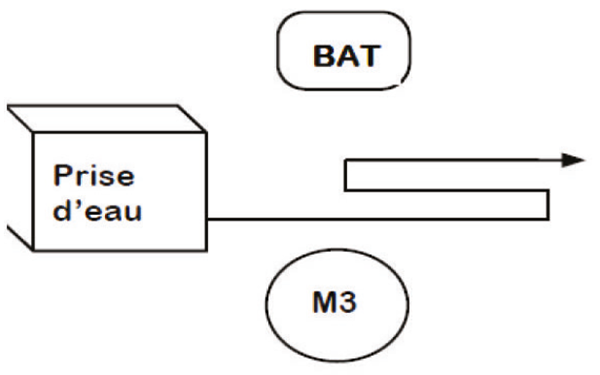 |
|
| Établissement de 2 lances à main directement sur une prise d'eau | BAT | Lance | 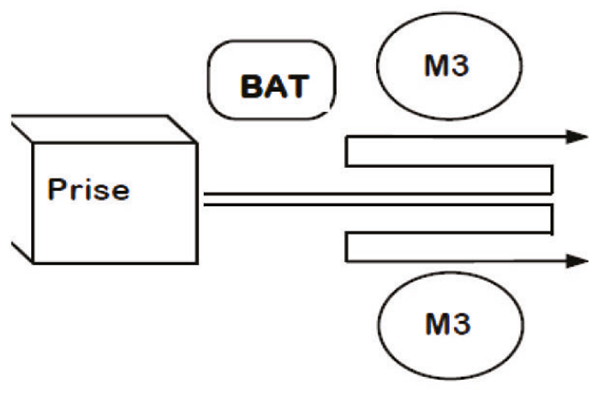 |
|
| XXXXXXX | ||||
| Établissement d'une lance sur division mixte | BAT BAl |
Lance Division mixte |
XXXXXX | 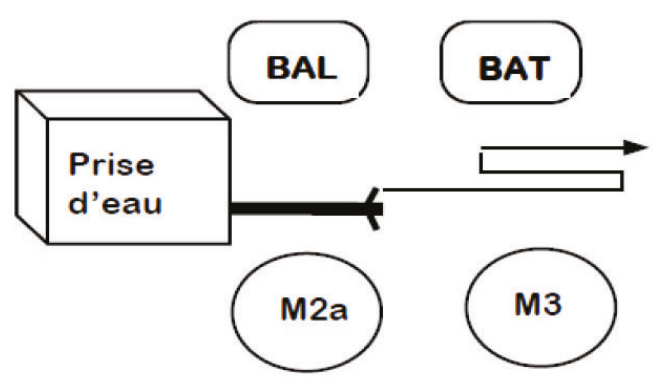 |
| XXXXXXX | ||||
| Établissement d'une lance avec emploi du dévidoir | BAT BAL |
Lance Dévidoir |
BAL avec dévidoir | 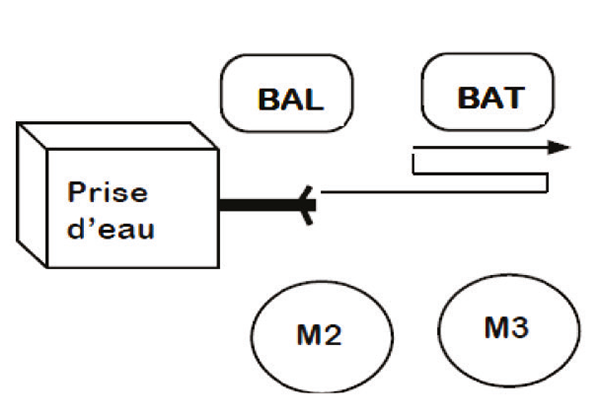 |
| Établissement d'une lance à main avec emploi de deux dévidoirs | BAT BAL BAL |
Lance Dévidoir Dévidoir |
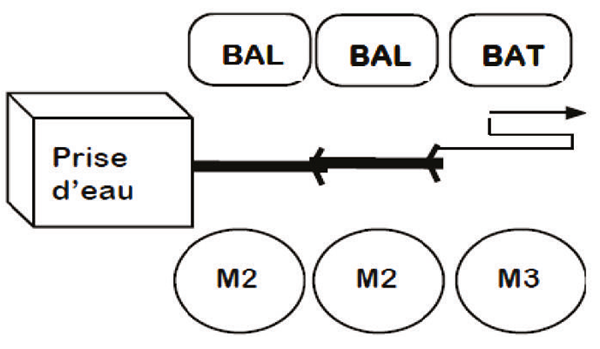 |
|
| Établissement d'une lance à main avec commande | BAT BAL |
Lance (ø 45) | BAL sans matériel | 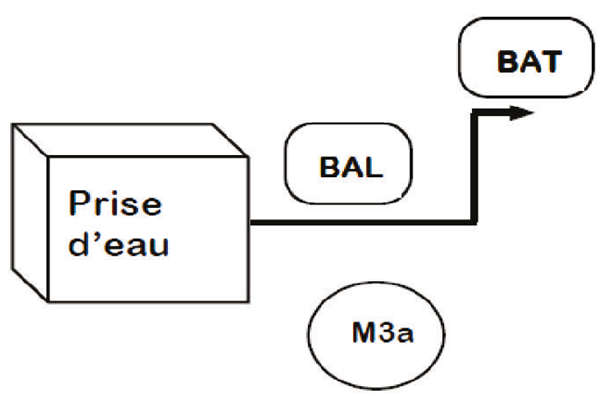 |
| XXXXXXX | ||||
| Établissement d'une lance à main sur échelle à coulisse | BAT BAL |
Lance (ø 45) Échelle |
BAL avec échelle | 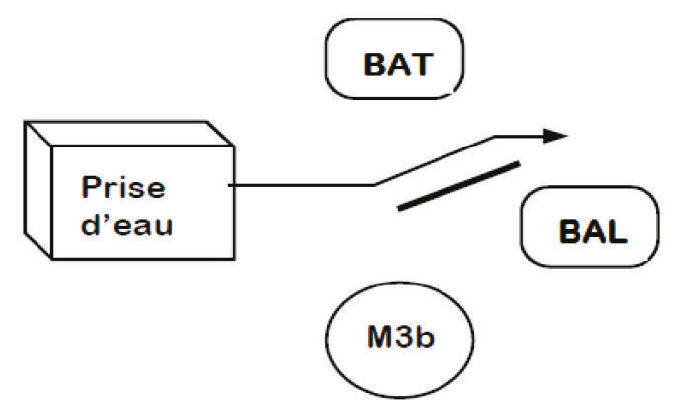 |
| Prolongement d'un tuyau | BAT ou BAL | LDT ou Lance de 45 | 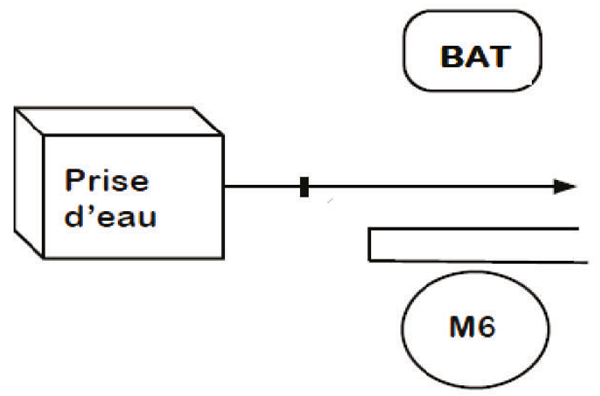 |
|
| Remplacement d'un tuyau | BAT ou BAL | Lance | 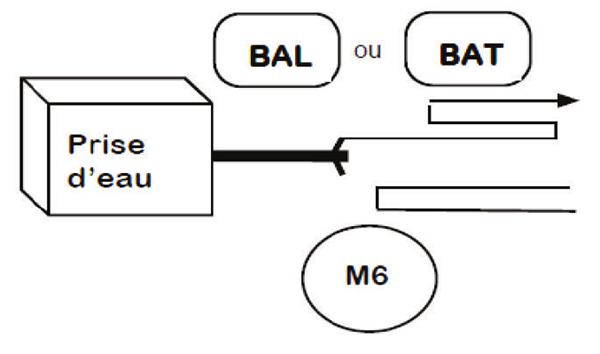 |
|
| XXXXXXX | ||||
| Établissement d'une lance à mousse | BAT BAL |
Lance à mousse Injecteur émulseur |
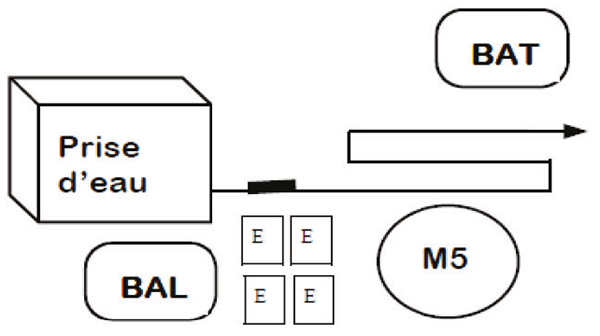 |
|
| Alimentation d'une prise d'eau au moyen de plus de 3 tuyaux en écheveaux (M2b) | BAL | 4 Dispositifs en écheveaux et 3 divisions | Le conducteur établi un tuyau de 70/20 m en direction du point d'accès. La 1re division est prise dans un autre engin. |
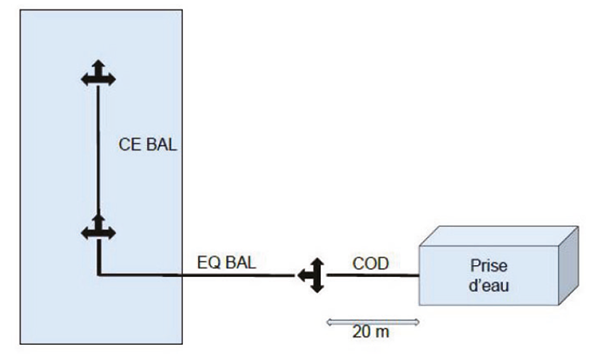 |
| XXXXXXX | ||||
| Alimentation par l'établissement | BAL | Dévidoir | Le conducteur établit un 70/20 en attente. Donne le matériel nécessaire à l'alimentation au binôme. Effectue la jonction avec le tuyau provenant de la division la plus proche de l'engin. Raccorde le tuyau en direction de l'hydrant sur orifice d'alimentation. |
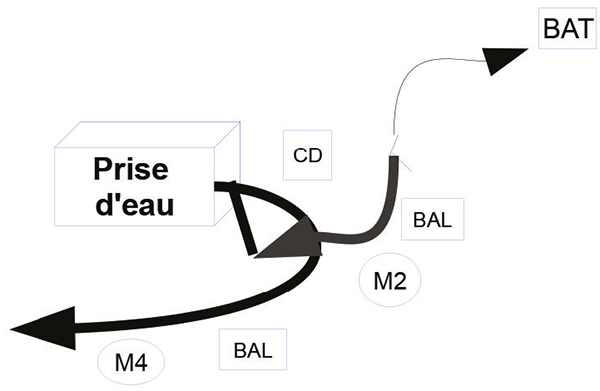 |
FS 1 EXT
LES PRINCIPES DE MAÎTRISE ET D'EXTINCTION DU FEU
La réduction de la quantité d'oxygène disponible dans le processus de combustion peut réduire le développement du feu et peut même l'éteindre après un certain temps.
Restreindre l'alimentation en air du feu est un moyen très efficace de maîtrise de l'incendie. Cela peut permettre de stabiliser une situation en attendant la mise en oeuvre des moyens d'extinction (lances, recloisonnement du feu…).
Dispositifs existants
Il n'existe pas de dispositif dédié à cela. Pour autant, la multiplication des matériaux isolants a un impact direct sur la circulation de l'air lors de la survenue d'un incendie, notamment en rendant le volume plus étanche (fenêtres triple vitrage, …).
Actions de lutte
La gestion des ouvrants par les équipes peut limiter le développement du feu.
L'évacuation des fumées permet d'atteindre quatre objectifs :
- améliorer les conditions de survie des personnes en diminuant le risque d'intoxication et en augmentant la visibilité permettant l'évacuation ;
- faciliter la progression des équipes de secours ;
- réduire le risque de propagation par convection ;
- réduire le potentiel développement du feu en le privant d'une partie du combustible.
Dispositifs existants
Il existe des systèmes de désenfumage naturels ou mécaniques (automatisés ou non) qui permettent l'extraction des fumées et l'arrivée d'air frais.
Actions de lutte
L'évacuation des fumées peut s'effectuer par :
- la mise en oeuvre des dispositifs existants ;
- la création ou la mobilisation d'entrant ou de sortant et/ou la mise en oeuvre de moyens mécaniques de ventilation.
Le refroidissement des fumées permet de réduire le transfert de chaleur (flux thermique émis).
Réduire la part du rayonnement permet notamment :
- de diminuer la quantité de gaz de pyrolyse produit ;
- de réduire l'exposition du binôme au flux rayonné ;
- de réduire le risque d'auto-inflammation des gaz combustibles présents.
Dispositifs existants
Il existe des dispositifs d'extinction automatique permettant de contenir le feu dans son développement (phase de naissance).
Actions de lutte
En complément de ces éventuels dispositifs, les équipes de secours projettent de l'eau qui, en se vaporisant, absorbe l'énergie des fumées, abaissant leur température et ainsi leur rayonnement.
Il est possible dans certaines conditions de refroidir les fumées par dilution à l'air (ventilation mécanique).
Il est possible de réduire le risque d'inflammation des fumées en les inertant par exemple au moyen de vapeur d'eau. Celle-ci est générée par l'évaporation d'eau projetée dans les fumées ou sur les surfaces surchauffées.
Dispositifs existants
Les systèmes d'extinction automatique à eau permettent, en sus de l'effet de refroidissement précité, l'inertage des fumées.
D'autres systèmes d'extinction automatique utilisent d'autres agents inertants gazeux. (Azote, CO2…).
Actions de lutte
Projection d'eau dans les volumes gazeux et les surfaces surchauffées.
Le terme « combustible » correspond ici aux matériaux qui émettent des gaz de pyrolyse lorsqu'ils sont soumis à la chaleur.
En effet, la production de gaz de pyrolyse est liée à la température du combustible. Ainsi, pour diminuer le débit de gaz de pyrolyse, il est possible de :
- limiter la quantité de combustible disponible (évacuation, part du feu) ;
- refroidir le combustible.
Dans le cadre des opérations de lutte contre l'incendie, l'agent extincteur le plus répandu demeure l'eau.
Dispositifs existants
Prescription relative à la réaction au feu des matériaux.
Actions de lutte
L'application directe d'eau sur les matériaux combustibles.
Lors de la combustion, des composés réactifs intermédiaires appelés radicaux libres se créent. L'objectif est de bloquer cette réaction en utilisant un agent extincteur.
Dispositifs existants
Des installations d'extinction fixes utilisent ce procédé. Elles sont le plus souvent utilisées dans des locaux sensibles, où l'utilisation de produits classiques (eau par exemple) peut engendrer la détérioration des équipements. On retrouve le plus souvent des systèmes d'extinction à gaz de type FE 13, FM 200.
Actions de lutte
Dans certains cas, les équipes de secours utilisent.
FS 2 EXT
LES AGENTS EXTINCTEURS

L'eau est l'agent extincteur par excellence : simple à projeter, facile à transporter, abondante et peu onéreuse.
L'eau agit par :
- refroidissement, (abaissement de T° foyer) ;
- étouffement (action sur le comburant) ;
- soufflage (action sur l'émission de vapeurs inflammables) ;
- dispersion (action sur le combustible solide) ;
- inertage (action dans le domaine d'inflammabilité) ;
- surpression (action sur le combustible gazeux).
Risques et inconvénients :
- conduction de l'électricité ;
- gel en cas de température négative ;
- dégâts supplémentaires (limiter le volume d'eau projeté) ;
- risques de pollution (atteinte à l'environnement) ;
- surcharge des structures bâtimentaires (risque effondrement) ;
- production de vapeurs d'eau (réduit la visibilité et risque de brûlures pour le personnel d'attaque) ;
- dangers particuliers : risque de réaction dangereuse (explosion, dégagement de gaz toxiques…), risque de projections…

La mousse est un assemblage de bulles constituées par une atmosphère d'air emprisonnée dans une paroi mince de solution moussante ou prémélange.
La mousse agit par :
- isolement (suppression des vapeurs inflammables) ;
- étouffement (suppression de l'apport d'O2) ;
- refroidissement (abaissement de la température du combustible).

Il existe différentes poudres qui peuvent être utilisées en fonction de la classe de feu (Poudre BC ou ABC).
Elles agissent par :
- étouffement (dépôt de pellicule sur les braises) ;
- inhibition (action sur la réaction en chaîne de la combustion).
Le CO2 agit sur le feu par étouffement, soufflage et refroidissement.
Il est le moyen le plus recommandé sur les installations électriques.
Sable sec, ciment, terre sèche peuvent être utilisés notamment pour les feux de métaux.

FS 2 EXT
FEUX DE LIQUIDES INFLAMMABLES
Lorsque l'on parle de liquides inflammables, on distingue les hydrocarbures (HC) et les liquides polaires (LP) ou liquides miscibles à l'eau.
Les HC sont des produits principalement constitués de carbone et d'hydrogène. Ces liquides comptent par exemple l'essence, le fioul domestique, etc. Ils ne sont pas miscibles avec l'eau et sont principalement produits à partir du pétrole.
Les LP sont très destructeurs de mousse car ils ont une grande affinité avec l'eau. Ils sont donc éteints plus difficilement. On distingue plusieurs familles dont les alcools et les cétones.
Température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote. La combustion s'arrête si l'on retire cette flamme.
Température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme au contact d'une flamme pilote. La combustion continue d'elle-même si l'on retire cette flamme.
Température minimale à laquelle un corps émet des vapeurs inflammables susceptibles de former avec l'air un mélange qui s'enflamme spontanément (sans présence de flamme pilote).
Capacité d'un corps à former un mélange homogène avec un autre corps. Par défaut, nous distinguons les HC qui sont non miscibles, et les LP qui le sont. Cela détermine la tactique générale employée pour l'extinction du sinistre.
L'émulseur est un produit qui, lorsqu'il est mélangé à l'eau, donne la solution moussante ou prémélange. Il en existe 2 types en fonction de leur base de fabrication : protéinique (à base de cornes et de sabots de bovins), et synthétique (à base de produits issus de l'industrie chimique).
Ils sont dits polyvalents lorsqu'ils peuvent être utilisés aussi bien sur les HC et sur les LP.
Un émulseur est fabriqué à partir d'une base moussante (protéinique ou synthétique), d'un anti-gel, de produits tensio-actifs, d'une gomme permettant aux émulseurs HC d'être polyvalents, et de fluor afin de renforcer la résistance à la contamination et augmenter la fluidité.
Pourcentage d'émulseur contenu dans la solution moussante. Par exemple, pour un émulseur à 3 %, nous aurons 3 litres d'émulseur et 97 litres d'eau pour 100 litres de prémélange. Celle-ci est indiquée sur les bidons ou les cubitainers, et peut varier si l'on utilise l'émulseur sur un HC ou un LP.
Attention, un mouillant-moussant ne doit pas être utilisé sur un feu de liquide inflammable.
La mousse est formée par un apport d'air dans le prémélange. Ce sont des bulles contenant de l'air et dont la paroi est une fine couche de solution moussante.
On distingue la mousse physique, obtenue par mélange avec un émulseur et brassage avec de l'air et la mousse chimique, principalement utilisée dans les extincteurs.
En matière de procédés d'extinction, elle agit sur :
- le comburant en empêchant l'air de rentrer en contact avec les vapeurs de liquide inflammable, c'est l'isolement.
- le combustible en empêchant les vapeurs de rentrer en contact avec l'air, c'est l'étouffement.
- la chaleur en refroidissant grâce à l'eau contenue dans la mousse, c'est le refroidissement.
Cette notion est un rapport entre le volume de mousse obtenu et le volume de solution moussante utilisé, il n'y a pas d'unité. Nous distinguons :
- bas foisonnement : 2 à 20 ;
- moyen foisonnement : 20 à 200 ;
- haut foisonnement : > 200.
À bas foisonnement, la mousse est stable et offre une bonne résistance à la réinflammation, au vent ou à la pluie. Sa compacité offre une portée de quelques dizaines de mètres en fonction de la lance (ou canon) utilisée.
À moyen foisonnement, la portée est d'une dizaine de mètres maximum.
À haut foisonnement, la portée est quasi nulle (déversement à gueule bée) et la résistance est très faible. Cependant, elle permet de remplir de grands volumes assez rapidement. Le bas foisonnement sera utilisé en complément.
Cette notion est le débit de solution moussante à appliquer sur chaque mètre carré en feu. La connaissance de ce taux est nécessaire pour mener à bien l'extinction, mais dépend également des ressources en eau, en émulseur et des matériels à mettre en oeuvre. Il s'exprime en l/min/m². Le taux d'application d'extinction est défini par une fiche du guide opérationnel. Lors de la temporisation, le taux d'application d'extinction est divisé par 2.
L'extinction d'un feu de liquide inflammable requiert une certaine attention quant au mode d'application de la mousse. Celui-ci peut être direct (violent), ou indirect (doux).
On favorisera toujours une application indirecte.
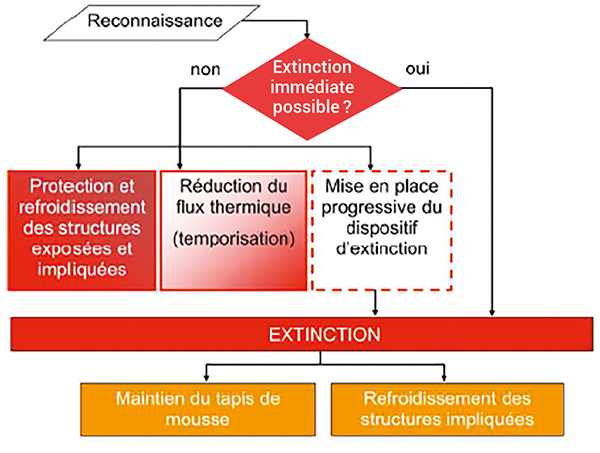
FT 1 EXT
LES DIFFÉRENTS TYPES DE JETS
Les lances permettent de changer le jet en fonction de la situation et de l'effet souhaité par le porte-lance. Elles présentent l'avantage de pouvoir faire varier le débit sortant en fonction des circonstances rencontrées, quelle que soit la phase du sinistre.
Il existe 4 types de jet : le jet droit (JD), le jet diffusé d'attaque (JDA), le jet diffusé de protection (JDP) et le jet purge (JP).
Jet droit (JD)

Jet diffusé d'attaque (JDA)

Jet diffusé de protection (JDP)

jet purge (JP)

| Jet | Avantages | Inconvénients | Utilisation |
| JD |
|
|
|
| JDA |
|
|
|
| JDP |
|
|
|
| JP |
|
|
FT 2 EXT
LE BINÔME D'ATTAQUE (BAT)

En concertation avec le chef d'agrès, en fonction de l'action à mener et en application des principes décrits dans le guide de doctrine opérationnelle sur les incendies de structure, mais aussi des quelques éléments techniques décrits ci-avant, le chef d'équipe choisit le type de tuyau (en couronne ou en écheveau).
Ce choix repose en général sur les éléments suivants :
- lecture du bâtiment ;
- lecture du feu.
Le chef d'équipe participe également à la reconnaissance permanente dans la structure, afin d'adapter la réponse opérationnelle aux enjeux et aux contraintes identifiées.
Il complète le matériel en fonction de la mission ou sur ordre.
Il veille au maintien des conditions de ventilation déterminées (anti ventilation, ventilation d'attaque). Le porte-lance rend compte régulièrement au chef d'agrès du résultat de ses actions et des éventuels besoins complémentaires.
Nota : une extinction présentant une difficulté particulière doit faire l'objet d'une remontée d'information rapide au chef d'agrès. La méthode utilisée peut en effet être inappropriée à la situation et doit alors faire l'objet d'une réorientation.
Le porte-lance prend les décisions nécessaires à la préservation de la sécurité du binôme, en collaboration avec son équipier et son chef d'agrès. Il décide en particulier de :
- l'ouverture sécurisée des ouvrants ;
- le placement judicieux dans le sens de tirage, en amont du foyer (la zone entre le foyer et le sortant doit être évitée).
Avant de pénétrer dans un local, le porte-lance doit :
- se placer dans la position la plus basse possible si besoin, à l'écart des effets éventuels d'un phénomène thermique ;
- rechercher les signes d'alarme significatifs des phénomènes thermiques et rendre compte à son chef d'agrès en cas de nécessité ;
- s'assurer que les conditions sont remplies pour pénétrer dans le local.
Lorsqu'il pénètre dans un local, le porte-lance doit :
- explorer le local dans la position la plus basse possible, par avancées successives, en évitant de rester dans le sens du tirage et en mettant en oeuvre les techniques d'extinction adaptées à la situation ;
- adapter le jet et le débit de la lance en fonction de sa lecture du feu ;
- se replier en cas d'une baisse anormale d'arrivée de l'eau à la lance et rendre compte ;
- utiliser l'eau strictement nécessaire à l'extinction ;
- au fur et à mesure de sa progression, identifier des zones de sécurité sur l'itinéraire de repli.
L'équipier facilite le travail du chef d'équipe en :
- ajustant l'établissement pour éviter les coudes, les coincements (sous les roues des véhicules dans la rue, angles de portes, barrières d'escaliers…) ;
- évitant qu'il soit dans des zones à risque pour sa pérennité (bris de verres et objets contondants, matières incandescentes ou chaudes, traversée de route…) ;
- faisant suivre l'établissement lors de la progression.
Il participe activement à la sécurité du binôme et des intervenants en général en :
- se plaçant de l'autre côté du tuyau pour avoir un champ de vision complet et ainsi améliorer la sécurité de l'équipe (équipier + chef d'équipe = 360°), si l'espace disponible le permet ;
- observant le feu et en informant le chef d'équipe de tout signe d'aggravation ou d'évolution de la situation.
Lors d'un repli ou d'une progression, l'équipier peut être amené à s'éloigner un peu du chef d'équipe afin de tirer le tuyau.
FT 3 EXT
REFROIDISSEMENT DES FUMÉES
Références : GTO Établissements et techniques d'extinction. Fiche ETEX-STR-TDE-1
L'objectif des applications d'eau est d'utiliser l'énergie thermique contenue dans la fumée pour convertir l'eau en vapeur et ainsi la refroidir.
Des applications d'eau au cours de la progression permettent aux intervenants de faciliter la progression du binôme et de pouvoir ensuite traiter le foyer plus efficacement.
Le refroidissement de fumée permet de :
diminuer l'impact radiatif sur les intervenants/les matériaux combustibles (abaissement de la température de la fumée) ;
- prévenir le déclenchement d'un phénomène thermique (inertage/refroidissement de la fumée) ;
- éviter d'atteindre la température d'auto-inflammation de la fumée ;
- stabiliser/rehausser le plafond de fumée (contraction du volume refroidi) ;
- sécuriser l'environnement de travail par inertage à la vapeur (vaporisation de l'eau projetée) ;
- diminuer la quantité de gaz combustible (produits de combustion et gaz de pyrolyse).
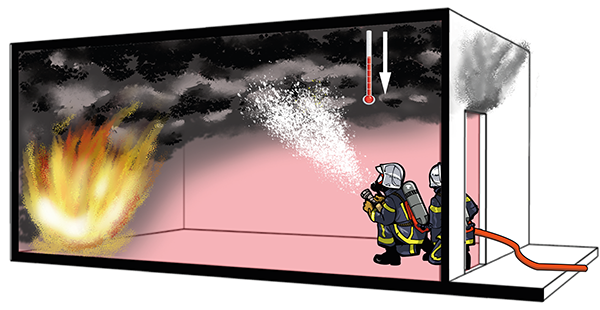
En fonction de la géométrie du volume à traiter, deux types d'impulsions sont réalisables :
Elles s'obtiennent par une manoeuvre du robinet de lance en ouverture/fermeture rapide (inférieure à une seconde) devant soi.
Cette technique est à privilégier dans des structures de type locaux d'habitations standards, hôtels, bureaux, etc.
En fonction de la largeur du lieu de progression (ex. : couloir ou pièce plus ou moins grande), il est possible de pratiquer 2 ou 3 impulsions courtes afin de traiter toute la largeur du volume.
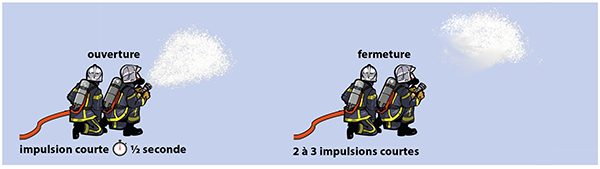
 |
Débit | 100 à 300 l/min |
| Angle de diffusion | 30 à 60° | |
| Durée de l'impulsion | inférieure à une seconde |
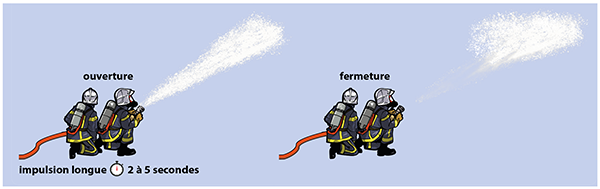
Elles s'obtiennent par une manoeuvre d'ouverture du robinet de lance de 2 à 5 secondes et une fermeture progressive.
Cette technique est à privilégier dans des structures type magasins, entrepôts, atriums, garages, etc. Elle peut aussi être utilisée lors des passages de portes pour sécuriser l'ambiance derrière la porte.
 |
Débit | 100 à 300 l/min |
| Angle de diffusion | 20 à 30° | |
| Durée de l'impulsion | 2 à 5 secondes |
FT 4 EXT
EXTINCTION DES COMBUSTIBLES « SOLIDES »
Références : GTO Établissements et techniques d'extinction. Fiche ETEX-STR-TDE-2
L'objectif est de placer de l'eau sur les surfaces combustibles. L'eau peut être projetée sur le combustible directement ou indirectement (par ricochets au plafond par exemple).
Les applications sont opérées sur des tactiques offensives.
La plupart du temps, dans un volume, on utilisera le jet droit afin de concentrer le flux d'eau. L'eau ainsi projetée s'étalera à l'impact sur la surface et s'écoulera pour capter de l'énergie du combustible.
Ces applications sont à mettre en oeuvre lorsque l'eau peut être directement déposée sur les surfaces combustibles. En attaque intérieure, le jet droit est à privilégier pour maintenir une ambiance thermique la plus tenable possible.
Cette application d'eau permet de déposer une masse d'eau sur une surface en feu plus ou moins importante sans créer de déstratification du plafond de fumée. L'objectif ici, est d'atteindre des surfaces combustibles pouvant être situées à plusieurs mètres du porte lance tout en conservant un plafond de fumée stable. L'eau, une fois la surface atteinte, va augmenter sa surface de contact et ruisseler sur le combustible.
Par exemple : une série de zigzag partant du haut d'une surface jusqu'en bas, un balayage de droite à gauche ou de gauche à droite, etc. De façon à casser l'effet mécanique du jet droit, le robinet de lance doit être ouvert partiellement, afin que l'eau projetée soit « déposée » sur les surfaces.
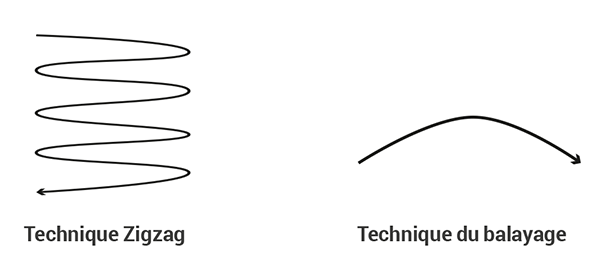
Cette application permet de déposer un paquet d'eau sur une surface relativement petite et ciblée. L'ouverture de lance sera partielle et courte (ouverture/fermeture du robinet de lance) en position jet droit. Le mécanisme de diffusion de la lance n'étant pas optimisé, l'eau ainsi propulsée reste en grosses gouttes.
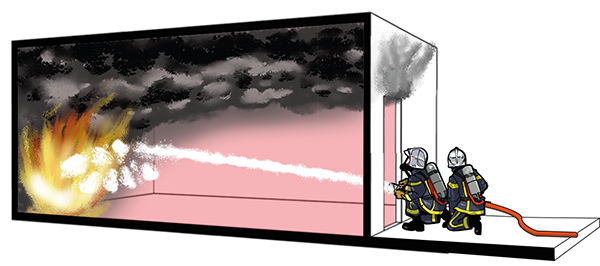
Il s'agit d'une application d'eau qui utilise le plafond pour modifier l'angle d'application du jet, lorsque des surfaces combustibles ne peuvent pas être atteintes. Dans ce cas la paroi dévie le jet droit ; mais le but est bien de placer de l'eau sur la surface combustible pour la refroidir.
Dans ce cas, le robinet de lance devra être suffisamment ouvert afin que le jet droit puisse impacter le plafond et se rediriger sur les surfaces combustibles masquées.
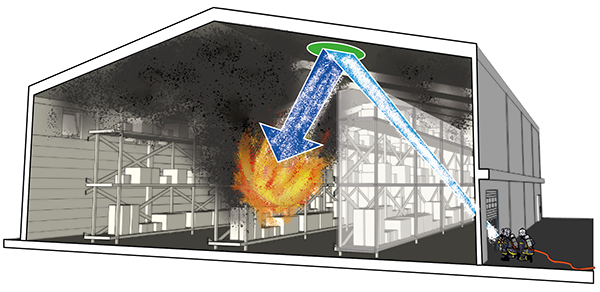
Cette technique permet d'atteindre la surface en feu à distance, protégeant ainsi le binôme du rayonnement, mais aussi du risque d'effondrement de la structure. Il convient de respecter quelques principes de mise en oeuvre :
- veiller à limiter les dégâts d'eaux dans la mesure du possible. Si l'application n'est pas efficace, changer depoint d'attaque afin de pouvoir atteindre l'objectif ;
- veiller à ne pas mettre en suspension des braises pouvant mettre à feu des gaz inflammables présents dansle local à traiter ;
- limiter les temps d'application de façon à contrôler l'efficacité de l'action.
FT 5 EXT
EXTINCTION COMBINÉE / MASSIVE
Références : GTO Etablissements et techniques d'extinction. Fiche ETEX-STR-TDE-4
La technique combinée (ou massive) permet d'associer les effets d'un refroidissement massif des surfaces combustibles et de production importante de vapeur sur la base du même geste technique.
Cette technique permet d'agir sur :
- les fumées ;
- les parois ;
- le foyer.
Ces techniques de lance s'opèrent depuis l'extérieur du volume concerné, sur des feux en phase de pré-embrasement généralisé ou pleinement développés. L'application d'eau à produire consiste, à partir d'un jet diffusé d'attaque, à déplacer sa lance en effectuant un mouvement en T, Z, O, 8, carré, rectangulaire etc.
L'application débute en partant du haut du volume sinistré.
Ces applications peuvent être réalisées sur des temps adaptés à la situation jusqu'à 5 à 6 secondes. L'objectif n'est pas de faire un geste rapide, mais un geste « posé », permettant de bien projeter de l'eau sur les toutes les surfaces :
- combustibles pour stopper/diminuer le débit de pyrolyse ;
- incombustibles pour produire de la vapeur.
Dans certains cas, le mouvement peut être réalisé deux fois de suite sans refermer son robinet de lance, afin d'optimiser l'efficacité de la technique si le débit peut paraître trop juste.
Exemples d'extinction combinée en « crayonnage »
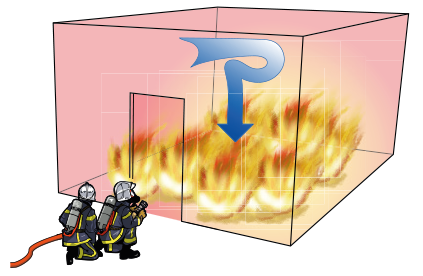
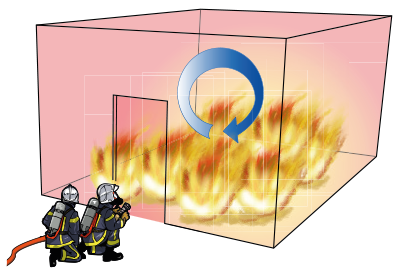
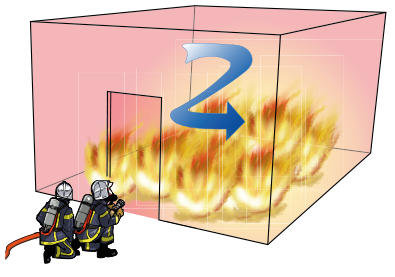
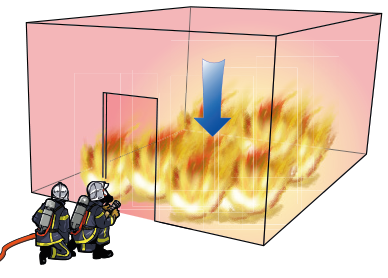
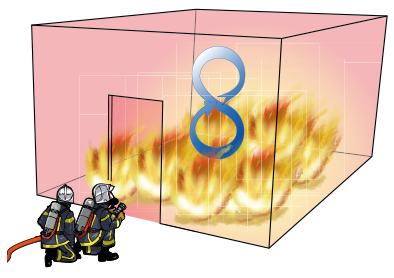
Ce type d'extinction est à réaliser depuis l'extérieur du local/de la structure afin de ne pas subir
le retour de vapeur. Cette technique peut entraîner une propagation de l'incendie à un autre volume
adjacent, en présence d'un ouvrant entre les deux volumes.
FT 6 EXT
SITUATION PRÉ-EXPLOSION DE FUMÉES
Dans un local fermé dans lequel un foyer d'incendie a vu sa période de croissance s'arrêter par manque d'oxygène, une situation avec des indicateurs d'explosion de fumées peut être suspectée.
Ce type de situation se contrôle principalement en produisant de la vapeur afin de diminuer l'inflammabilité du mélange combustible.
Plusieurs approches opérationnelles sont possibles :
- une extinction depuis la porte du local ;
- un inertage depuis l'extérieur par trouée ;
- dans certains cas, en dernier recours et si les conditions le permettent : la ventilation du local pour déclencher la mise à feu.
Cette action s'intègre dans le cadre des gestes et techniques lies à l'ouverture sécurisée de porte. La porte doit être entre-ouverte de façon à pouvoir faire une application en jet 30° sur 1 à 2 secondes (plus si le local est grand/haut) en visant le plafond du local.
La porte est alors refermée partiellement (laisser 1 cm env.) de façon à voir si de la vapeur s'échappe. La sortie ou non de vapeur « sous pression » précisera le niveau de l'ambiance thermique dans le local.
Reproduire l'application d'eau jusqu'à ce que les indicateurs indiquent que l'ambiance dans le local est contrôlée (sortie de vapeur sans surpression remarquable). Pénétrer dans le local pour traiter le foyer. Dans ces situations, la caméra thermique peut être un plus pour localiser rapidement le foyer.
Il est possible avec des outils adaptés de produire un inertage du local à traiter en limitant l'exposition des intervenants par réalisation d'une trouée dans une paroi (masse, barre Halligan…).
Une trouée de 20 x 20 cm environ peut être réalisée dans un mur en parpaing, à ossature bois, en béton cellulaire, en plaque de plâtre, en brique... De façon à y introduire la lance et pratiquer une série d'application d'eau depuis l'extérieur directement dans le ciel gazeux du volume impliqué.
FT 7 EXT
SITUATION PRÉ-EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ
Références : GTO Établissements et techniques d'extinction. Fiche ETEX-STR-TDE-1
En situation proche de l'embrasement généralisé : le plafond de fumée peu devenir très instable (plafond de fumée bas, interface fumée/air très turbulente, flammes). Dans ce contexte opérationnel, il est fortement déconseillé de faire des impulsions pour tenter de refroidir la fumée. Le brassage anarchique des couches de fumée qui s'en suivrait pourrait être à l'origine de la mise à feu du ciel gazeux.
La sécurisation d'une ambiance aussi instable peut être obtenue, sans déstratifier les fumées.
Pour ce faire, il faut :
- passer en jet droit ;
- utiliser un débit de 100 à 300 l/min ;
- appliquer l'eau sur les parties hautes des murs et cloisons ainsi que sur le plafond en opérant un balayage de droite à gauche (ou de gauche à droite) assez progressivement. La durée de l'application est à adapter au local à traiter. L'effet mécanique de l'eau n'ayant pas d'intérêt, il est impératif de n'ouvrir que partiellement le robinet de lance.
Un angle de jet faible limitera la destratification des différentes couches de fumée. L'eau ne se convertira que très peu en traversant la couche de fumée. Au contact de la paroi, le flux d'eau va s'étaler et s'écouler le long du mur/sur le plafond et donc augmenter sa surface de contact afin de prendre de l'énergie aux parois. Cette action permet de produire de la vapeur dans la couche convective pour la refroidir et l'inerter lentement.
Attention, réaliser des impulsions dans des roll over est inadapté, car ce sont des flammes établies. Les applications d'eau pourront peut-être les éteindre, mais les roll overs réapparaîtront aussitôt et ce, tant que le générateur de flamme (le foyer) n'aura pas été traité.
N'oubliez pas !
Vous ne devez pas évoluer sous des roll over car c'est le signe d'un embrasement généralisé éclair imminent. Repliez-vous ! !
FT 8 EXT
ATTAQUE DE TRANSITION
Références: : GTO Établissement et techniques d'extinction. Fiche ETEX-STR-TDE-8
L'attaque de transition est une technique permettant d'attaquer le feu par l'extérieur, à distance, à travers une porte ou une fenêtre en utilisant un jet droit avec un débit et une durée d'application adaptée à la puissance du feu.
Il s'agit de stopper temporairement le développement du feu et de modérer le sinistre avant toute intervention du binôme d'attaque par l'intérieur. Une partie du jet se fractionne sur le plafond, agissant sur le foyer.
Ce type d'attaque peut être mis en oeuvre dès que cela est possible (absence de balcon notamment, portée de lance suffisante…) avant d'initier une attaque par l'intérieur.
Dans certains cas (accès difficile à trouver, porte blindée à forcer, manque de ressource en personnel sur place, délai des renforts…), la mise en oeuvre de cette technique peut permettre de tenir le foyer sous contrôle et même de l'atténuer.
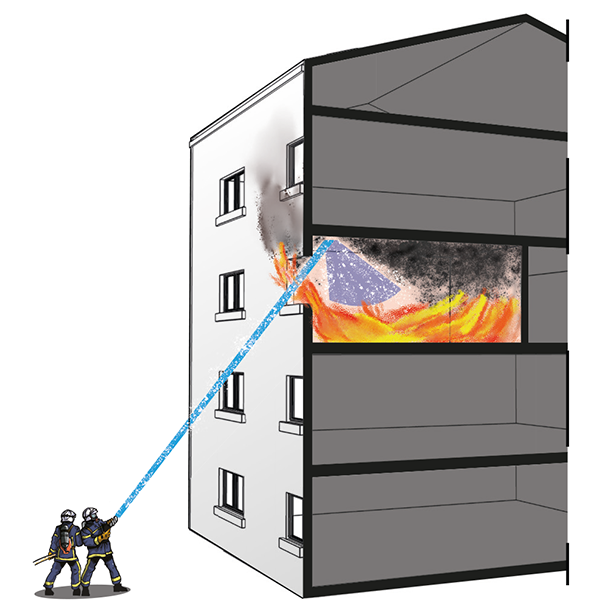
- feu pleinement développé dans son volume (embrasement généralisé ou post embrasement) ;
- foyer localisé et encloisonné ;
- flammes visibles et sortant d'un ouvrant ;
- sinistre susceptible de se développer pendant la mise en place du dispositif hydraulique.
La communication entre le chef d'agrès et les binômes est essentielle (voix, ERP).
Cette technique doit être initiée par le COS.
Pas d'engagement de binôme à l'intérieur durant l'attaque de transition et engagement sur ordre.
Le jet utilisé est un jet droit dirigé, depuis l'extérieur, sur un seul et même endroit du plafond du volume en feu, permettant d'atteindre l'étage concerné. L'effet recherché est le fractionnement du jet au plafond pour que des grosses gouttes retombent sur les parties incandescentes. Cela provoquera une vaporisation en partie haute et l'inertage des parties du foyer non atteintes par l'eau.
La lance devra si possible disposer d'un débit minimum de 300 l/min pour une durée d'application de 15 secondes MAXIMUM ou dès le changement significatif des indicateurs de la lecture du feu.
Si aucun changement n'est visible au bout des 15 secondes, stopper la manoeuvre et rendre compte immédiatement au chef d'agrès.
Schémas de principe
L'attaque extérieure en jet droit vise le plafond, afin de fragmenter le jet
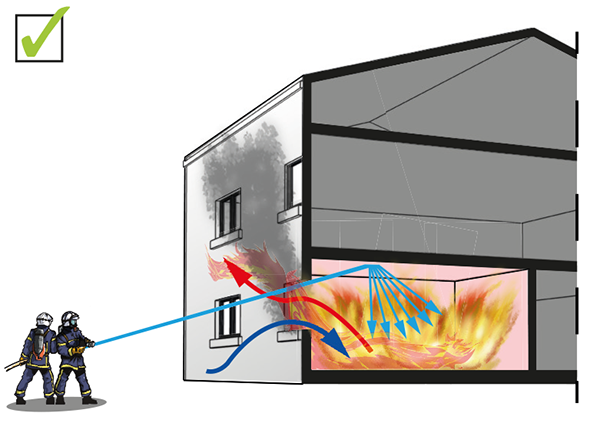
Blocage de l'ouvrant par le jet diffusé
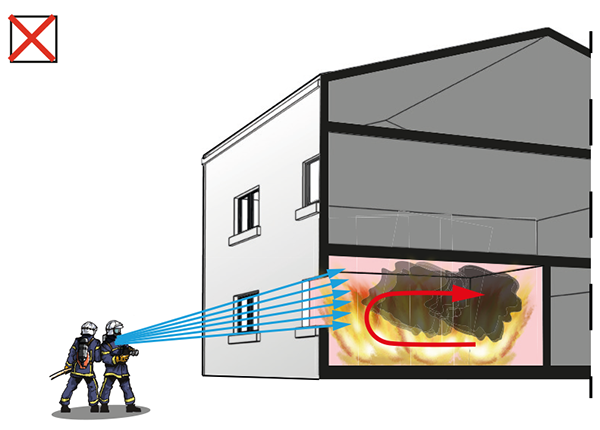
Angle trop fermé
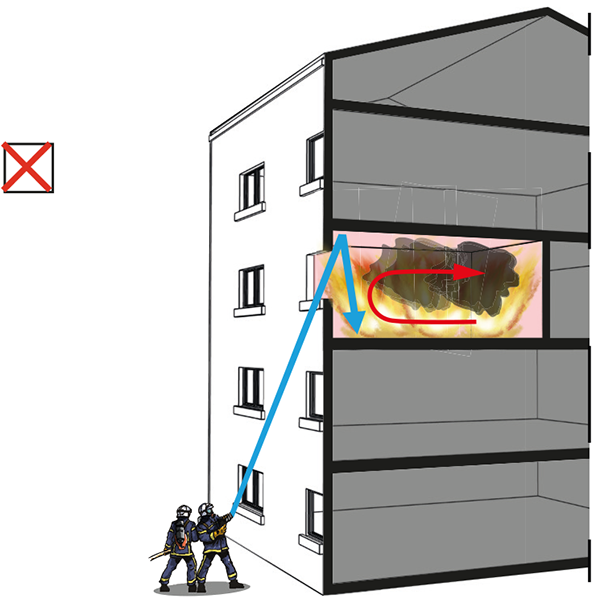
Portée insuffisante
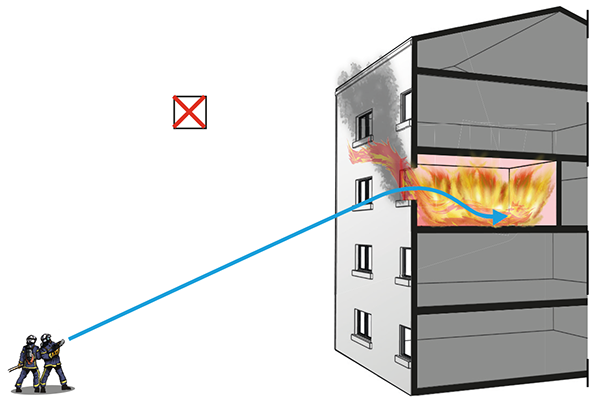
FT 9 EXT
LE PASSAGE DE PORTE
L'ouverture de porte dans le domaine de la lutte contre l'incendie est un moment « délicat » qui peut avoir des conséquences très graves à la fois pour les intervenants, les tiers mais aussi pour la maîtrise future du sinistre.
Il faut avoir à l'esprit que l'ouverture de porte aura pour première conséquence d'apporter de l'air frais au feu.
Il n'existe pas de « recette miracle » pour ouvrir une porte. C'est un acte réfléchi qui ne doit être réalisé qu'après s'être informé sur la porte et avoir analysé la situation afin d'agir de manière appropriée.
Une porte froide n'est pas automatiquement sans danger.
Avant d'ouvrir, le binôme doit se positionner de manière à être protégé. Trois options sont possibles dans l'ordre de priorité suivant :
- le binôme se protège par un mur ;
- le binôme se protège par la porte ;
- le binôme se protège par la lance.
La communication au sein du binôme sera prépondérante, et il devra rendre compte dès que possible.

La notion de victime primera dans toutes les situations.
Les éléments à prendre en compte sont :
- l'activité principale du local concerné (chambre, cuisine, local technique…) ;
- l'aspect de la porte (cloquée, déformée, noircie, intacte…) ;
- le type de porte (en bois, blindée, présence d'un oculus…) ;
- le sens d'ouverture de la porte (tirante, poussante, coulissante) ;
- le verrouillage ou pas de la porte (autre accès, forcement des accès…) ;
- la lecture du feu (Fumées, Flammes, Sons, Chaleur).
En fonction des indicateurs, l'engagement avec un moyen hydraulique sera nécessaire.
Les premiers sens à utiliser en priorités sont la vue, l'ouïe et le toucher.
 la vue : sortie des fumées, aspect de la porte, repérage de victime.
la vue : sortie des fumées, aspect de la porte, repérage de victime. l'ouïe : crépitements, fuite de gaz, cris de victimes.
l'ouïe : crépitements, fuite de gaz, cris de victimes. le toucher : chaleur de la porte et/ou des huisseries.
le toucher : chaleur de la porte et/ou des huisseries.
En fonction des situations, nous aurons peut-être besoin d'outils :
- forcement des accès ;
- la caméra thermique ;
- la lance.
En fonction de la lecture du feu et de son analyse, deux solutions s'offrent au binôme :
La décision est prise de rentrer dans le local concerné par le feu. Le binôme adopte donc une attitude offensive.
A tout moment le chef devra maîtriser et agir avec son moyen hydraulique pour pouvoir progresser en sécurité. Il portera une attention particulière à l'utilisation de l'eau.
L'équipier devra :
- aider le chef dans sa progression et doit :
- toujours garder un contact physique avec le tuyau, la ligne guide ou la commande ;
- rester maître de l'ouvrant. Il veille à faire rentrer le minimum d'air dans le local ;
- surveiller l'environnement proche du binôme.
Une attention sera portée à la fumée et à son cheminement. Une fumée blanche peu rayonnante n'est pas anodine (inflammation de gaz). La hauteur de l'interface air/fumée sera également un élément à prendre en compte pour la progression.
Si la porte est verrouillée, le chef rendra compte sans délai au chef d'agrès afin d'opter pour une technique de forcement des accès, ou un autre choix tactique.
Si l'ambiance thermique est trop importante, des actions de lance pourront être réalisées de l'extérieur avant de continuer et de pouvoir pénétrer : refroidissement des fumées, attaque combinée massive… Dans cette situation, le binôme referme en partie la porte de manière à ce que l'eau joue son rôle et qu'il garde un visuel sur l'effet de ses actions.
FT 10 EXT
LA POSITION DE SURVIE
Références : GTO Établissements et techniques d'extinction. ETEX-STR-TDE
Position de survie

Dans la mesure où le repli n'est plus possible et que les intervenants sont directement menacés par le phénomène, le binôme doit :
- se jeter au sol face contre terre, binôme regroupé ;
- maintenir la lance au-dessus des casques en jet de diffusé de protection au débit maximum.
FT 11 EXT
EXTINCTION D'UN FEU DE VL À L'AIR LIBRE
Références : NDO IUV DGSCGC du 01 juin 2016 Consigne opérationnelle SDIS 38 Intervention pour feux de véhicule du 18 novembre 2016
Le choix de l'établissement est réalisé et laissé à l'appréciation du COS en fonction de l'incendie, des informations connues et des moyens humains et matériels dont il dispose.
La solution garantissant le mieux la sécurité des intervenants est l'établissement de deux lances :
- idéalement deux lances à débits variables (LDV) ;
- une LDV et la lance du dévidoir tournant si la longueur le permet. Dans ce cas, la lance disposant du plus grand débit est impérativement dédiée au refroidissement des réservoirs contenant du gaz et/ou des batteries de traction.
Protocole opérationnel
Afin de pouvoir réaliser l'extinction des feux de véhicules à énergie alternative dans un environnement sécurisé, il est arrêté une méthodologie d'intervention unique qui vise à :
-
refroidir les sources d'énergie : mission du binôme 1
- pour les GPLc/GNC/GNL/H2 : éviter la surpression des réservoirs / effet « lâcher de soupape » ;
- pour les VE et VeH : éviter l'emballement thermique et/ou inflammation de la batteries.
- Stopper tout rayonnement calorifique aux abords des sources d'énergie : mission du binôme 2.
Les zones de danger





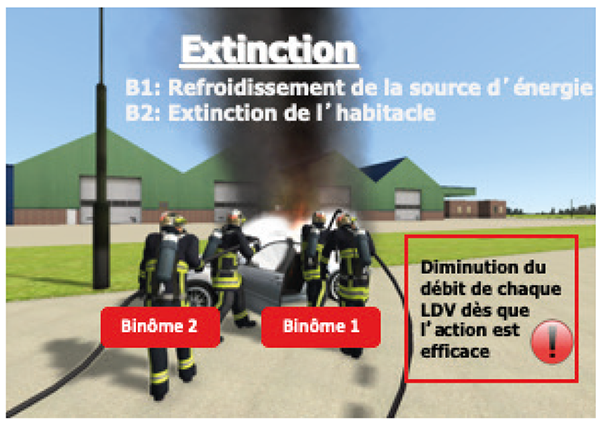
La diminution du débit des lances doit être faite dès que l'action est efficace.
FT 12 EXT
INTERVENTIONS SUR BOUTEILLES DE GAZ
Références : GDO Interventions en présence de bouteilles de gaz soumises à un incendie ou à un choc
Les bouteilles délivrant du gaz peuvent contenir le produit sous forme de :
- Gaz comprimés : stockés sous pression à l'état gazeux : bouteille ARI, hydrogène, méthane, azote…
- Gaz liquéfiés : stockés sous pression à l'état liquide avec un ciel gazeux : butane, propane, ammoniac…
- Gaz dissous : stockés sous pression à l'état gazeux et dissous dans un solvant liquide : cas de l'acétylène.
Les sapeurs-pompiers primo-intervenants peuvent être confrontés à ces bouteilles de gaz dans des situations très variées, avec ou sans mention de leur présence lors de la prise d'appel :
| Habitations, garages | Camping -cars, caravanes | Bâtiments industriels | Bateaux, péniches |
| Installations précaires ou chantiers | Transports sanitaires | Transport de gaz sans TMD | Dépôts de déchets |
| Découpe de métaux | Travaux toits terrasses | Chariots élévateurs | Soudures |
Les bouteilles contenant du gaz sont dangereuses lorsqu'elles sont soumises au feu ou à une chaleur excessive.
L'éclatement est possible et a pour conséquences des effets de surpression, un flux thermique, des effets missiles, des phénomènes liés aux propriétés du gaz stocké (toxique, comburant, inflammable).
- Réaliser une reconnaissance avec analyse de la situation (présence de bouteilles de gaz, nature du gaz, état des bouteilles, présence de victimes), réaliser des relevés de température, et si possible des mesures d'explosimètrie
- Réaliser des sauvetages et des mises en sécurité si nécessaire
- Transmettre les informations recueillies aux intervenants (type de bouteilles, nature du produit, localisation) et mettre en place un zonage (périmètre a priori)
- Attaquer le sinistre avec prise en compte des risques associés. Selon les enjeux, engager le personnel en limitant son exposition ou utilisation de moyens fixes
- Limiter l'exposition des bouteilles au rayonnement thermique, refroidir les bouteilles avec JDA à 300 l/min et assurer une surveillance attentive du sinistre (relevés de température réguliers > Observation décroissance thermique)
Les couleurs des bouteilles varient et dépendent des enseignes commerciales et distributeurs.
Bouteilles nouvelle génération (composite et acier)

Bouteilles traditionnelles (acier)

Plus la température est élevée à l'intérieur d'une bouteille plus la pression augmente.
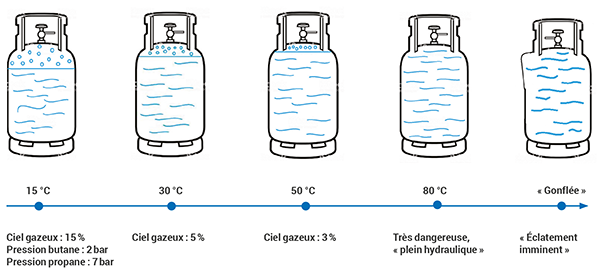

Effets missiles à plus de 100 m
En fonction de la position de la bouteille, même avec un dispositif de sécurité l'éclatement de la bouteille reste possible.
Les bouteilles « composites » ne se dilatent que très faiblement. Au contact de la chaleur, le matériau
devient poreux et libère le gaz à travers celui-ci.
Bouteille composite soumise au feu


Recommandations opérationnelles
- Selon la reconnaissance et en fonction de la balance bénéfices/risques rester en protection à portée de lance
- Abaissement des flammes dans l'environnement immédiat de la bouteille
- Procéder au refroidissement en JDA si température de surface > 50 °C (jet droit directement appliqué sur la bouteille interdit)
- Manipuler ou déplacer la bouteille qu'après l'avoir suffisamment refroidie. Le refroidissement est considéré comme atteint lorsque l'eau ruisselle sur les parois sans évaporation ou lorsque la mesure à la caméra thermique correspond à la température ambiante.
Il existe des bouteilles métalliques (acier, inox, alliage d'aluminium) et des bouteilles en matériau composite haute performance. Le gaz peut être stocké à plusieurs centaines de bars.
Il existe des dispositifs de sécurité en fonction de la nature des produits, des pressions, ou de la dimension de la robinetterie.
Toute bouteille de gaz exposée à une chaleur excessive peut éclater à cause d'une augmentation de la pression causée par l'élévation de la température.
350 °C Température à laquelle il y a risque d'éclatement d'une bouteille de gaz comprimé.
Recommandations opérationnelles
- Reconnaissance (type de bouteille et contenance, nombre, lieu de stockage, milieu ouvert ou fermé) et évaluation de la situation
- Attaque du foyer
- Protection des SP par des écrans
- Refroidissement des bouteilles en JDA avec un débit de 300 l/min minimum
- Manipuler ou déplacer la bouteille qu'après l'avoir suffisamment refroidie (température de l'enveloppe inférieure à 50 °C). Prudence lors de la manipulation si : déformation de la bouteille, fuite apparente, aspect noir ou fondu des accessoires sur la bouteille.
L'acétylène (C2H2) est un gaz inflammable utilisé essentiellement en soudage, coupage et brasage, du fait de sa flamme très chaude. De ce fait il se trouve fréquemment chez les garagistes, carrossiers et plombiers.
Ce gaz comprimé est généralement dissous dans un solvant (acétone) avec un support solide poreux (type craie), conditionné dans des bouteilles métalliques de 2 à 50 litres.
Son code danger est le 239, son code matière 1001, et les bouteilles sont identifiées avec une collerette marron clair.


L'acétylène est un composé très instable, qui peut très facilement se décomposer sous l'effet de la chaleur ou d'une faible pression.
Cette décomposition peut se produire rapidement lorsque la bouteille est soumise à une forte chaleur lors d'un incendie ou lorsque la bouteille est utilisée ou vidangée en position couchée.
Données physico-chimiques :
- LIE-LSE : 2,2 %-85 %
- Densité du gaz : 0,9
- Odeur : ail
Recommandations opérationnelles
- Reconnaissance (type de bouteille et contenance, nombre, lieu de stockage, milieu ouvert ou fermé) et évaluation de la situation
- Établir un périmètre de sécurité de 200 m et mettre les personnels en protection derrière des structures en béton
- Refroidissement des bouteilles avec un moyen fixe en JDA avec un débit de 300 l/min
- Ne pas manipuler la bouteille
- Demander une équipe RCH
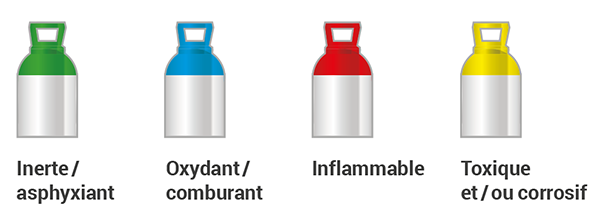
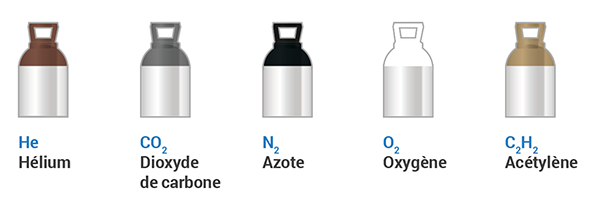
FS 1 VENT
GÉNÉRALITÉS SUR LA VENTILATION OPÉRATIONNELLE
La maîtrise des flux gazeux lors des incendies présente un intérêt pour la sécurité des intervenants, mais aussi pour l'efficacité opérationnelle sur le système feu.
On regroupera sous le vocable de ventilation opérationnelle (VO), l'ensemble des actions entreprises par les sapeurs-pompiers qui concourent à maîtriser les flux gazeux dans la structure impactée par le feu et donc éventuellement la ventilation de celui-ci.
Les actions de ventilation peuvent porter :
- sur la source : le foyer lui-même ;
- sur le flux : fumées, particules ou chaleur dégagées ;
- sur les cibles : personnes, structure en elle-même.
La ventilation opérationnelle consiste à agir sur l'écoulement des flux gazeux.
Les actions portent sur l'ouverture ou la fermeture des ouvrants existants ou créé s (le plus souvent sur les portes, les fenêtres ou autres dispositifs constructifs ou techniques) du ou des volumes du bâtiment. Quand cela est nécessaire, des moyens de ventilation mécanique peuvent être employés.
On appelle « entrant », tout ouvrant permettant l'arrivée d'air dans le volume.
On appelle « sortant », tout dispositif existant ou créé, permettant la sortie des fumées du volume.
Les actions de ventilation réalisées visent en particulier à influencer les différences de pression et créer ainsi un mouvement de l'air, appelé veine d'air.
Afin de mieux appréhender les phénomènes liés à la ventilation opérationnelle dans son ensemble, il est possible de comparer les déplacements gazeux (et les particules en suspension), lors d'un incendie, à ceux de l'eau dans les établissements de tuyaux. Les mêmes lois physiques sont en jeu. L'écoulement de l'eau se fait selon les mécanismes physiques (exemple : la gravité, qui permet d'utiliser le propre poids de l'eau pour purger un tuyau).
La perte de pression progressive est liée aux frottements qui dissipent l'énergie (pertes de charge) auxquels se rajoutent les fuites importantes que l'on rencontre tout au long de la veine d'air.
Le déplacement des gaz est lié à deux principaux facteurs :
- les mouvements d'air naturels dans le volume, liés à la différence de pression (conséquence des mouvements en dehors du volume concerné, par exemple le vent) ;
- les mouvements convectifs liés à la différence de température des volumes de gaz entre eux (les gaz chauds plus légers, mais occupant un plus gros volume ont tendance à s'élever ou à sortir du volume). Quant aux gaz « froids » plus lourds, ils redescendent ou sont aspirés dans le volume en feu (généralement en partie basse) par la dépression causée par l'évacuation des gaz chauds (généralement en partie haute). C'est le principe du tirage dans une cheminée.
On parlera de pression positive si le volume est en surpression par rapport à l'extérieur (ou un autre volume de référence), de pression négative si le volume est en dépression par rapport à l'extérieur (ou un autre volume de référence).
La ventilation opérationnelle permet de répondre à trois objectifs principaux :
- protéger (empêcher les fumées de venir dans un volume) ;
- désenfumer (évacuer les fumées d'un local sans lien direct avec le local en feu) ;
- attaquer (agir sur les fumées et le foyer ; canaliser leur propagation).
- structure et organisation du ou des volumes concernés ;
- courants aérauliques naturels (écoulement de l'air, des fumées et gaz chauds) ;
- cheminements de ces masses gazeuses (couloirs, escaliers, ...) ;
- sens du vent ;
- ouvrants possibles ;
- sortants possibles ;
- éléments de cloisonnement intérieurs (portes...).
Le COS devra préciser la totalité des indications nécessaires pour que l'action soit menée sans ambiguïté. Un ordre pour la mise en oeuvre d'une ventilation doit ainsi comporter selon le type de ventilation concernée :
- la tactique de ventilation (désenfumage, antiventilation…) ;
- le moyen (ventilation naturelle, ventilateur hydraulique…) ;
- les emplacements (tel volume, tel entrant, tel sortant, les accès et les itinéraires de secours). Un ventilateur thermique est généralement positionné à une distance équivalente à la diagonale de l'ouvrant (hauteur de porte si c'est le cas), mais ce positionnement peut être adapté en fonction du modèle utilisé et des circonstances ;
- les actions concomitantes à la ventilation opérationnelle et la chronologie à suivre ;
- les éventuelles consignes particulières (régime de ventilation…) ;
- les règles de sécurité.
- La maîtrise de l'alimentation en air du foyer et du déplacement des fumées est le premier élément de sécurité à respecter : QUI MAÎTRISE L'AIR MAÎTRISE LE FEU.
- La mise en place d'une ventilation opérationnelle d'attaque ne doit pas être entreprise si elle a pour conséquence de placer des victimes ou des intervenants entre le foyer et un sortant.
- L'usage de ventilateurs thermiques impose une vigilance particulière par rapport au risque d'intoxication.
- Les intervenants doivent se sentir concernés et responsables de la qualité de la ventilation opérationnelle (maintien des portes ouvertes ou fermées, interdiction de stationner dans la veine d'air…).
- Les intervenants ne doivent pas s'engager par le sortant.
En fonction des risques liés à la situation et à la technique de ventilation utilisée, il convient de
vérifier que la veine d'air ainsi créeé ne soit pas perturbée et reste pérenne (porte qui se referme,
présence de vent...).
Compte tenu des enjeux liés à l'utilisation de la ventilation opérationnelle dans la lutte contre les incendies de structure, tant pour l'efficacité de l'action que pour la sécurité des intervenants, il est nécessaire de coordonner rigoureusement les actions qui seront choisies.
La communication entre les équipes est un point clé de réussite de la mission (entre chefs d'agrès, mais aussi entre les chefs d'équipes et le chef d'agrès).
Si des restrictions à l'engagement doivent être faites, elles doivent être formulées dans l'ordre initial.
Il peut en être ainsi d'une indication de mise en route d'un ventilateur sur ordre. Il peut alors dire
« vous ne démarrez la ventilation que sur mon ordre ».
FS 2 VENT
VENTILATION THERMIQUE ET RISQUES LIÉS AU MONOXYDE DE CARBONE
Références : GTO ventilation opérationnelle - Fiche VEN-STR-PAR-7
La plupart des ventilateurs utilisés sur les opérations de lutte contre l'incendie sont des ventilateurs thermiques. Il est utile de faire un point sur les risques associés.
Il faut tout d'abord remarquer qu'il n'est pas obligatoire d'avoir recours à des ventilateurs équipés de moteurs thermiques, il est en effet possible d'utiliser des ventilateurs à entraînement hydraulique ou des ventilateurs électriques (éventuellement pour les plus petits sur accus). Cependant les ventilateurs thermiques présentent un intérêt certain, permettant des vitesses de rotation plus élevées que les électriques et bien plus encore que les hydrauliques (pour une taille équivalente).
Quoiqu'un peu plus bruyants, ce sont eux qui constituent l'essentiel du parc embarqué dans les engins incendie en France.
Respirer des gaz d'échappement est nocif, voire dangereux. Toute exposition non justifiée est à éviter. Notons par ailleurs que si le CO est toxique, il est aussi le marqueur de la présence en quantité́ variable d'autres polluants dans les gaz d'échappement (oxydes d'azote, composés volatiles carbonés...).
Compte tenu des risques présentés par les fumées d'incendie, les personnels sont sous protection respiratoire lors des actions pour lesquelles ils se retrouvent dans la fumée.
Les débits d'air générés par les ventilateurs diluent fortement la concentration en CO et autres gaz de combustion.
Il est toutefois fortement conseillé de garder son appareil respiratoire isolant dans la veine d'air générée.
De plus, il est indispensable de veiller à l'entretien de ces équipements, afin de garantir une combustion optimale du moteur.
Les travaux sans protection respiratoire adaptée ne doivent pas se faire sous ventilation thermique.
Les ventilateurs thermiques ont pu être parfois source d'accident sérieux. Il s'agissait systématiquement d'un usage inapproprié́ en particulier de ventilateurs thermiques positionnés en intérieur de locaux souvent en infrastructure.
Il n'est pas impossible de travailler avec des ventilateurs thermiques positionnés en intérieur, mais cela demande une grande attention, une bonne maîtrise des techniques de ventilation et la mise en place d'un contrôle en continu du CO. En effet si la ventilation est efficace, le CO sera éliminé́ au fur et à mesure de sa production et le taux de CO sera stable en aval du ventilateur. Cependant si la ventilation venait à devenir inefficace l'air n'étant plus renouvelé́, le taux de CO peut croitre considérablement alors que le brassage des masses gazeuses au voisinage du ventilateur peut donner l'impression d'une ventilation efficace.
Les techniques utilisant plusieurs ventilateurs, peuvent être mises en oeuvre.
L'usage de ventilateurs non thermiques pour un déblai ne doit pas conduire à abandonner toute
protection respiratoire. En effet, la ventilation risque de mettre en suspension des particules solides
(comme par exemple des cendres, des fibres de verre...), libérées par la destruction thermique des
matériaux, mais aussi accroître la vitesse de désorption de gaz toxiques..
Il est parfois possible d'équiper certains ventilateurs de rallonge(s) de pots d'échappement pour amener les gaz d'échappement au-delà̀ de la zone d'aspiration du ventilateur (supérieure à 2 mètres).
De même d'autres ventilateurs peuvent être équipés de pot catalytiques additionnels ces pots ont une certaine efficacité́ de l'ordre de 50 %, mais peuvent déborder du gabarit initial de ventilateurs, ils peuvent être sources de brûlures, étant portés à très haute température.
À titre indicatif les effets du monoxyde de carbone suivant sa concentration en parties par million sont énumérés ci-dessous.
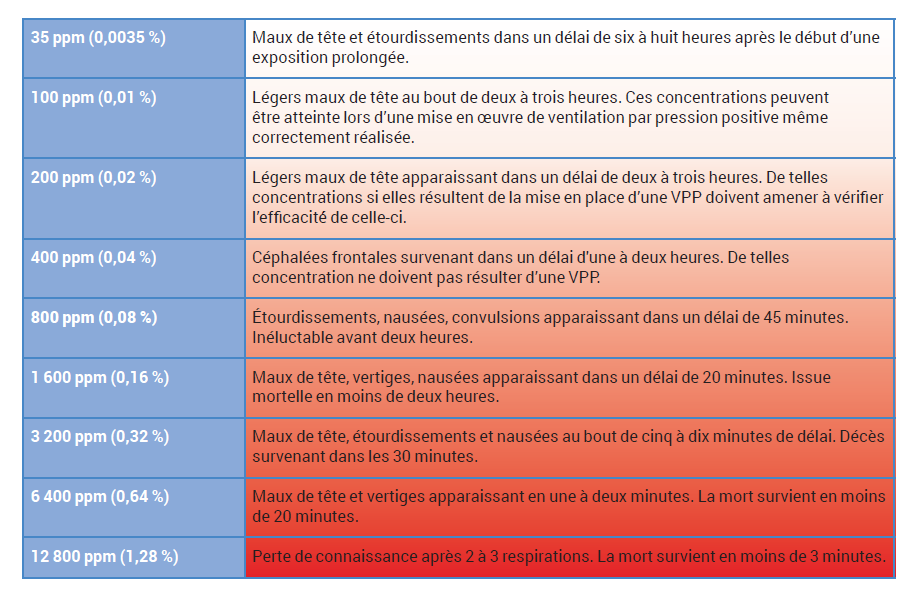
FT 1 VENT
RECLOISONNEMENT DU FEU
Références : GDO ventilation opérationnelle. Fiche VENT-STR-PRO-1
Lorsqu'un feu est présent dans un volume, (chambre par exemple ou cuisine, etc.), si la porte reste ouverte, les fumées se déplaceront dans les différentes pièces de celui-ci, aux communications (couloirs) ainsi qu'aux étages supérieurs. L'objectif est d'isoler le feu des autres pièces, afin que les flammes n'atteignent pas les zones enfumées.
Le principe est de cloisonner le feu dans une pièce.
Cette action de « recloisonnement » considérée comme tactique défensive malgré un engagement du personnel à l'intérieur de la structure, n'a pas vocation à lutter directement sur le feu, mais d'en limiter sa propagation et ainsi, permettre d'autres actions (recherche de victimes en zone enfumée…).
Porte de l'appartement ouverte
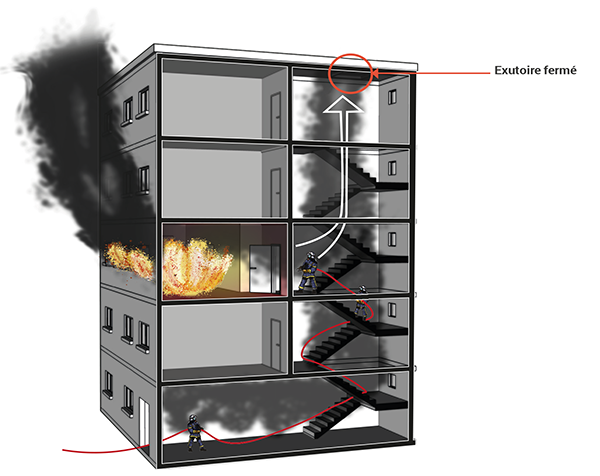
Porte de l'appartement fermée
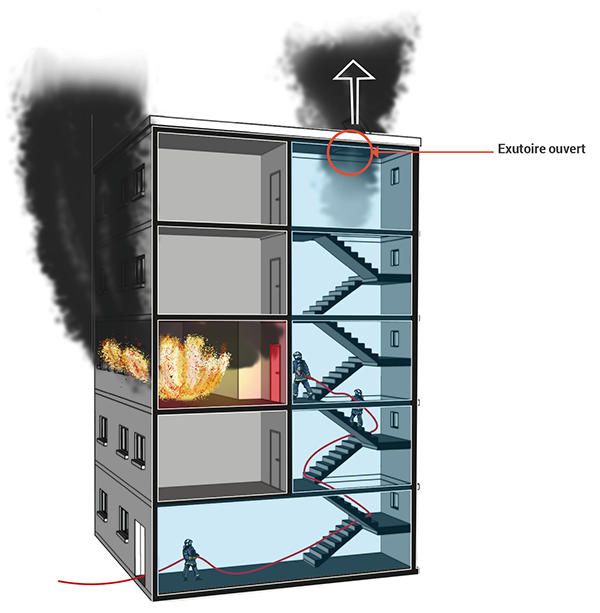
- Fermeture immédiate de la porte du volume sinistré.
- Évacuation et/ou mise en sécurité des personnes présentes dans les parties enfumées.
- Attaque de transition si la situation le permet (ouvrant en façade disponible)
- Attaque offensive par antiventilation et pression positive si un sortant est existant une fois les évacuations terminées.
Le fait de recloisonner un feu par la fermeture d'une porte, permet d'effectuer si besoin et de manière rapide un sauvetage dans les volumes voisins ou dans les étages supérieurs, en engageant du personnel avec moins de risques.
Cette recherche de victimes peut être facilitée si elle est associée à un désenfumage des volumes adjacents.
Cette action peut être entreprise durant la reconnaissance et avant même de l'avoir terminée.
Elle n'expose pas les personnels d'une manière élevée face au sinistre et doit être mise en oeuvre rapidement.
Cette technique s'adapte tout à fait aux feux d'appartements, de villas, etc., où il est possible de comprendre par une reconnaissance rapide, comment est constituée le volume concerné (nombre d'ouvrants).
Cette technique est beaucoup plus difficile à mener dans les locaux plus grands et plus complexes en terme de volume (industrie, habitat ancien).
Le principe de « recloisonner » un feu, dans ce contexte, n'est pas de vouloir l'empêcher de ventiler, par la suppression de l'air, mais plutôt d'empêcher qu'il ne se propage à l'intérieur du bâtiment (contrairement à l'antiventilation).
FT 2 VENT
ANTIVENTILATION
Références : GTO Ventilation opérationnelle Fiche VEN-STR-ATT-2
Cette technique opérationnelle permet de favoriser l'attaque du feu en le privant en grande partie de comburant. L'objectif est de réduire au maximum l'apport d'air au combustible.
Elle se combine avec une attaque hydraulique, qui aura pour effet le refroidissement des fumées et des gaz chauds et l'inertage par la vapeur d'eau produite.
Feu dans un volume de taille moyenne (chambre, cuisine, salon) dans une structure multi-volumes.
L'apport d'air dans la structure est faible. L'ambiance thermique permet l'engagement d'un binôme.
L'attaque en antiventilation est une tactique offensive très agressive puisqu'elle combine une attaque hydraulique du foyer mais aussi sa privation en oxygène.
Elle suppose une progression dans la fumée et un engagement proche du foyer.
La sécurité des intervenants est liée au maintien de l'antiventilation du volume concerné. Son décloisonnement peut générer un apport d'air suffisant pour favoriser un phénomène thermique si l'équipe n'a pas eu le temps de refroidir ou d'inerter les gaz présents.
L'antiventilation d'attaque peut se décomposer selon quatre phases décrites ci-après.
L'équipe pénètre dans la structure concernée (appartement, maison, compartiment, magasin, espace de bureaux, ...).
Si la température des fumées le permet, le BAT cherchera à refroidir ou inerter celles-ci lors de sa progression par des impulsions courtes les plus fines possibles. Le mouillage des plafonds et murs en partie haute est également une technique possible, pour sécuriser l'accès, en cas de montée en température en partie haute, l'eau s'évaporera, en créant un refroidissement et un inertage partiels.
La porte d'accès aux locaux concernés par le feu est refermée, laissant juste le passage du tuyau, ainsi la surface d'échange sera réduite (estimée à environ 0,2 m2).
Pour pallier la difficulté de refermer les portes en laissant le passage du tuyau, ou pour en compléter l'efficacité, il peut être fait usage de stoppeurs de fumées. Ceux-ci auront également l'avantage de s'opposer au passage des fumées en partie haute des ouvrants.
Limiter fortement le risque de phénomène thermique dans l'ensemble des volumes enfumés.
La première porte d'accès est refermée sur le tuyau afin de minimiser l'apport d'air
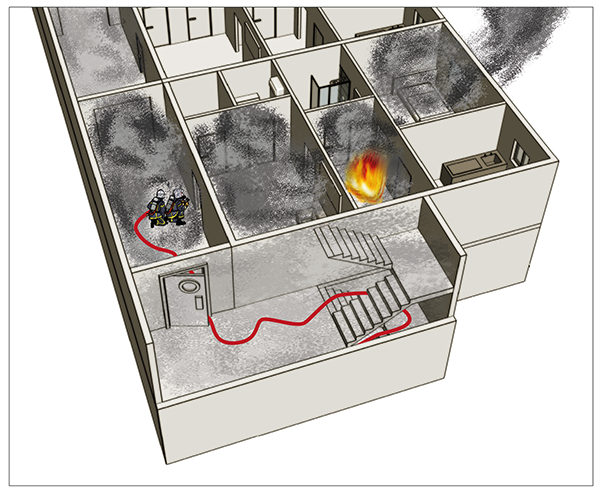
Le binôme d'attaque effectue une impulsion dans le volume source du foyer en fonction des indicateurs, puis referme l'ouvrant si l'ambiance thermique est importante.
La porte du volume source étant maintenue fermée, il est possible de désenfumer les volumes adjacents en utilisant les moyens adaptés aux circonstances (complexité de la structure et localisation de la zone à traiter, moyens disponibles) : ventilation naturelle, surpression depuis l'extérieur , ou encore hydraulique avec une lance, si les volumes sont faibles.
Le feu est privé d'oxygène et la vaporisation de l'eau va permettre le refroidissement et l'inertage du volume. Le feu est donc maintenu en antiventilation (par le recloisonnement).
Dans les locaux adjacents, le risque est considérablement réduit, augmentant le taux de survie d'une éventuelle victime non encore extraite et/ou permettant de concentrer les équipes sur d'autres actions.
Après l'impulsion la porte du local en feu est refermée
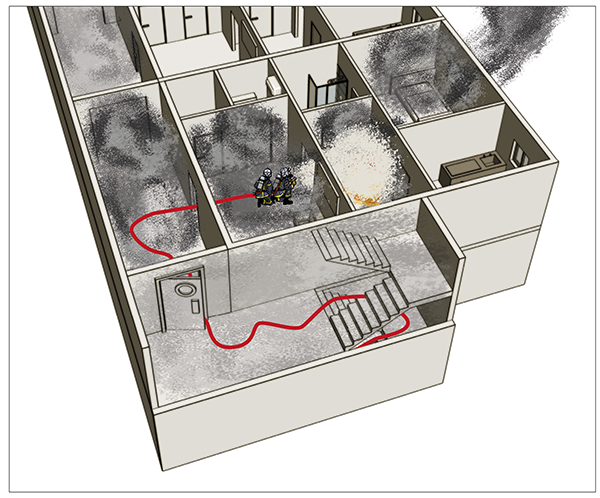
L'opération sur le volume source, décrite précédemment, est renouvelée plusieurs fois si nécessaire.
Si la température intérieure semble avoir diminué au point que la vaporisation de l'eau n'est plus envisageable, il est nécessaire de pénétrer dans le volume.
L'extinction va évoluer d'une action attendue d'inertage vers une action de refroidissement des combustibles.
L'atmosphère du volume n'est plus alimentée en gaz donc le maintien d'une atmosphère inertée par la vapeur d'eau n'est plus nécessaire même s'il peut demeurer une petite zone de combustion susceptible de générer des petites flammes. C'est donc maintenant une ventilation du local sur ordre qui est réalisée (ouverture d'une fenêtre, ouverture en grand de la porte).
- Assurer la sécurité des intervenants et procéder à l'extinction d'abord par l'inertage.
- Finaliser l'extinction du foyer, par la mise en oeuvre des actions de déblai.
Il est important d'associer à l'antiventilation d'attaque des moyens hydrauliques adaptés.
La nécessité n'est pas d'apporter beaucoup d'eau mais surtout de la vaporiser.
La quantité d'eau qu'il est nécessaire de vaporiser pour obtenir l'inertage est faible, sachant qu'un litre d'eau fournit à 100 °C, 1,7 m3 de vapeur, et que l'atmosphère sera inertée quand la vapeur d'eau représentera environ le tiers de la masse gazeuse.
La difficulté peut résulter paradoxalement d'un manque de chaleur dans le local en particulier si celui-ci a peu accumulé de chaleur en raison par exemple de pertes aux parois importantes.
Après avoir traité le volume gazeux, source principale de danger et de propagation, on recherchera le mouillage des combustibles (grosses gouttes, voire jet purge sur les braises), pour finaliser l'extinction. En effet, le mouillage des braises va permettre de continuer de générer de la vapeur d'eau (maintien de l'inertage), de stopper la production de gaz de pyrolyse et d'éliminer les zones de ré-inflammation.
L'usage de caméras thermiques pour cette phase qui est effectuée sans visibilité, peut être un véritable atout pour rechercher les points chauds (poches de gaz et fumées les plus chaudes, parois échauffées, braises).
Il sera donc possible ensuite, de réaliser une ventilation ou un désenfumage des locaux en ayant largement réduit le danger.
L'exemple d'application opérationnelle choisi ci-dessus montre que l'antiventilation est une technique de maî- trise des flux gazeux qui peut revêtir des aspects différents :
- recloisonnement ;
- recloisonnement après chaque impulsion d'une attaque de l'extérieur du local ;
- ventilation freinée par entrebâillement de porte lors d'une pénétration du BAT dans les locaux enfumés ou soumis à l'incendie.
Ces techniques ne présentent pas de difficultés de mise en oeuvre.
Il est malgré tout important de maîtriser l'enchaînement des séquences, ce qui suppose une bonne compréhension de la tactique dans sa globalité, une bonne coordination entre le binôme d'attaque et les autres équipes, ainsi qu'une bonne aptitude à l'utilisation et au réglage de sa lance.
Les risques présentés par l'antiventilation couplée à une attaque offensive peuvent résulter :
- de la rupture non souhaitée d'un ouvrant pouvant générer un changement plus ou moins brutal du régime de combustion (se méfier des simples vitrages et des huisseries PVC) ;
- de la non maîtrise du passage de la sous-ventilation à la ventilation après inertage et mouillage ;
- l'engagement de personnels non aguerris dans des ambiances chaudes et opaques ;
- d'un engagement qui dure trop longtemps.
Si la température en partie supérieure des volumes ne dépasse guère les 300 °C en général, l'absence de stratification marquée peut amener la température à plus de cent degrés à la hauteur des intervenants.
Attention : même avant le début de l'inertage, la teneur de l'atmosphère en vapeur d'eau peut être importante. En se condensant sur le corps du SP (qui est plus froid que les fumées), celle-ci lui délivre de la chaleur (chaleur latente de changement d'état) et peut générer de l'inconfort, voire des brûlures.
Les températures des locaux soumis à des feux sous ventilés dépendent entre autres :
- de la durée de l'incendie ;
- du facteur de ventilation ;
- de l'inertie et de la conductivité des cloisons.
Plus les températures sont élevées, plus la pyrolyse est importante mais plus la vaporisation de l'eau sera aisée.
Des températures basses peuvent se rencontrer sur des feux couvant n'ayant que peu chauffé la pièce ou pour des feux dont la puissance a décru après une première phase de développement rapide. Dans un cas comme dans l'autre l'inertage est assez difficile. De fines gouttelettes en suspension ont des effets similaires à la vapeur d'eau sous forme gazeuse pour rendre l'atmosphère moins inflammable.
FT 3 VENT
VENT DÉSENFUMAGE D'UN OU PLUSIEURS VOLUMES
Références : GTO ventilation opérationnelle VENT-STR-DEF-1 et VENT-STR-DEF-2
Il s'agit de créer un déplacement gazeux pour permettre à de l'air frais de prendre progressivement la place des fumées qui seront rejetées à l'extérieur.
Le feu est éteint ou suffisamment isolé de l'appartement envahi par les fumées (pas de possibilité d'allumage des fumées par le foyer initial).
Les fluides gazeux sont mis en mouvement grâce à la réalisation d'un gradient de pression depuis le point d'entrée que l'on aura déterminé pour l'air frais (entrant) et le point de sortie des fumées (sortant). Le terme gradient de pression signifie que celle-ci varie (diminue dans le présent cas) progressivement tout au long du cheminement de l'air (veine d'air). Les fluides se déplacent spontanément des zones de haute pression vers les zones de plus basse pression.
Cette action peut être considérée comme défensive puisqu'elle n'expose nullement les sapeurs-pompiers au risque.
Une reconnaissance permet de choisir ou de privilégier le trajet de la veine d'air et son intégrité :
- réalité du cloisonnement par rapport au feu ;
- absence de fuites (fermeture des portes et fenêtres situées en périphérie de la veine d'air).
Par la suite, il est nécessaire de ne pas de créer de pertes de charges dans la veine d'air et de limiter la présence de sapeurs-pompiers dans la veine d'air et/ou dans les circulations.
Un ou plusieurs sortants sont réalisés (de préférence de manière non destructrice). Ils sont réalisés en tenant compte du vent extérieur si celui-ci est marqué.
Un ventilateur est placé à l'entrant et mis en oeuvre pour créer le gradient de pression, on l'utilisera à sa puissance maximale, toutefois celle-ci pourra être réduite par exemple pour éviter la destratification des fumées, l'important étant d'évacuer les fumées les plus concentrées possibles, et non l'air frais introduit par le ventilateur.
La vitesse des fumées au sortant permet de s'assurer de l'efficacité de la ventilation. A défaut on vérifiera :
- l'absence de vent contraire au niveau du sortant ;
- l'intégrité de la veine d'air (attention aux portes intermédiaires non calées qui peuvent se refermer sous l'effet du courant d'air) ;
- le bon fonctionnement du ventilateur.
Il est à noter que cette manoeuvre permet de remplacer un air fortement pollué par un air non exempt de gaz d'échappement si on utilise un ventilateur thermique. Prendre en compte le risque d'intoxication.
La présence d'un vent ayant une vitesse supérieure à 18 Km/h empêchera très probablement les fumées de sortir.
Il est admis que si un vent extérieur vient en direction du sortant, la technique de désenfumage perd en efficacité si ce vent a vitesse > 18 km/h (5m/s).
Il est impératif de conserver à l'esprit que dans certains cas les fumées peuvent être combustibles voire explosives. Cette manoeuvre ne présente pas de risque particulier dès lors qu'on est sûr que le feu (s'il est toujours actif) ne peut atteindre la veine d'air.
Pour être efficace il faut que le choix du ventilateur soit adapté en particulier en termes de puissance par rapport aux caractéristiques physiques de la veine d'air :
- géométrie de l'entrant et du sortant ;
- longueur et pertes de charges singulières de la veine d'air (obstacles, coudes…) ;
- taux de fuites.
Plus le volume à désenfumer est important, plus le temps nécessaire sera long.
Une grande partie de l'efficacité de la manoeuvre dépend de la forme générale de la veine d'air. Plus celle-ci sera tubulaire plus le désenfumage sera rapide (effet piston, l'air frais poussera les fumées vers le sortant sans se mélanger à elles).
Au contraire, si la veine d'air est plus massive, l'air frais aura tendance à se mélanger avec les fumées qui resteront plus volontiers dans les espaces morts, limitant donc le rendement d'évacuation des fumées.
Le gradient de pression entre l'entrant et le sortant peut être réalisé par la mise en place d'un ventilateur à l'entrant, mais il peut aussi avoir une origine naturelle. Par exemple si l'entrant est situé sur une face exposée au vent alors que le sortant est sur une face abritée.
Un deuxième cas de figure est la présence naturelle du gradient de pression entre un entrant situé en partie basse et un sortant en partie haute par tirage naturel lié à la chaleur des fumées.
Dans le cas du désenfumage d'un volume enfumé compartimenté (exemple : un couloir qui dessert plusieurs pièces dans un appartement ou dans un bâtiment).
Les pièces sont désenfumées successivement. On modifie à chaque fois la veine d'air pour conserver au mieux l'effet piston.
Ventilation séquentielle

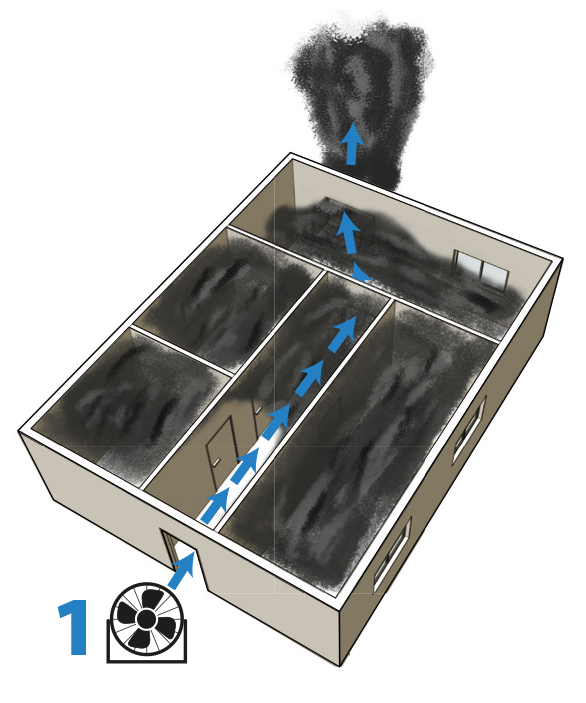
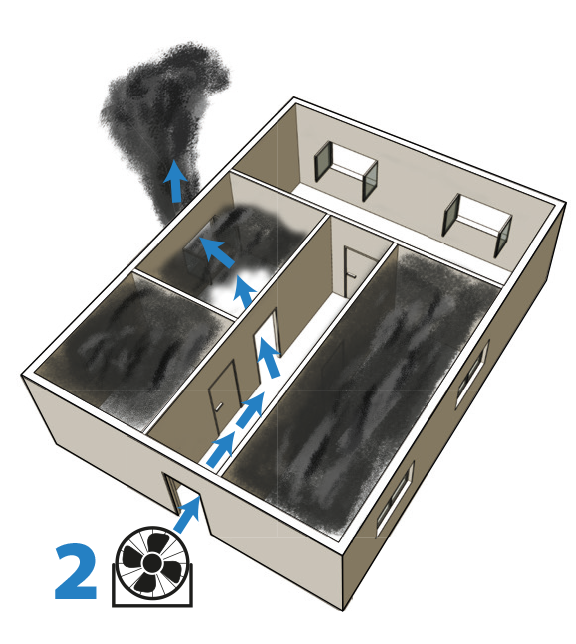
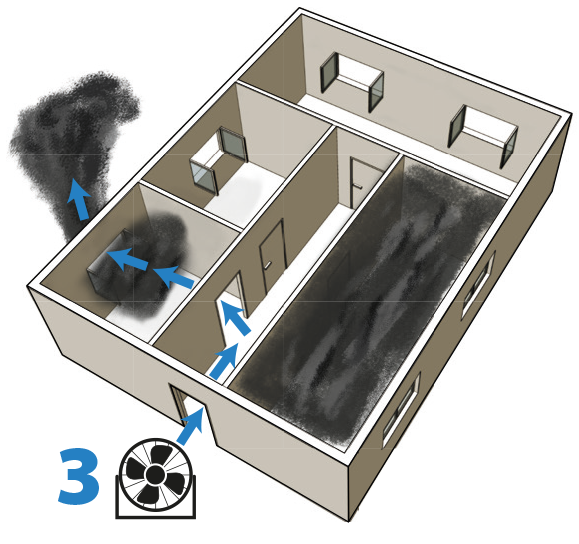
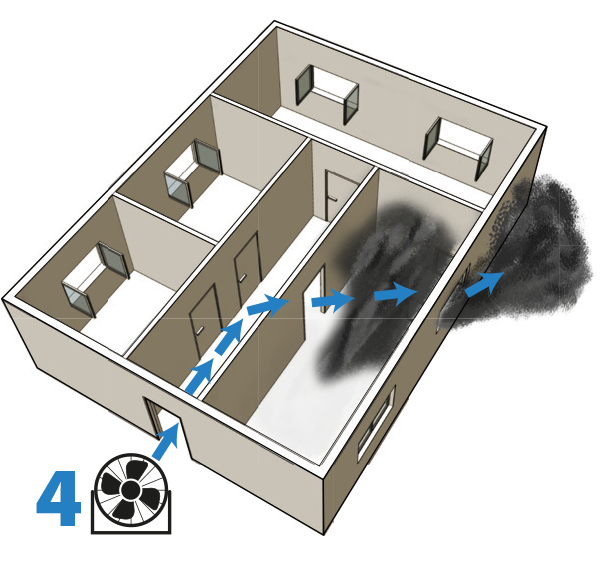
On commencera par désenfumer une des pièces situées à l'extrémité de la circulation si possible. Ainsi cette circulation sera totalement libérée des fumées assez rapidement. Pendant le désenfumage de cette pièce, toutes les autres sont fermées.
La ventilation séquentielle (les volumes unitaires sont ventilés les uns après les autres) ou en si- multanée dépend de la configuration des lieux et par conséquent des pertes de charges associées. En effet, la veine d'air initialement créée sera divisée entre ces différents volumes, en fonction des sortants associés. Ainsi, si les pertes de charges dans les différentes veines d'air ainsi créées sont assez similaires, les débits aux sortants seront équilibrés, le désenfumage simultané sera efficace et plus rapide.
Veines d'air équilibrées en pertes de charges : bonne efficacité d'un désenfumage en simultané
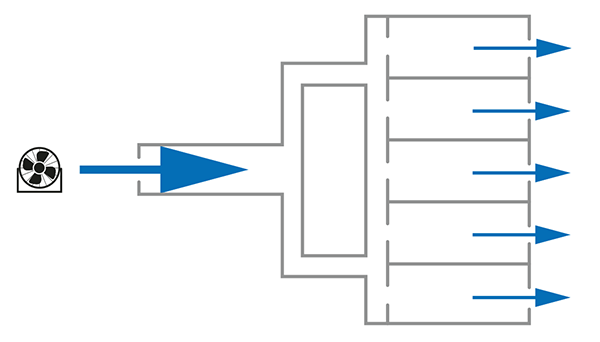
À l'inverse si les pertes de charges le long des différentes veines d'air sont trop inégales, certaines veines d'air seront très défavorisées et le désenfumage dans les pièces concernées considérablement ralenti. Il sera préférable de faire appel au désenfumage séquentiel.
Veines d'air déséquilibrées en pertes de charges : mauvaise efficacité d'un désenfumage en simultané
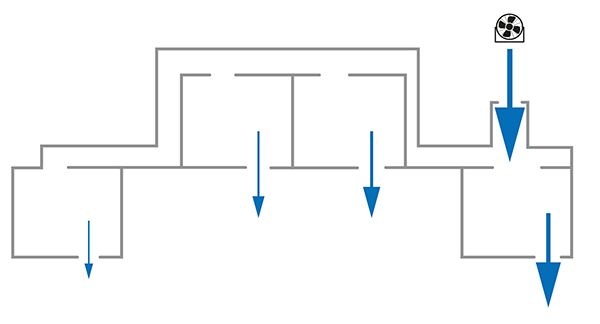
FT 4 VENT
DÉSENFUMAGE AVEC UN MOYEN HYDRAULIQUE
Références : GTO Ventilation opérationnelle Fiche VEN-STR-PAR-8
Pour retrouver de la visibilité en fin d'extinction, ou pour repousser les gaz chauds, le porte-lance peut utiliser l'énergie cinétique de l'eau qu'il projette avec sa lance, pour créer un déplacement gazeux.
La lance en jet diffusé projette vers l'avant des gouttelettes d'eau. En grand nombre, elles vont pousser l'air devant elles qui se met en mouvement. Cette accélération de l'air entraîne l'air avoisinant (effet venturi).
Une attention particulière doit être portée sur le sens du tirage naturel dans le choix de l'ouvrant à utiliser.
Le porte-lance se place à environ un mètre face à l'ouvrant, sa lance au débit maximum en jet diffusé (l'angle d'ouverture permettant à la totalité du jet de franchir la fenêtre).
Le jet diffusé ne doit pas toucher les bords de cette dernière. En fonction de la taille de l'ouvrant on peut éventuellement se rapprocher ou s'éloigner afin d'augmenter le débit d'air. Le porte lance peut mesurer son action par rapport à la quantité d'air qu'il sentira alors sur lui.

Une dépression est créée dans le volume qui doit posséder par ailleurs un entrant et un sortant. Les fumées présentes sont ainsi refoulées vers l'extérieur.
Le débit d'extraction est significatif, rendant cette technique de ventilation efficace. Elle comporte néanmoins deux inconvénients :
- elle n'est pas utilisable pendant l'attaque, en effet l'aspiration créée met, de facto, le porte-lance sur le trajet des fumées ;
- elle nécessite de projeter l'eau par les fenêtres ce qui peut poser parfois des problèmes en milieu urbain.
FT 5 VENT
LE STOPPEUR DE FUMÉES
Références : GTO ventilation opérationnelle VENT-STR-PAR 5
- Contôler le mouvement des fumées.
- Diminuer l'apport en comburant donc limiter la puissance du feu.
- Faciliter les évacuations par les communications existantes.
- Faciliter la progression et la sécurisation des binômes engagés.
- Faciliter la gestion des ouvrants (passage du tuyau sous le stoppeur).
- Sécurisation d'un forcement des accés.
- Évaluation du feu avec les mouvements du rideau.
- Limiter les dommages engendrés par les fumées.
Les stoppeurs de fumées ont pour vocation d'empêcher les fumées de sortir par la porte d'entrée de la structure (ex. : porte palière) quand les sapeurs-pompiers y pénétreront pour l'attaque. Ceci permet de conserver une zone de repli sécurisé, et limite les dégâts liés aux fumées.
Avant l'ouverture de la porte palière les sapeurs-pompiers mettent en place un stoppeur de fumée.
Afin d'opitimiser son utilisation il doit être placé aussi prés que possible du volume où se situe le foyer
Son rideau tombe librement en partie basse, réduisant considérablement les flux d'air mais laissant le passage libre pour le BAT et le passage du tuyau tout en limitant au maximum l'apport d'air.
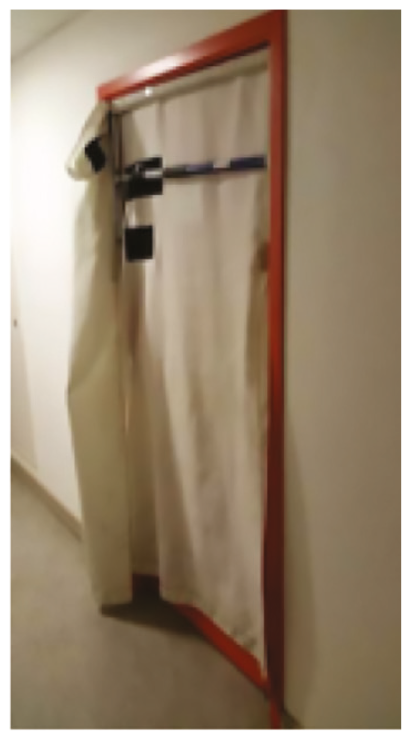

Le stoppeur de fumée va maintenir le feu en sous-ventilation. L'attaque se fera avec une visibilité très faible, toutefois le foyer perdra de son intensité.
La progression est donc assez rapide, la sécurisation des fumées et l'extinction ne devraient pas nécessiter des débits importants. L'usage d'une caméra thermique est un plus dans cette situation.
Le feu en sous-ventilation, génère des fumées chargées en imbrûlés. La précaution importante sera donc lors de la progression de refroidir et de saturer de vapeur d'eau ces dernières, en procédant à des applications d'eau raisonnées. Cet objectif vise à empêcher l'inflammation potentielle des gaz, en gardant à l'esprit qu'ils stagnent dans le volume. L'absence d'oxygène induira une diminution de la puissance du foyer et limitera les risques d'inflammation.
Au point de pénétration, il est préférable que le binôme de sécurité et les autres intervenants éventuels soient capelés, s'ils sont à proximité immédiate du rideau.
Dans un feu ventilé en phase de croissance ; une couche de fumée se forme dans le volume. Ces fumées envahissent progressivement les volumes adjacents. L'abaissement lent de la couche de fumée, laissera une visibilité confortable ; au moment où le stoppeur de fumées est mis en place, cette même couche de fumée va très vite baisser. Ce qui réduira considérablement la visibilité.
Lorsqu'un vent extérieur est présent, il faut rester vigilant au risque de rupture d'un ouvrant type vitrage. Dans un pareil cas une inflammation brusque, liée à l'apport d'air extérieur pourrait engendrer un embrasement des fumées. C'est pourquoi il est important de refroidir les fumées au fur et à mesure de la progression.
Plusieurs usages sont possibles. Ils sont décrits ci-après.
À l'arrivée des secours, la porte palière est fermée. Avant de la forcer, les binômes positionnent le stoppeur de fumée. Ainsi, à l'ouverture de la porte, l'apport d'air sera limité et très peu de fumée envahira le couloir. Lors de la progression du binôme, le rideau stoppera les fumées tout en facilitant le passage du tuyau et des binômes.
Le chemin de repli est alors mieux sécurisé et le fait de ne pas apporter d'air évite également la croissance du foyer.
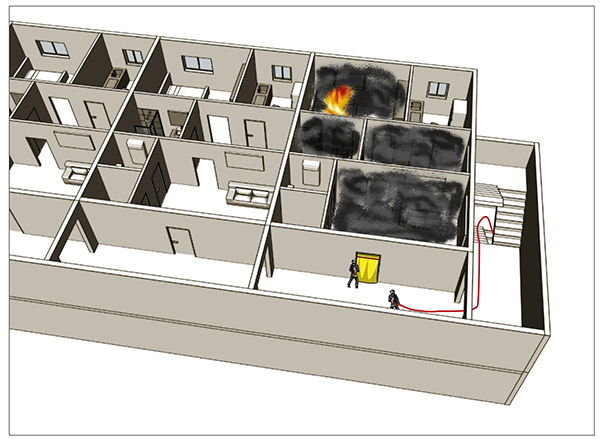
À l'arrivée des secours, une fenêtre est ouverte, ainsi que la porte palière. Le binôme sécurise la cage d'escalier au moyen d'un stoppeur de fumée. Le foyer ne peut prendre que très peu d'oxygène au niveau de la porte. Il le prendra alors au niveau de la fenêtre.
Une fois le stoppeur de fumée en place on peut procéder au désenfumage de la cage d'escalier, pendant ce temps le binôme peut pénétrer dans l'espace enfumé. Dans ce cas, la fumée ne peut plus se propager dans la cage d'escalier, et permet de disposer d'une zone de repli sécurisé. Le ventilateur peut alors tourner à bas régime pour augmenter légèrement la pression dans la cage d'escalier.
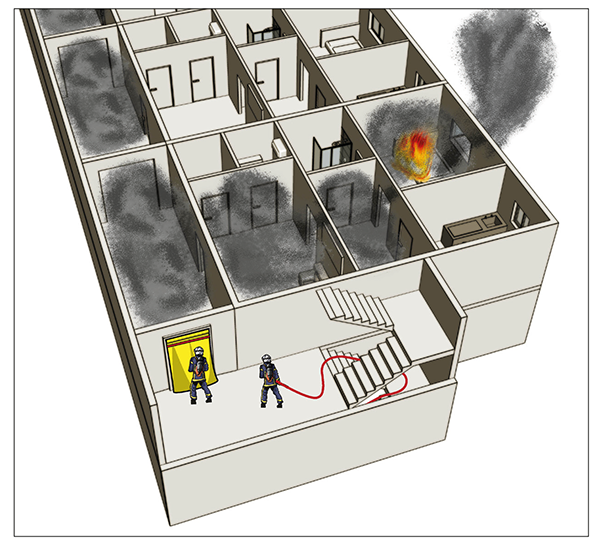
Pour augmenter l'efficacité de certains ventilateurs, on peut utiliser un stoppeur de fumée afin de réduire la taille de l'entrant, par exemple, pour une recherche de mise en surpression d'un volume
FS 1 DEBL
LE DÉBLAI
Références : GDO feux de structures - RIM
Les déblais facilitent l'extinction et limitent les risques de reprise de feu.

Ils consistent à s'assurer qu'il n'y ait plus de matière en ignition, il faut gratter les bois, inspecter l'ensemble du mobilier (dessus, dessous et derrière), évacuer les objets fortement carbonisés ainsi que les matériaux qui menaceraient de s'écrouler. Pour cela, le personnel utilisera des outils tels que pelles, pioches, outils de forcement et de déblai, fourche ou gaffe…
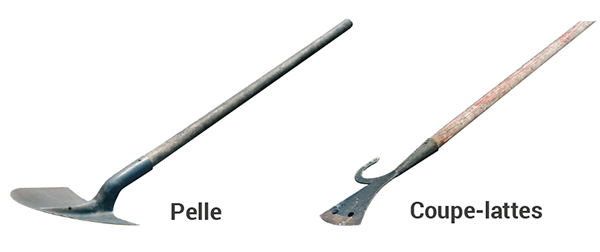
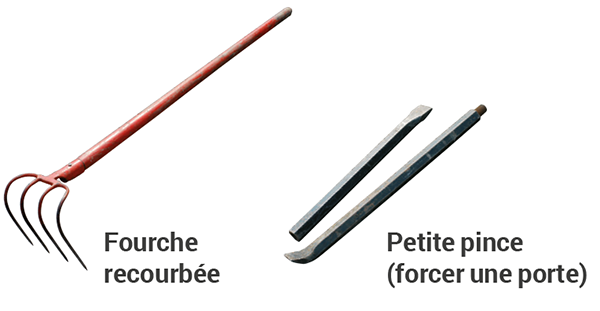
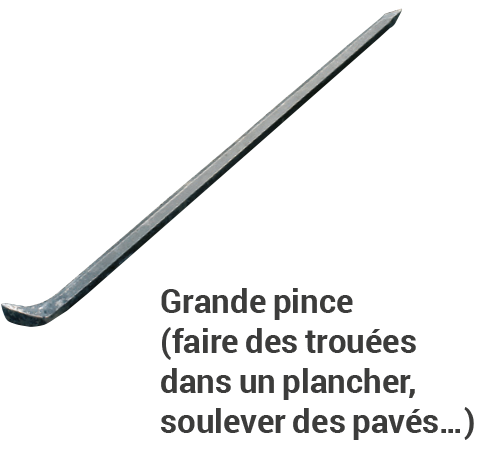
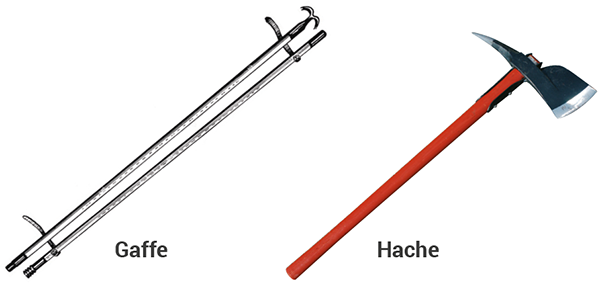
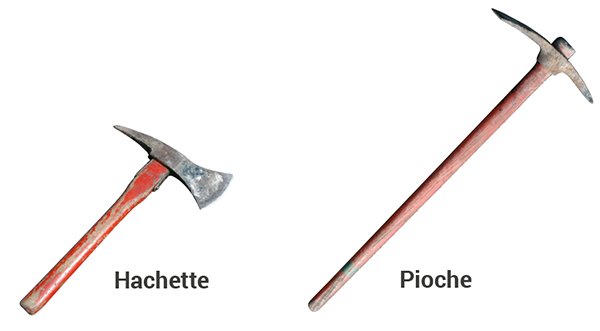

L'utilisation de la caméra thermique peut être judicieuse, mais attention à ses interprétations.

Ils sont propices aux expositions des personnels aux toxiques gazeux (CO, Nox...) et aux risques de fragilisation des structures. Ils sont parfois effectués par les premiers intervenants qui auront participé aux phases initiales du sinistre (fatigue, baisse de vigilance, port de l'ARI).
Dans certains cas (victimes retrouvées décédées, origine suspecte du feu), les opérations de déblais peuvent être entreprises après concertation entre le COS et un officier sensibilisé ou formé à la RCCI, le déblai pourra alors être limité ou retardé.
Pendant les opérations de déblai de nombreuses particules fines sont en suspension dans l'air, du CO en quantité non négligeable, de l'acide cyanhydrique, des hydrocarbures poly-aromatiques et des composés organiques volatils peuvent aussi être présents.
Le port de l'ARI est essentiel pendant cette phase ainsi que des mesures régulières du taux de CO au moyen de toximètre.

Dans certains établissements, il se peut que l'on retrouve des détecteurs ioniques qui contiennent des sources radioactives. Le COS prendra toutes les mesures nécessaires pour effectuer une levée de doute visant la protection du personnel contre le risque d'exposition à toute radioactivité.
Il sera également pris en compte au cours de cette phase la surveillance de la stabilité de la structure (surcharge par les eaux d'extinction, fragilisation de la structure...)
FM 1 EXP10
ARICO SCOTT

| Famille : | Air respirable |
| Type | ARICO |
| Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert | |
| Marque : | SCOTT | Harnais : | « Propak » poids environ 3 kg en résine renforcée par fibre de verre. Lanière et rembourrage en fibres kevlar et Nomex. |
Masque : | « Vision 3 » encliquetage par brides F1. | Bouteille : | acier allégé pression d'utilisation 300 bar, capacité 6 l. |
Créer et maintenir une atmosphère respirable isolée de l'air extérieur infecté.
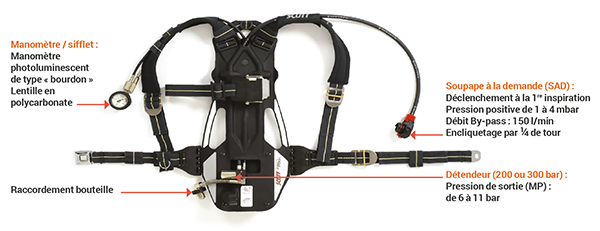
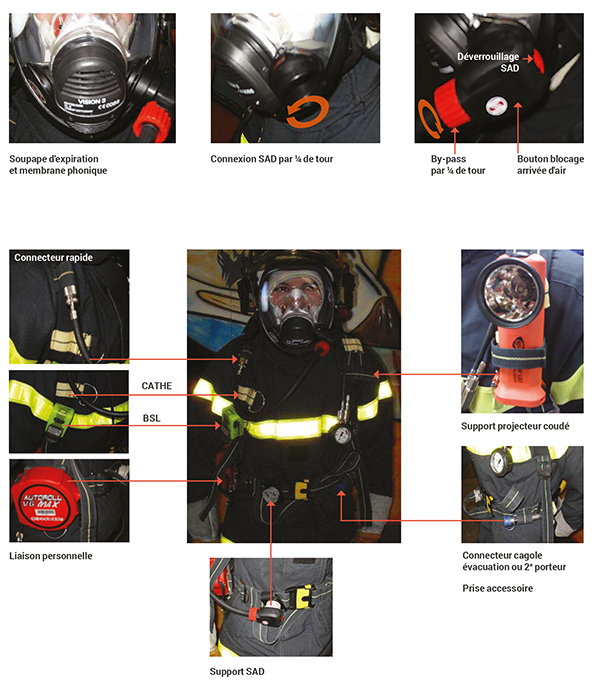
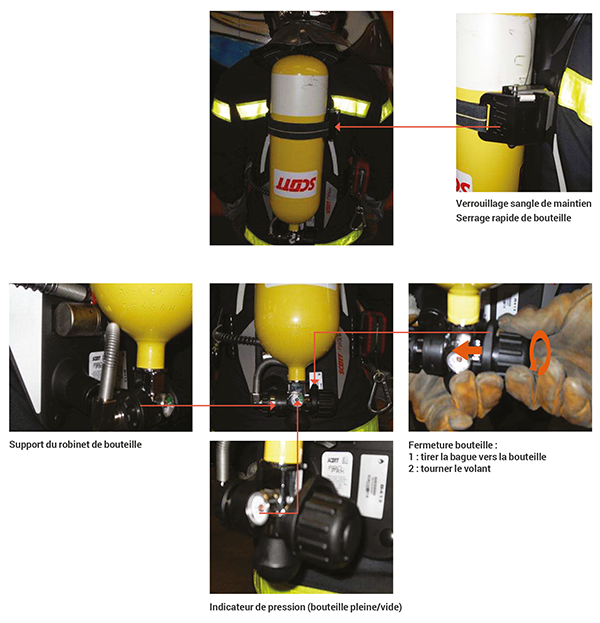
Nettoyer à l'éponge non abrasive et à l'eau le dossard et le masque (attention, aucune pièce du dossard ou du masque ne doit être démontée).
Vérifier le bon fonctionnement et l'absence de fuite : après ouverture de la bouteille, la pression de ne doit pas chuter de plus de 10 bar en 1 min.
Attention le manomètre sur la bouteille n'indique pas la pression précise dans la bouteille.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 2 EXP20
BOUTEILLE ARI MÉTALLIQUE SCOTT

| Famille : | Air respirable |
| Type : | ARICO |
| Prix d'achat : | 202,80 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Bouteille d'air comprimé en acier allégé 6 l, 300 bar munie d'un robinet à limitation de débit. | |
| Poids à vide : | 7,27 kg | Pression utilisation : | 300 bar | Volume en eau : | 6 l |
Réserve d'air comprimé pour le porteur d'ARI.

Chaque bouteille est suivie dans l'outil de gestion des matériels assisté par ordinnateur du SDIS (GMAO). Elles sont identifiées par deux numéros uniques :
- le numéro de série attribué par le constructeur gravé sur le corps de la bouteille (exemple MV5366) ;
- un code-barre interne au SDIS 38 (exemple 09EXP200001) ;
- le code-barre commence par l'année de mise en service de la bouteille par le SDIS, et non l'année de fabrication de la bouteille.
Les bouteilles d'ARI sont des appareils à pression qui doivent suivre des contrôles réguliers.
- Inspection périodique : tous les 40 mois à partir de la date de fabrication (gravée sur la bouteille Année/mois), puis à partir de la date de dernière inspection.
- Requalification : tous les 10 ans à partir de la date de fabrication, ou à partir de la date de dernière requalification (gravées sur la bouteille année/mois).
Après chaque inspection ou requalification un rapport d'inspection est réalisé, une étiquette apposée sur la bouteille. Le suivi est tracé dans l'outil de gestion des matériels assisté par ordinateur du SDIS (GMAO).

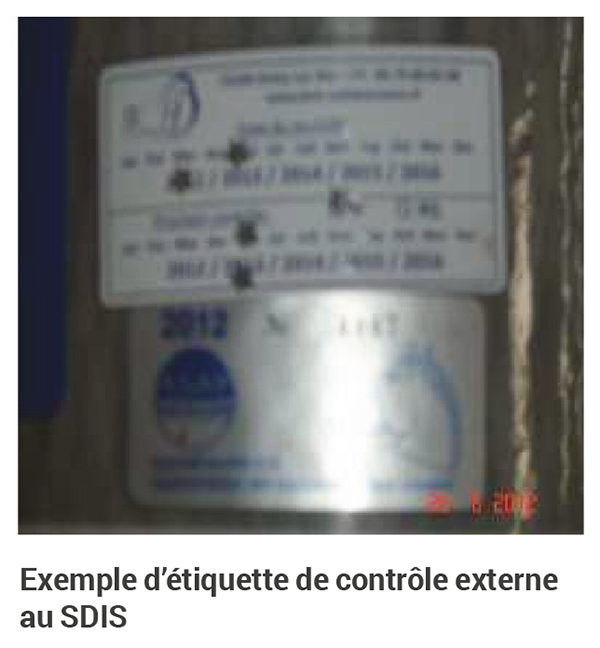
Depuis 2016, le SDIS 38 a commencé la campagne de requalification des bouteilles acquises en 2009. À cette occasion un marquage couleur se met en place.
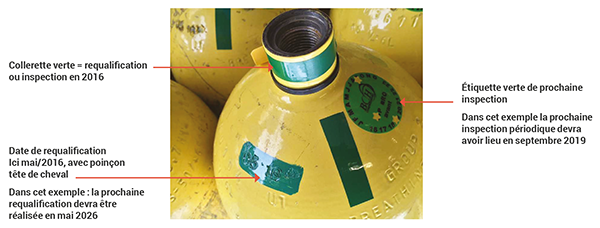

Pour faciliter la gestion des bouteilles du centre de formation départemental et des deux bureaux formation des groupements territoriaux, les bouteilles qui leur sont affectées sont peintes de couleurs différentes :
- CFD : couleur : noir ;
- Bureau formation Gsud : couleur : rouge ;
- Bureau formation Gnord : couleur : bleu.
Après utilisation la bouteille peut être nettoyée :
- à l'extérieur avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse ;
- ne pas utiliser d'outils de nettoyage rugueux (brosses, etc.) ni de nettoyants ou de solvants.
- Ne pas faire tomber la bouteille.
- Ne pas retirer les marquages de couleur d'aide à l'identification.
- Signaler immédiatement toute bouteille qui est tombée ou a subi un choc important. Elle doit être retirée sans délai du service opérationnel.
Procéder à un examen visuel de la bouteille permettant
- de vérifier que les dates d'inspection ou de requalification ne sont pas dépassées ;
- de détecter les fuites, les traces de choc, d'attaque chimique...
En cas de doute, de date d'inspection périodique ou de requalification dépassée la bouteille ne doit pas être gonflée. Elle doit être signalée immédiatement au bureau maintenance. Un technicien peut aussi vous conseiller par téléphone.
Sans objet
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 3 EXP99
CAGOULE DE SAUVETAGE À FLUX CONSTANT

| Famille : | Air respirable |
| Type : | ARICO |
| Référene : | 1032984 |
| Prix d'achat : | 150 € TTC |
| Date de mise en application : | 2 octobre 2017 |
Le kit de sauvetage permet aux sapeurs-pompiers d'extraire une personne d'un environnement dangereux avec une source d'air frais. Il se connecte simplement sur un ARI pour permettre le sauvetage.
Sauvetage et extraction d'une personne d'un environnement dangereux (incendie…).
La cagoule d'évacuation est à brancher sur le raccord second porteur (raccord mâle en bout de tuyau).
Le flux d'air est constant à 25 l/min. L'autonomie de la bouteille est donc réduite en cas de connexion d'un ensemble de sauvetage
L'autonomie théorique d'une bouteille 6 l à 300 bar avec une cagoule seule est de 72 mm.
L'ensemble de sauvetage est conditionné dans un sac de transport fabriqué à partir de polyester ignifuge en PVC enduit. Il peut s'attacher à la ceinture de l'ARI.
La cagoule est conçue pour s'adapter à toutes les tailles des têtes et le cache en col élastomère, ce qui facilite l'enfilage des lunettes, des barbes et des cheveux longs.

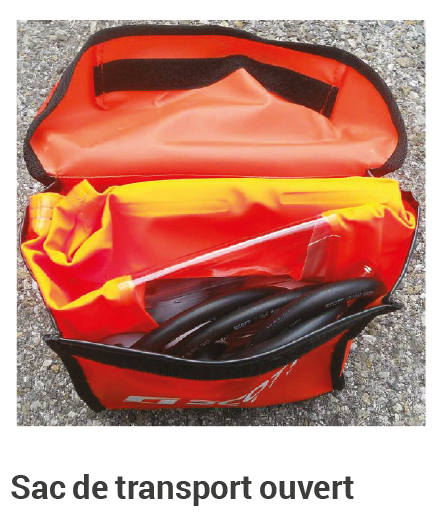

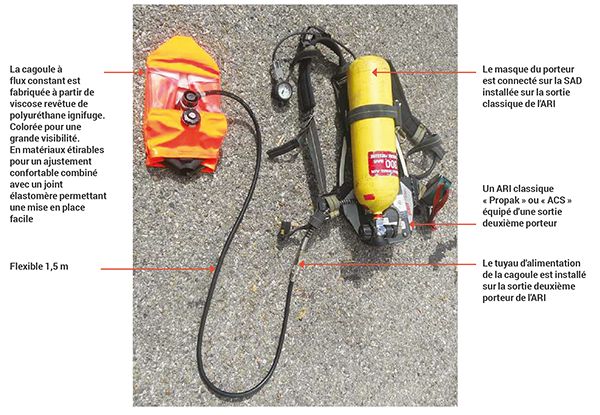
L'utilisation se fait sur un ARI dont la bouteille est ouverte.
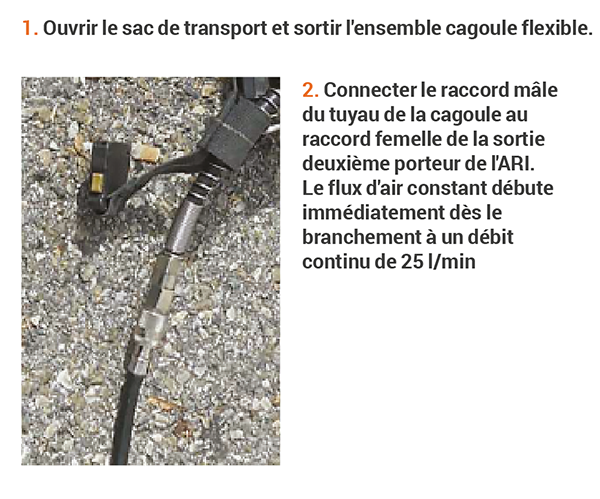


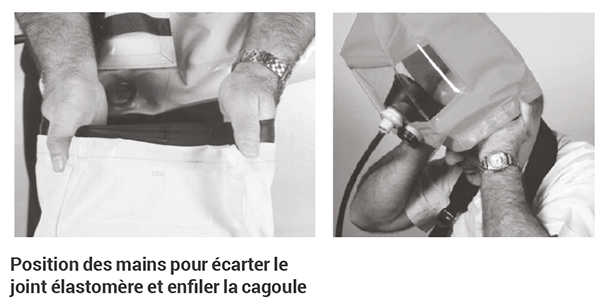
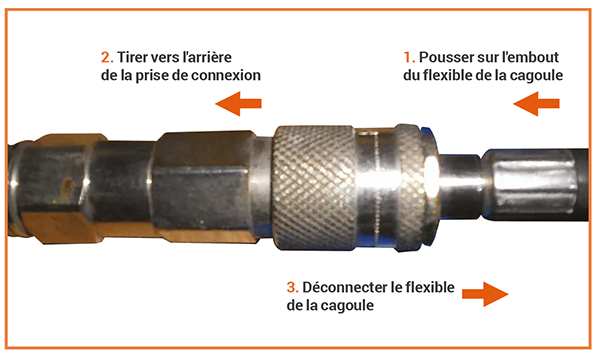
Lorsque la cagoule est déchirée son remplacement se réalise simplement.



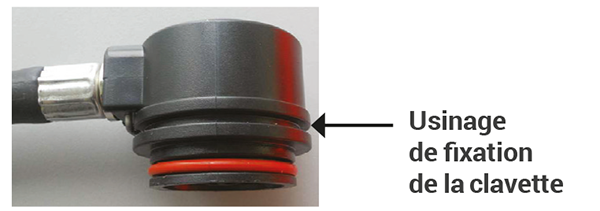



Entretien identique aux masques d'ARI.
Ne pas utiliser d'outils de nettoyage rugueux (brosses, etc.) ni de nettoyants ou de solvants.
Extérieur : nettoyer l'appareil avec un savon ou un détergent doux sans trempage.
Intérieur : nettoyage avec les lingettes désinfectantes Distel comme les masques d'ARI.
Ne pas faire sécher en plein soleil.
S'assurer que la cagoule est sèche à l'intérieur comme à l'extérieur avant de la reconditionner dans son sac de transport.
Vérification régulière en caserne notamment de l'absence de déchirure, craquelure, trous et autres signes d'usure. Ne pas utiliser une cagoule présentant des signes d'usure manifestes ou dégâts.
Préconisation constructeur : remplacement de la soupape d'expiration et du joint tous les 5 ans.
Sac de transport Cagoule ELSA, standard pour FLUX CONSTANT réf. 1032984 Flexible Soupape d'expiration
Ne pas confondre ou mélanger les cagoules de sauvetage de victime à flux constant avec les cagoules des kits « air respirable des CCF ou VLTT » qui nécessitent une soupape à la demande (SAD).
La cagoule des kits « air respirable des CCF ou VLTT » est une cagoule pour SAD ref 1032983. Son tuyau d'alimentation nécessite impérativement une SAD pour fonctionner.
Les deux cagoules se ressemblent. Elles ont la même couleur mais ne sont pas compatibles.
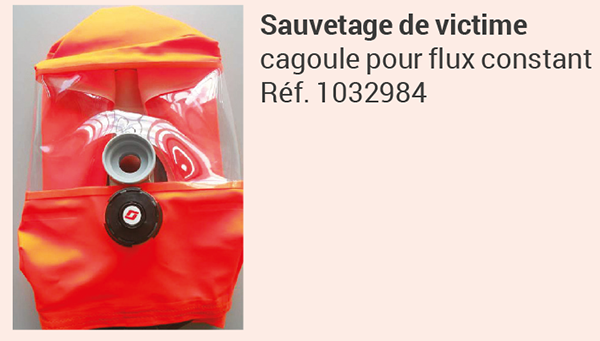

 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 4 EXP01-1
BALISE SONORE DE LOCALISATION BODYGUARD 1000 - DRAGER

| Famille : | Connexe ARI |
| Type : | Détecteur d'immobilité |
| Prix d'achat : | 131,76 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Détecteur d'immobilité fixé à demeure sur les dossards d'ARI | |
| Classement ATEX : | Matériel classé ATEX II 1G Eex ia IIc T4 (- 30 °C < Ta < 50 °C) |
| Alarme : | Sonore et visuelle sur 180° ≥ 95 dB à 3 m |
| Puissance sonore : | 102 -112 dB (A) |
| Alimentation : | 2 piles CR-123 3 v Panasonic |
| Autonomie : | > 200 heures de fonctionnement / 10 heures (alarmes pleine puissance) |
| Dimensions : | env. 100 x 70 x 40 mm |
| Poids : | 230 g piles comprises |
| Fonctionnement : | - 30 °C à + 50 °C |
| Résistance à l'eau : | IP67 protégé contre le ruissellement de l'eau |
Système d'alarme personnel qui détecte l'absence de mouvement du porteur d'ARI.
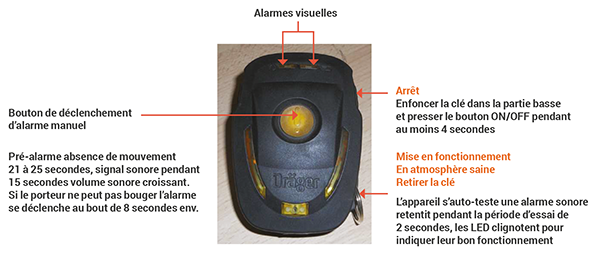
En fin de vie des piles, l'appareil émet un bip toutes les 5 secondes, avec clignotement de la led orange




Après utilisation le détecteur d'immobilité peut être nettoyé :
- sur l'extérieur avec chiffon humide ;
- ne pas utiliser d'outils de nettoyage rugueux (brosses, etc.) ni de nettoyants ou solvants ;
- sécher l'appareil avec un chiffon doux.
- Ne pas immerger le détecteur d'immobilité dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas ouvrir l'appareil ni changer les piles en zone ATEX.
Hormis le changement des piles et le nettoyage, il n'y a pas d'entretien particulier sur ce matériel.
Clé de rechange.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 5 EXP01-2
BALISE SONORE DE LOCALISATION MOTIONSCOUT - MSA

| Famille : | Connexe ARI |
| Type : | Détecteur d'immobilité |
| Prix d'achat : | 123,60 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Détecteur d'immobilité fixé à demeure sur les dossards d'ARI. | |
| Classement ATEX : | Matériel classé ATEX II 1G Eex ia Iic T 3/T4 |
| Alarme : | Sonore et visuelle sur 180° ≥ 95 dB à 3 m |
| Puissance sonore : | 95 dB (A) à 3 m |
| Alimentation : | 2 piles AA LR6 Duracell plus power MN 1500 (T4 -20°C < Ta < 50°C) Duracell procell MN 1500 Varta 4706 (T3 -20°C < Ta < 50°C) |
| Autonomie : | > 200 heures de fonctionnement / 10 heures (alarme pleine puissance) |
| Dimensions : | env. 100 x 75 x 45 mm |
| Poids : | 230 g piles comprises |
| Fonctionnement : | - 30 °C à + 50 °C |
| Résistance à l'eau : | IP67 protégé contre le ruissellement de l'eau |
Système d'alarme personnel qui détecte l'absence de mouvement du porteur d'ARI.

En fin de vie des piles, l'appareil émet une courte alarme sonore, suivie du clignotement de la led de fonctionnement.
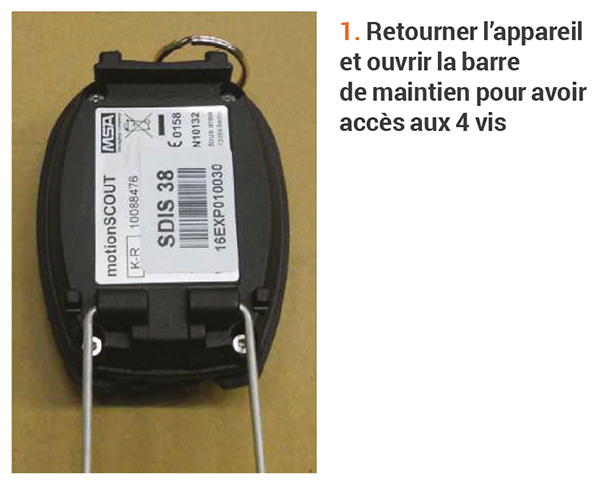
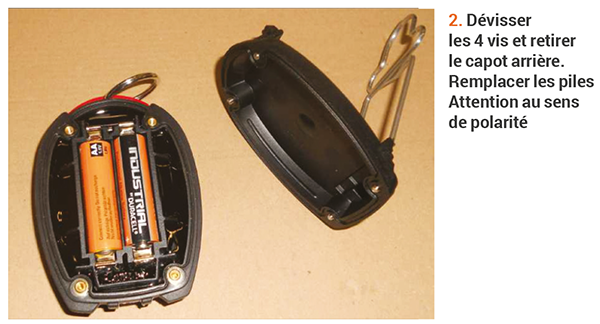


Après utilisation le détecteur d'immobilité peut être nettoyé :
- Sur l'extérieur avec chiffon humide ;
- ne pas utiliser d'outils de nettoyage rugueux (brosses, etc.) ni de nettoyants ou solvants ;
- sécher l'appareil avec un chiffon doux.
- Ne pas immerger le détecteur d'immobilité dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas ouvrir l'appareil ni changer les piles en zone ATEX.
Hormis le changement des piles et le nettoyage, il n'y a pas d'entretien particulier sur ce matériel.
Clé de rechange
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 6 EXP01-3
BALISE SONORE DE LOCALISATION SUPER PASS II
 |
| Balise de détresse sonore et lumineuse |
| Boîtier en polycarbonate jaune |
| Pré-alarme si aucun mouvement pendant 18 à 23 secondes |
| Alarme si aucun mouvement entre 30 à 35 secondes |
Maintenance curative et préventive : changement de la pile.
Alarme pile faible : série de 3 bips sonores à intervalles de 5 secondes (en mode détection).
Utiliser seulement une pile DURACELL 9 Volts TYPE MN1604.
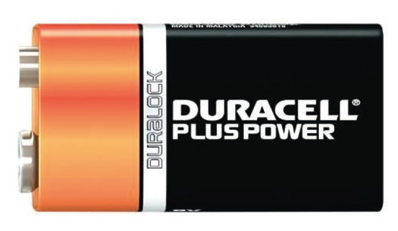
Dépose du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Changer la pile puis remontage du couvercle en prenant soin de vérifier l'état du joint du couvercle, attention à ne pas coincer les fils.

Serrage des vis du couvercle en diagonale en serrant (sans forcer).
Changement de la pile dans un endroit propre et sec.
Utiliser toujours la pile préconiséee.
En cas de problème, contacter un technicien ARI du groupement ou le bureau maintenance & vérification de la plate forme logistique.
FM 7 DET03
CAMÉRA THERMIQUE BULLARD - ECLIPSE LDX

| Famille : | Détection |
| Type : | Imagerie |
| Prix d'achat 2016 : | 5 130 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Petite caméra thermique d'attaque utilisant la technologie infrarouge | |
| Classement ATEX : | Matériel non classé ATEX |
| Alimentation : | Batterie NiMH rechargeable |
| Autonomie : | 2 heures de fonctionnement |
| Temps de recharge : | 2 heures |
| Dimensions : | Longueur, 198 mm, largeur 132 mm, hauteur 109 mm |
| Poids : | 0,895 kg |
| Écran : | 3,5 pouces à cristaux liquides |
| Résistance à la chaleur : | À 260 °C : 5 minutes sans endommager l'électronique À 150 °C : 15 minutes sans dommages |
| Résistance à l'eau : | IP67 protégé contre le ruissellement de l'eau |
| Accessoires : | Valise, sangles rétractables, chargeur, 2 batteries |
Reconnaissances, localisation de victimes, des foyers en milieu enfumé ou obscure.
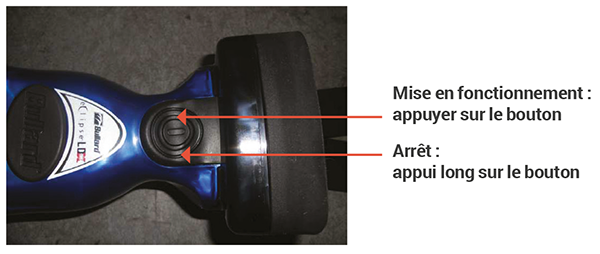
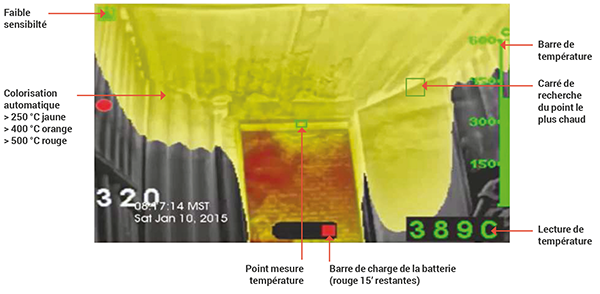


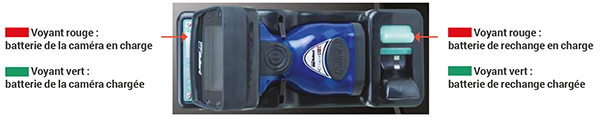
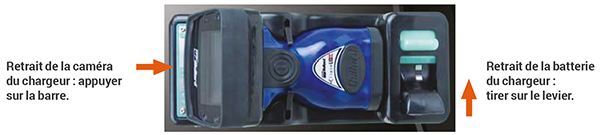
Lors de la première mise en service d'une batterie réaliser 5 cycles charge/décharge complets.
Après chaque utilisation nettoyer la caméra selon le protocole suivant :
- nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un savon ou un détergent doux sans trempage ;
- essuyer la lentille avec un chiffon doux ;
- nettoyer l'écran avec un chiffon doux.
- Ne pas immerger la caméra thermique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas fixer une température pendant trop longtemps (risque de dégradation du capteur).
Lors de la mise en service si la caméra ne fonctionne pas, commencer par changer la batterie. En effet, une batterie déchargée ou usée est susceptible de ne pas faire fonctionner la caméra.
Batterie - Sangle rétractable - Valise de transport - Chargeur
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 8 DET04
CAMÉRA THERMIQUE MSA - EVOLUTION 5200

| Famille : | Détection |
| Type : | Imagerie |
| Prix d'achat : | 10 000 € TTC |
| Date de mise en application : | Janvier 2009 |
| Petite caméra thermique d'attaque utilisant la technologie infra rouge | |
| Classement ATEX : | Matériel non classé ATEX |
| Alimentation : | Batterie au lithium-ion rechargeable |
| Autonomie : | 2 heures de fonctionnement à 22 °C |
| Temps de recharge : | 2 h 30 |
| Dimensions : | Hauteur 275 mm, Largeur 205 mm, Profondeur 112 mm |
| Poids : | < 1,2 kg avec batterie |
| Image : | 160 X 120 pixels |
| Champ de vision : | 68° diagonal, 55° horizontal, 41° vertical |
Reconnaissances, localisation de victimes, des foyers en milieu enfumé ou obscure

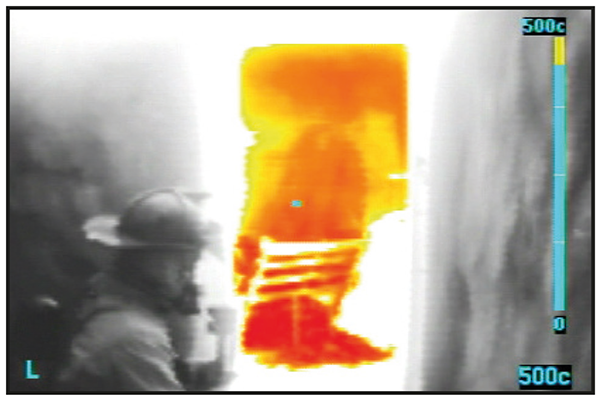


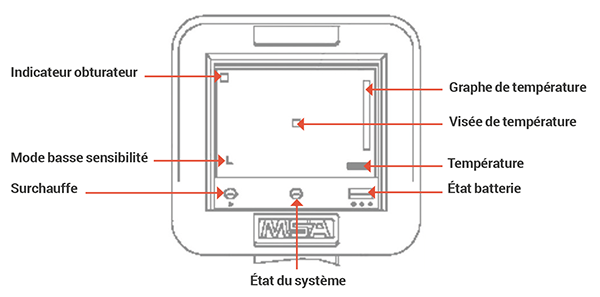
Appuyer sur le bouton ON/OFF pendant environ 1 seconde. Un test automatique des capteurs électroniques est réalisé dans les 5 secondes suivantes.
- La LED d'état sous le symbole ON/OFF s'allume en vert.
- Une image apparaît au bout de quelques secondes à l'écran.
Vérifier le fonctionnement de la caméra.
- Pour ce faire, diriger la caméra vers un objet ou une personne jusqu'à ce que l'image thermique soit affichée à l'écran.
Appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que :
- l'écran s'éteigne ;
- la LED d'écran verte clignote.
Pour passer du mode pause au mode normal, appuyer de nouveau sur le bouton vert ON/OFF jusqu'à ce que :
- l'affichage se rallume ;
- la LED d'état reste allumée en continu en vert de nouveau.
Continuer à appuyer sur le bouton vert ON/OFF pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que les indicateurs LED s'éteignent.
- La LED verte d'état clignote pendant que vous appuyez sur le bouton.
- La caméra s'éteint.
Relâcher le bouton ON/OFF dès que les indicateurs LED sont éteints.

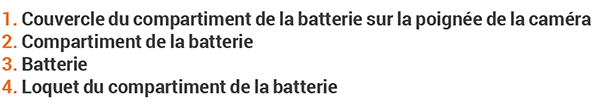
- Tenir la caméra à l'envers de sorte que le compartiment de la batterie soit dirigé vers le haut.
- Ouvrir le loquet, décrocher le crochet du compartiment de la batterie et ouvrir le couvercle.
- Placer la batterie chargée en position correcte dans le compartiment de la batterie.
- Fermer le couvercle du compartiment de la batterie, accrocher le crochet puis fermer le loquet.

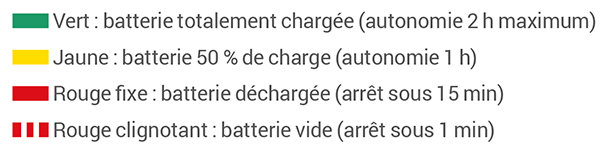

Déplacer immédiatement la caméra dans une zone plus fraîche
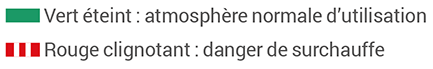
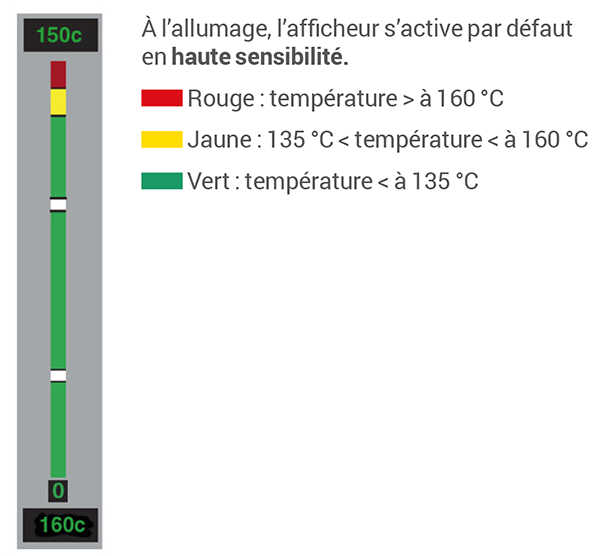
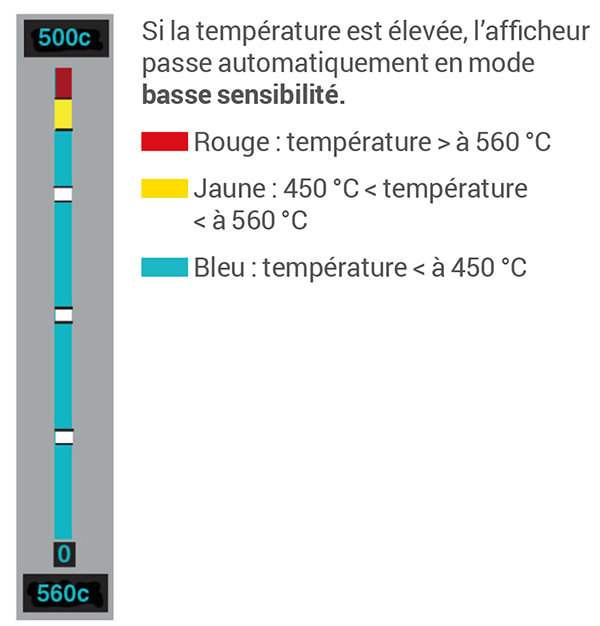
Le capteur doit être rafraîchi régulièrement pour un bon fonctionnement.
 Apparaît durant 2 à 3 secondes indiquant que l'obturateur est fermé
Apparaît durant 2 à 3 secondes indiquant que l'obturateur est fermé
Attention, l'image est figée durant cette opération.
Nettoyer soigneusement toutes les surfaces extérieures (boîtier de la caméra, poignées, objectif, écran, système de transport), à l'eau tiède et avec un produit de nettoyage doux.
Essuyer ensuite soigneusement à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Veiller à ne pas rayer l'écran et l'objectif lors de ce nettoyage.
Tous les connecteurs, le connecteur vidéo, le bouton ON/OFF, le système de blocage du compartiment de la batterie doivent être vérifiés pour détecter la présence de poussière et nettoyés à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et brossés au besoin.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 9 DET01-1
EXPLOSIMÈTRE DRÄGER X-AM 2000 DÉTECTEUR DE GAZ : EXPLOSIMÈTRE ET CO

| Famille : | Détection |
| Type : | Détection gaz |
| Prix d'achat 2010 : | 704,65 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Appareil portatif de mesure des gaz et vapeurs explosifs et du monoxyde de carbone (CO) | |
| Classement ATEX : | Matériel classé ATEX Ex ia d I/IIC T4/T3 |
| Étalonnage capteur explo : | Pentane |
| Alarme : | Sonore et visuelle sur 180° |
| Alimentation : | Batterie NiMH rechargeable |
| Autonomie : | 12 heures de fonctionnement |
| Temps de recharge : | env. 4 heures pour une batterie vide |
| Dimensions : | env. 130 x 48 x 44 mm (H x L x P) |
| Poids : | 220 à 225 g |
| Puissance sonore : | 90 dB (A) à 30 cm |
| Fonctionnement : | - 20 °C à + 40 °C |
| Résistance à l'eau : | IP67 protégé contre le ruissellement de l'eau |
Moyen de détection de gaz portable, protection individuelle et collective.
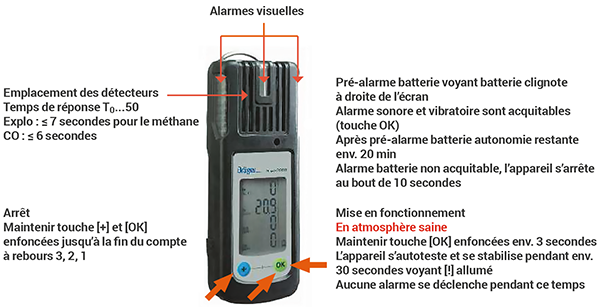
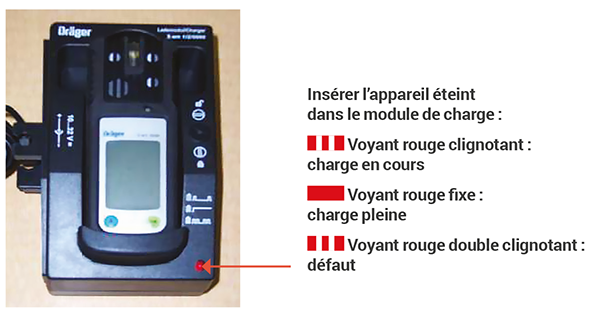
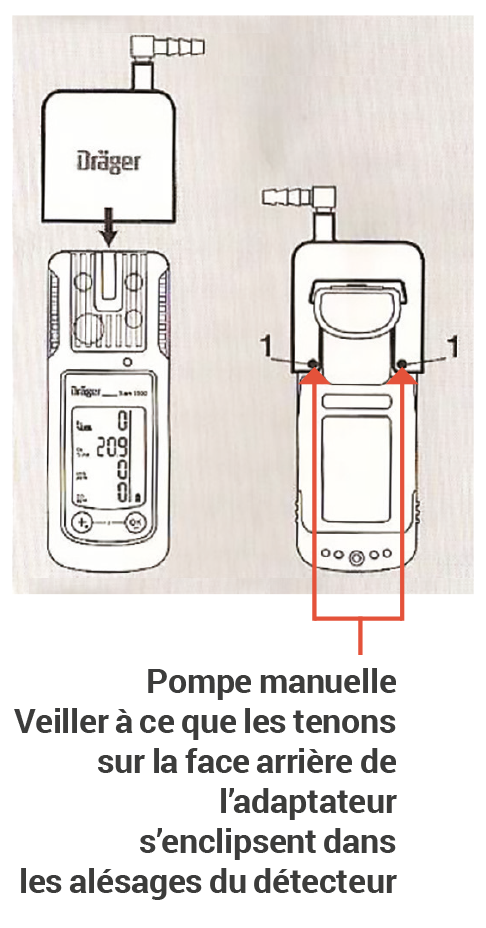
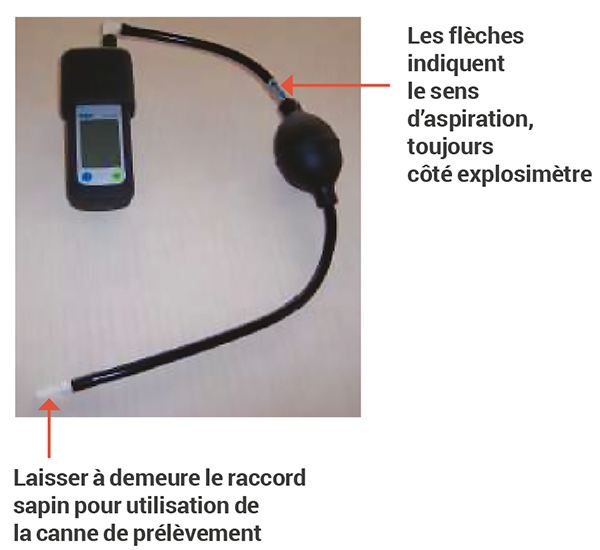

Le détecteur de la cellule explo du X-am 2000 est calibré sur le pentane (LIE 1,5% LSE 7,8%) proche de l'hexane. Il mesure de 0 à 100% de la LIE.
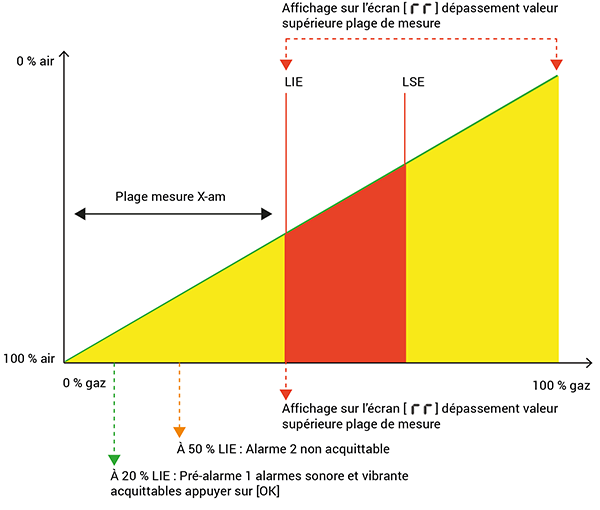
50 ppm : Pré-Alarme A1 alarme sonore et vibrante acquittable appuyer sur [OK]
400 ppm : Alarme 2 non acquittable
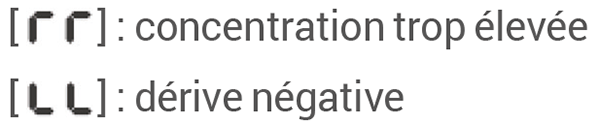
[ ! ] : l'appareil peut être utilisé normalement, si l'avertissement ne disparaît pas automatiquement au cours du fonctionnement, l'appareil doit faire l'objet d'une intervention lorsqu'il n'est plus utilisé.
[ X ] : l'appareil n'est pas prêt à mesurer et doit faire l'objet d'une maintenance.
Après utilisation de l'explosimètre, nettoyer l'extérieur de l'appareil avec chiffon humide. Ne pas utiliser d'outils de nettoyage, rugueux, (brosses, etc.), ni de nettoyants ou solvants qui peuvent détruire les filtres. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux. Sécher l'appareil avec un chiffon.
- Ne pas immerger l'explosimètre dans l'eau ou tout autre liquide
- Ne jamais tester l'explosimètre avec le gaz d'un briquet ou derrière un pot d'échappement (destruction des capteurs)
- Tester régulièrement l'étanchéité de la poire de prélèvement :

- vérifier visuellement l'absence de fissure ;
- monter le Kit de prélèvement ;
- appuyer sur la poire ;
- boucher l'orifice de prélèvement.
Si la poire se regonfle une fuite est probable, vérifier ll'état du système de prélèvement, refaire le test et si besoin demander l'échange via l'application
Ils ont une influence poison sur les capteurs en particulier :
- Pour le capteur CO : l'hydrogène et l'acétylène font réagir le capteur
- Pour le capteur explosimètre : l'hydrogène sulfuré, les hydrocarbures halogénés, les métaux lourds, les produits siliconés soufrés ou polymérisables.
L'appareil doit être inspecté et calibré chaque année par un technicien spécialisé. Lors de la mise en service de l'appareil affiche le nombre de jours restant avant la prochaine calibration. Exemple [CAL 20] = 20 jours avant calibration
Chargeur commun au modèle X-am 2500 Housse commune au modèle X-am 2500 Pompe manuelle commune au modèle X-am 2500 Canne de prélèvement commune au modèle X-am 2500
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 10 DET01-2
EXPLOSIMÈTRE DRÄGER X-AM 2500 DÉTECTEUR DE GAZ : EXPLOSIMÈTRE ET CO

| Famille : | Détection |
| Type : | Détection gaz |
| Prix d'achat : | 705 € TTC |
| Date de mise en application : |
| Appareil portatif de mesure des gaz et vapeurs explosifs et du monoxyde de carbone (CO) | |
| Classement ATEX : | Matériel classé ATEX |
| Étalonnage capteur explo : | Pentane |
| Alarme : | Sonore et visuelle sur 180° |
| Alimentation : | Batterie NiMH rechargeable |
| Autonomie : | 12 heures de fonctionnement |
| Temps de recharge : | 4 heures |
| Dimensions : | env. 130 x 48 x 44 mm (H x L x P) |
| Poids : | 220 à 225 g |
| Puissance sonore : | 90 dB (A) à 30 cm |
| Fonctionnement : | - 20 °C à + 50 °C |
| Résistance à l'eau : | IP67 protégé contre le ruissellement de l'eau |
Moyen de détection de gaz portable, protection individuelle et collective.

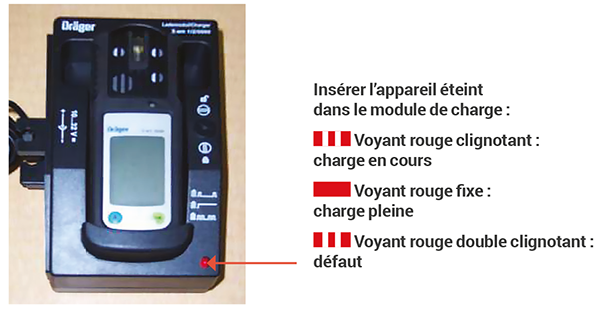
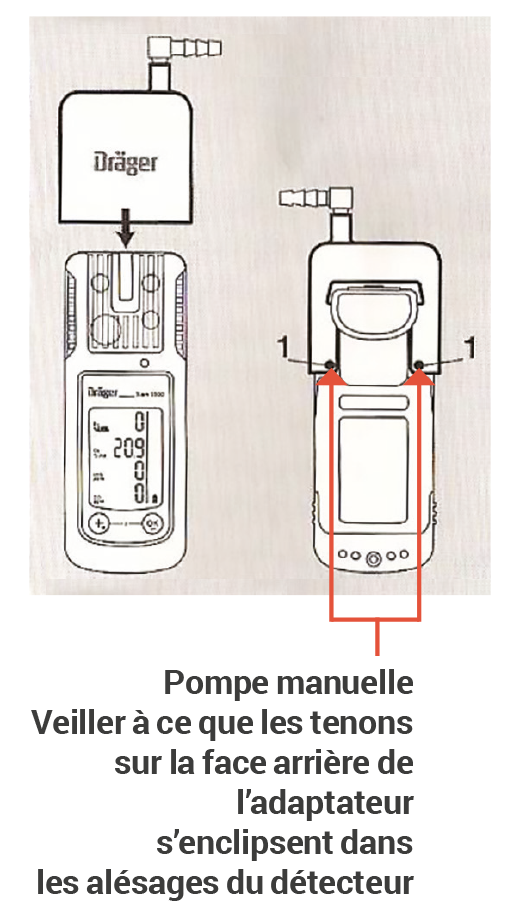
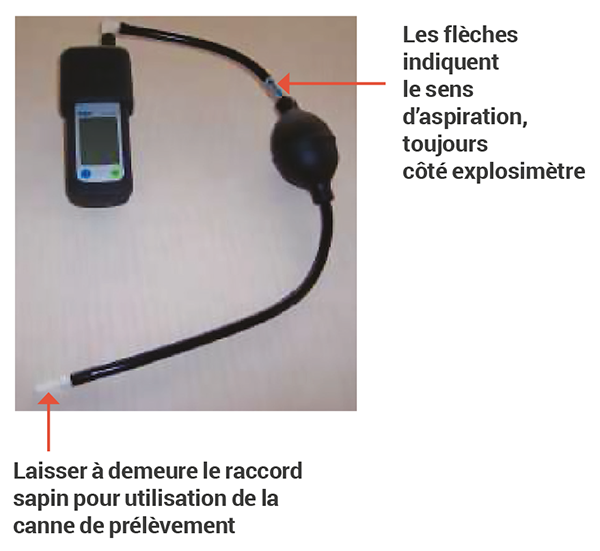

Capteur explosimètre : combustion catalytique
Le détecteur de la cellule explo du X-am 2500 est calibré sur le pentane (LIE 1,5% LSE 7,8%) proche de l'hexane. Il mesure de 0 à 100 % de la LIE.
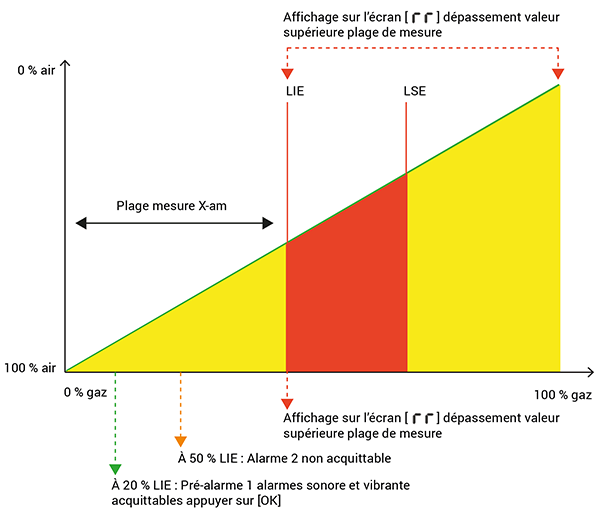
50 ppm : Pré-Alarme A1 alarme sonore et vibrante acquittable appuyer sur [OK]
400 ppm : Alarme 2 non acquittable
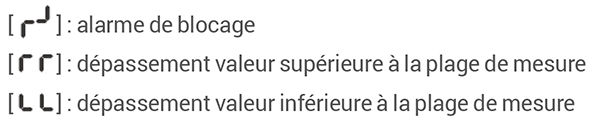
[ ! ] : l'appareil peut être utilisé normalement, si l'avertissement ne disparaît pas automatiquement au cours du fonctionnement, l'appareil doit faire l'objet d'une intervention lorsqu'il n'est plus utilisé.
[ X ] : l'appareil n'est pas prêt à mesurer et doit faire l'objet d'une maintenance.
Après utilisation de l'explosimètre, nettoyer l'extérieur de l'appareil avec chiffon humide. Ne pas utiliser d'outils de nettoyage, rugueux, (brosses, etc.), ni de nettoyants ou solvants qui peuvent détruire les filtres. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux. Sécher l'appareil avec un chiffon.
- Ne pas immerger l'explosimètre dans l'eau ou tout autre liquide
- Ne jamais tester l'explosimètre avec le gaz d'un briquet ou derrière un pot d'échappement (destruction des capteurs)
- Régulièrement tester l'étanchéité de la poire de prélèvement :

- vérifier visuellement l'absence de fissure ;
- monter le Kit de prélèvement ;
- appuyer sur la poire ;
- boucher l'orifice de prélèvement.
Si la poire se regonfle une fuite est probable, vérifier ll'état du système de prélèvement, refaire le test et si besoin demander l'échange via l'application
Ils ont une influence poison sur les capteurs en particulier :
- pour le capteur CO : l'hydrogène et l'acétylène font réagir le capteur ;
- pour le capteur explosimètre : l'hydrogène sulfuré, les hydrocarbures halogénés, les métaux lourds, les produits siliconés soufrés ou polymérisables.
L'appareil doit être inspecté et calibré chaque année par un technicien spécialisé. Lors de la mise en service de l'appareil affiche le nombre de jours restant avant la prochaine calibration. Exemple [CAL 20] = 20 jours avant calibration
Chargeur commun au modèle X-am 2000 Housse commune au modèle X-am 2000 Pompe manuelle commune au modèle X-am 2000 Canne de prélèvement commune au modèle X-am 2000
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 11 DES20-1
TRONÇONNEUSE À DISQUE

| Famille : | Équipement de protection |
| Type : | Tronçonnage |
| Tronçonneuse thermique : « Partner K750 » Husqvarna | |
| Poids : | 10 kg |
| Cylindrée : | 74 cm3 |
| Possibilité de refroidissement par eau | |
| Carburant : | Mélange 3-4 % contenance 0,9 l |
Découpe de support acier / béton / verre avec disque modèle « RECA »








Possibilité de refroidir par eau le disque : (découpe de béton)
- soit en branchant une arrivée d'eau ;
- soit en refroidissant le disque avec une LDT par exemple.
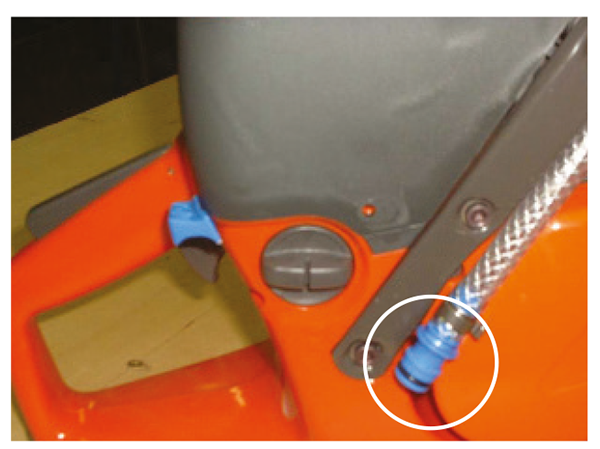


Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse à disque, l'ensemble des EPI ainsi que le tablier de coupe doivent être revêtus (protection des gerbes de métaux en fusion).
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 12 DES04
GROUPE HYDRAULIQUE AUTONOME P 600 OE - LUKAS

| Famille : | Désincarcération & levage |
| Type : | Groupes (désincarcération) |
| Prix d'achat : | 2 700 € HT |
| Date de mise en application : |
| Classement ATEX : | Non |
| Motorisation : | Moteur électrique |
| Puissance : | 1 kWr |
| Pression nominale : | 70 MPa ou 700 bar |
| Alimentation/Carburant : | Batterie lithium 25,2 v 2,6 ou 5 Ah |
| Autonomie : | 25 minutes environ par batterie |
| Huile hydraulique : | 1,2 l |
| Dimensions : | 460 x 182 x 257 mm |
| Poids : | 9,2 kg avec accu |
| Niveau sonore : | 71 dBA |
| Longueur de flexible admissible : | 10 m |
| Huile : | Huile minérale 10 DIN ISO 6743-4 |
Outil hydraulique autonome de désincarcération permettant la découpe, l'écartement ou le pincement.
Le groupe hydraulique fonctionne dans deux modes : le mode TRAVAIL et le mode ECO. Il se commute automatiquement dans le mode requis. En mode TRAVAIL, il alimente les outils, en mode ECO, le régime moteur baisse pour économiser les batteries.
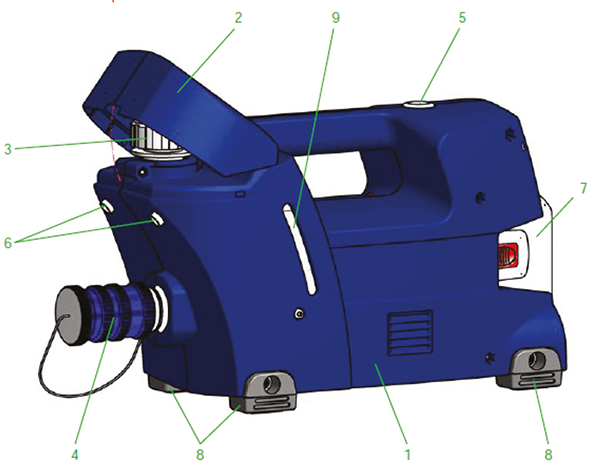
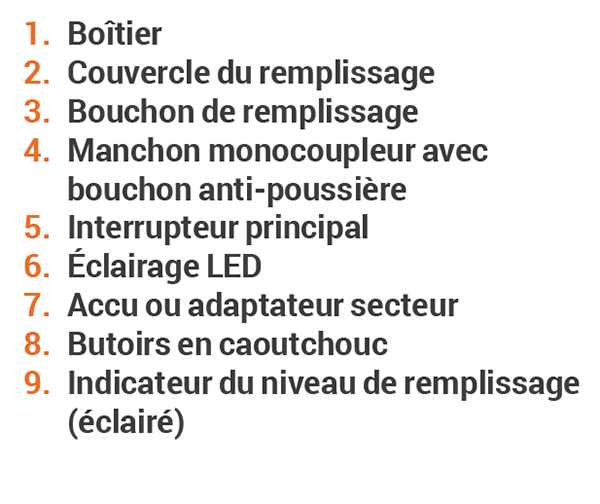
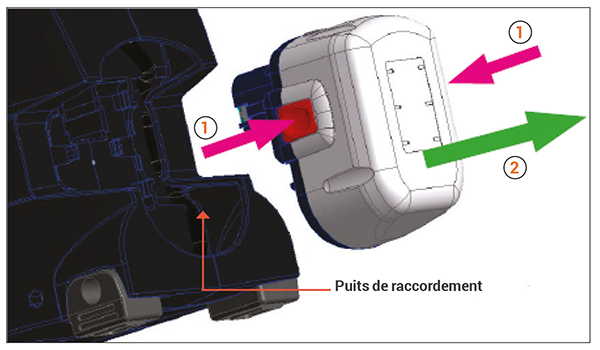
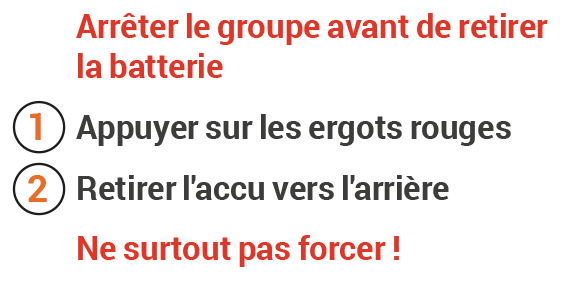
introduisez l'accu dans le puits de raccordement en respectant le sens sans forcer.
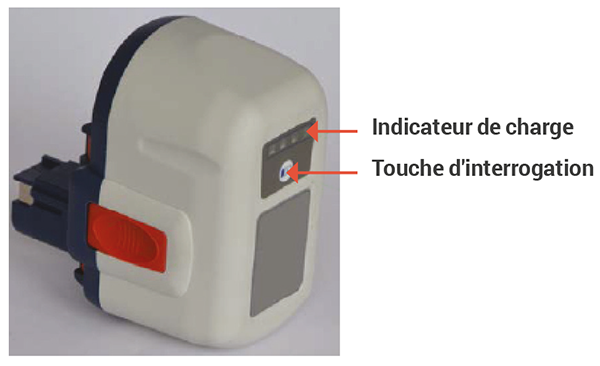
Batterie type 1 : 25,2 v DC, 2,6 Ah
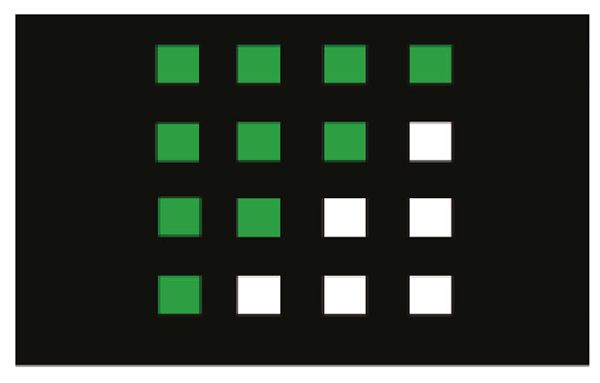
Capacité 75 à 100 % - LED 1 à 4 allumées
Capacité 50 à 75 % - LED 1 à 3 allumées
Capacité 25 à 50 % - LED 1 à 2 allumées
Capacité 0 à 25 % - LED 1 allumée
Batterie type 2 : 25,2 v DC, 5 Ah
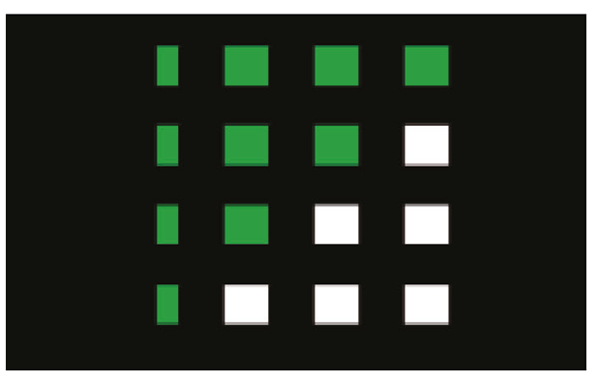
Capacité 75 à 100 % - LED 1 à 4 allumées
Capacité 62 à 75 % - 4e LED clignote, LED 1 à 3 allumées
Capacité 50 à 62 % - LED 1 à 3 allumées
Capacité 37 à 50 % - 3e LED clignote, LED 1 à 2 allumées
Capacité 25 à 37 % - LED 1 à 2 allumées
Capacité 12 à 25 % - 2e LED clignote, LED 1 allumée
Capacité 5 à 12 % - LED 1 allumée
Capacité 0 à 5 % - 1re LED 1 clignote
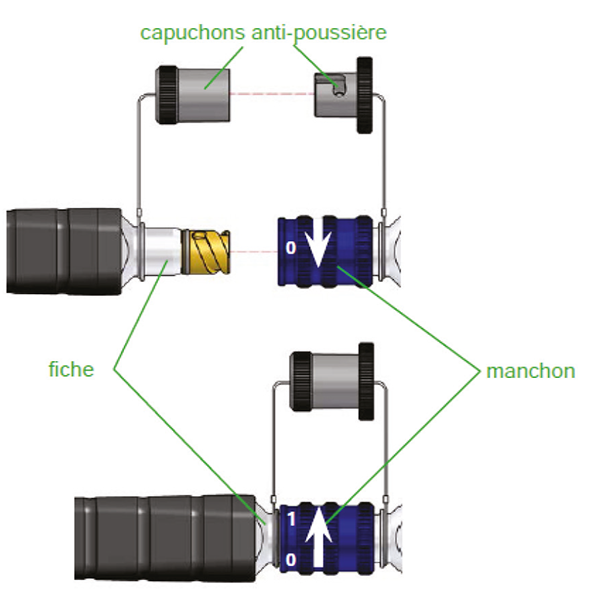
Avant utilisation enlever les capuchons anti-poussière, les remettre après utilisation.
L'appareil doit être nettoyé extérieurement de temps en temps avec un chiffon humide (pas les contacts électriques du puits de raccordement, de l'accu et de l'adaptateur secteur).
Contrôle visuel
- aucun endommagement du boîtier visible ;
- étanchéité générale (fuites) ;
- interrupteur principal en bon état et sans endommagements ;
- coupleurs faciles à accoupler ;
- présence des capuchons anti-poussière ;
- plaques toutes présentes et lisibles ;
- éclairage de l'interrupteur principal, de la zone de travail et du réservoir opérationnels.
Accu et adaptateur secteur
- boîtier non endommagé ;
- surfaces électriques de contact propres et intactes ;
- câble non endommagé ;
- accu(s) entièrement chargé(s) (en cas d'utilisation) ;
- indicateur de charge de l'accu lithium-ion opérationnel.
Essai fonctionnel
- pas d'odeurs suspectes ;
- contrôles de charge maximale. Lorsque la pression maximale est atteinte, la pompe se commute après quelques instants en mode ECO. Dès que la pression redescend légèrement, la pompe se réenclenche automatiquement dans le mode TRAVAIL.
Contrôle du niveau d'huile hydraulique
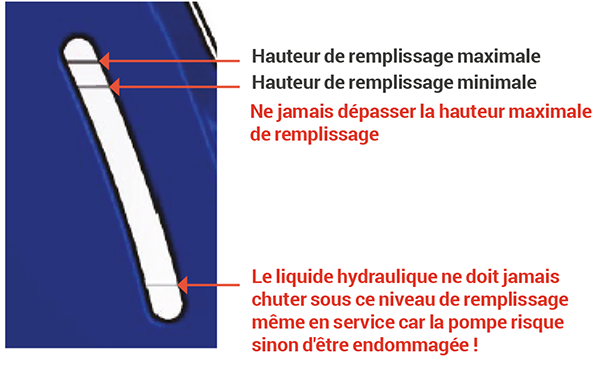
Contrôle des filtres
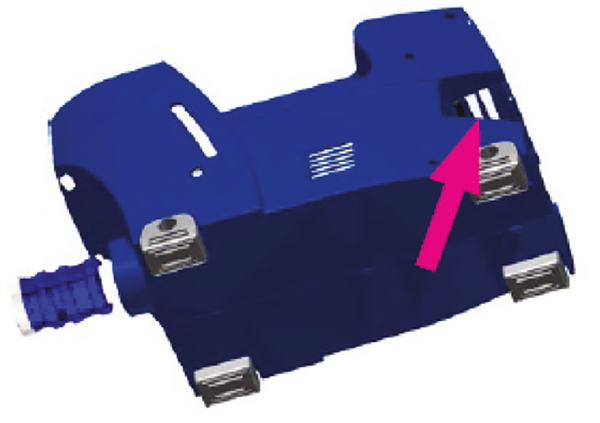

À réaliser au moins une fois par an :
- basculer le groupe (bouchon de remplissage bien fermé) comme indiqué ;
- inspecter les filtres.
S'ils sont encrassés, faire une demande de maintenance.
Batterie - Chargeurs
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 13 DES16
OUTIL COMBINÉ AUTONOME SC 357 E2 - LUKAS

| Famille : | Désincarcération & levage |
| Type : | Outils (désincarcération) |
| Prix d'achat : | 6 500 € HT (hors batterie et chargeur) |
| Date de mise en application : |
| Classement ATEX : | Non |
| Motorisation : | Moteur électrique |
| Pression nominale : | 70 MPa ou 700 bar |
| Ouverture de découpe max : | 274 mm |
| Force de découpe max : | 380 kN |
| Force d'écartement max : | 38 kN |
| Force d'écartement max possible : | 1003 kN |
| Ecartement max : | 368 mm |
| Force de traction max : | 48 kN |
| Course de traction : | 380 mm |
| Alimentation/Carburant : | Batterie lithium 25,2 v 2,6 ou 5 Ah |
| Autonomie : | 25 minutes environ par batterie |
| Huile hydraulique : | 1,2 l |
| Dimensions : | 849 x 215 x 262 mm |
| Poids : | 18,8 kg sans accu |
| Niveau sonore : | 77 dBA |
| Protection : | IP54 |
| Huile : | Huile minérale 10 DIN ISO 6743-4 |
Outil hydraulique autonome de désincarcération permettant la découpe, l'écartement ou le pincement.
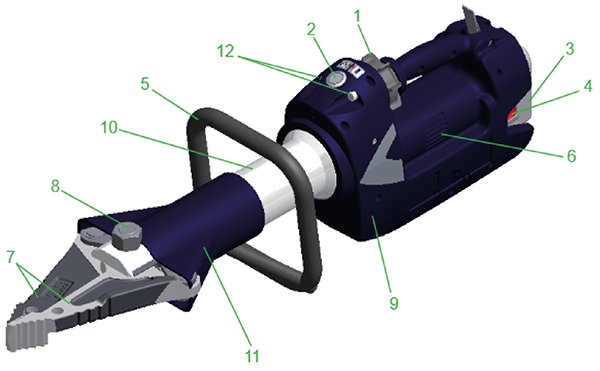
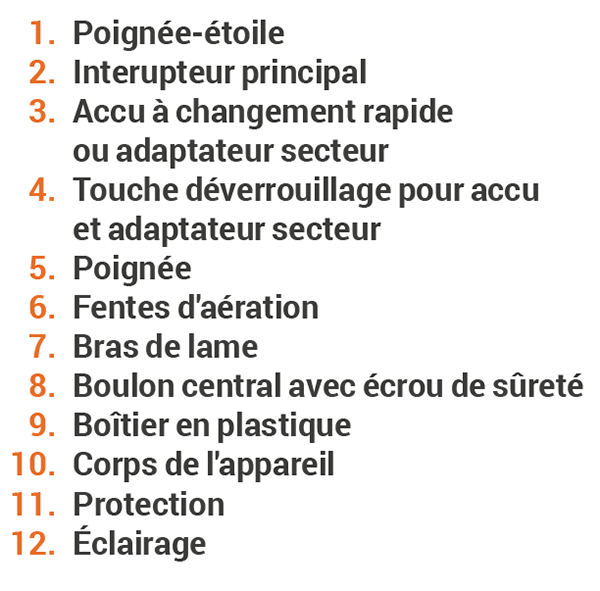
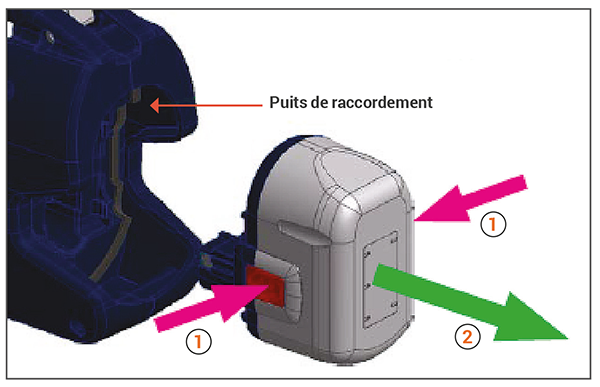
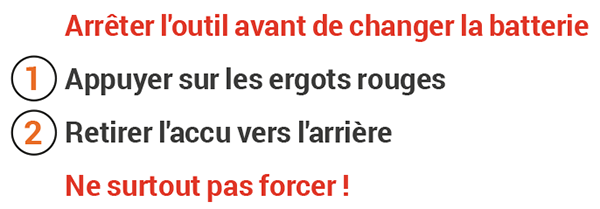
introduisez l'accu dans le puits de raccordement en respectant le sens sans forcer.
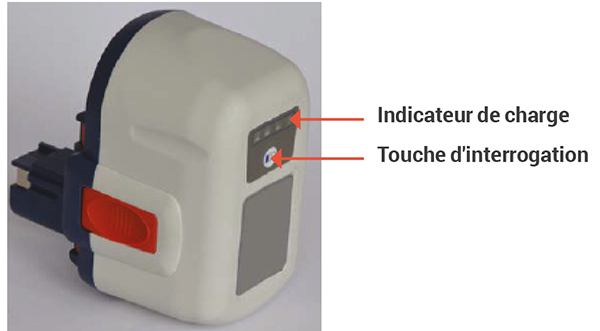
Batterie type 1 : 25,2 v DC, 2,6 Ah

Capacité 75 à 100 % - LED 1 à 4 allumées
Capacité 50 à 75 % - LED 1 à 3 allumées
Capacité 25 à 50 % - LED 1 à 2 allumées
Capacité 0 à 25 % - LED 1 allumée
Batterie type 2 : 25,2 v DC, 5 Ah

Capacité 75 à 100 % - LED 1 à 4 allumées
Capacité 62 à 75 % - 4e LED clignote, LED 1 à 3 allumées
Capacité 50 à 62 % - LED 1 à 3 allumées
Capacité 37 à 50 % - 3e LED clignote, LED 1 à 2 allumées
Capacité 25 à 37 % - LED 1 à 2 allumées
Capacité 12 à 25 % - 2e LED clignote, LED 1 allumée
Capacité 5 à 12 % - LED 1 allumée
Capacité 0 à 5 % - 1re LED 1 clignote
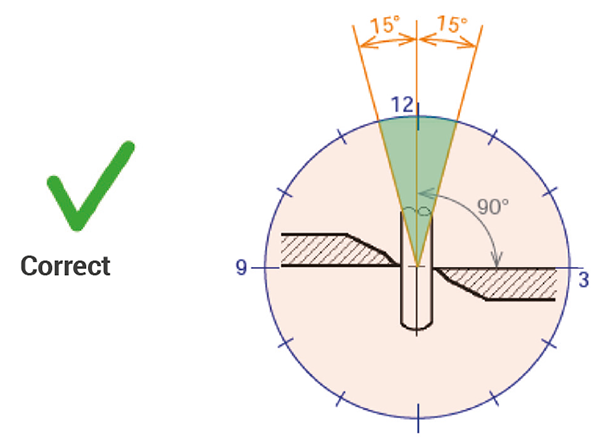
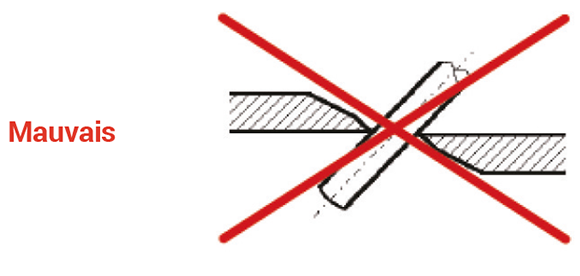
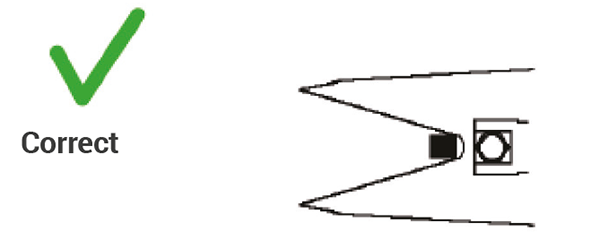
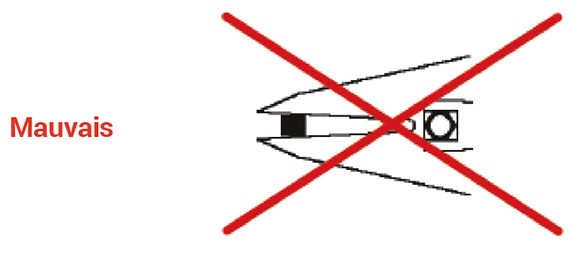
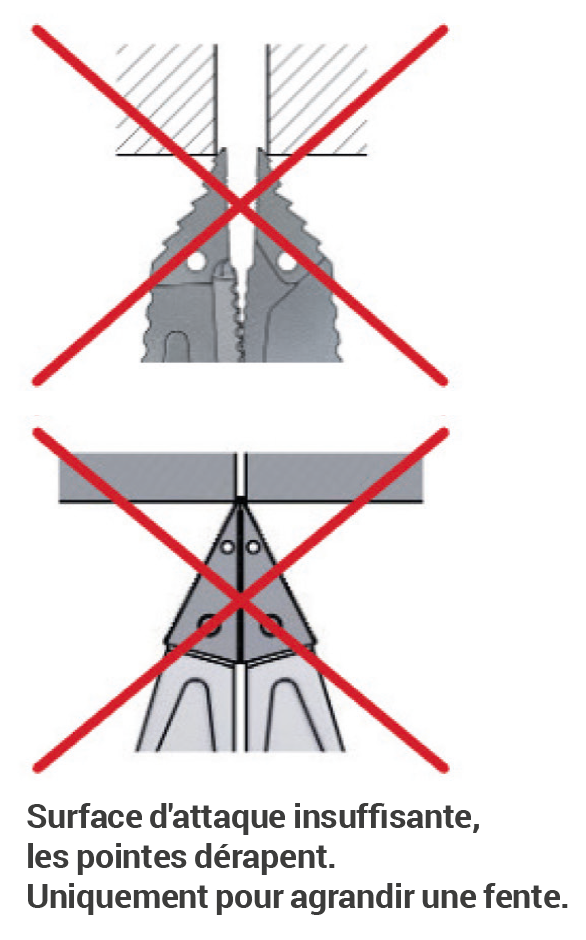
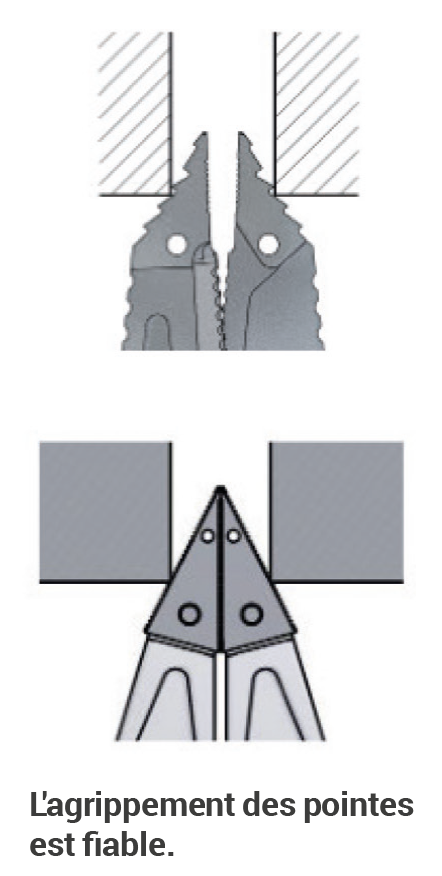

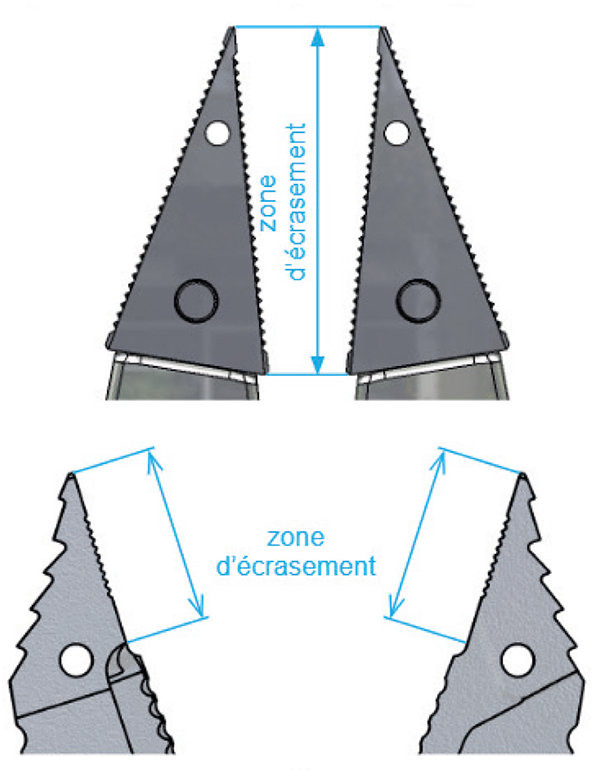
Ne conservez jamais les appareils eDRAULIC avec les bras entièrement fermés ou le piston complètement rentré ! En fermant entièrement les bras ou en rentrant complètement le piston du vérin, une tension hydraulique et mécanique peut se reformer dans l'appareil.
L'appareil doit être soufflé systématiquement après chaque utilisation afin d'enlever les débris pouvant rester dans les lames.
L'appareil doit être nettoyé extérieurement de temps en temps avec un chiffon humide (pas les contacts électriques du puits de raccordement, de l'accu et de l'adaptateur secteur)
L'appareil doit être contrôlé par un technicien de maintenance suite à une opération de découpe (opération ou formation), contact : glog.maintenance.pfl@sdis38.fr.
Contrôle visuel
- ouverture des bras de lames au niveau des pointes ;
- étanchéité générale (fuites) ;
- bon fonctionnement de la poignée-étoile - vérifier le retour automatique de la poignée-étoile en position moyenne après la libération (fonction de maintien de la charge) ;
- présence de la poignée bien fixée ;
- étiquettes complètes et bien lisibles ;
- protections en bon état ;
- bras de lames exempts de fissures et sans éclats ou déformations côté surfaces tranchantes ;
- les surfaces de cisaillement se recouvrent sans se toucher ;
- tôles de glissement, boulons et bagues de sûreté des bras de lames présents et en bon état ;
- éclairage de l'interrupteur principal, de la zone de travail et du puits de raccordement opérationnels.
Accu et adaptateur secteur
- boîtier non endommagé ;
- surfaces électriques de contact propres et intactes ;
- câble non endommagé ;
- accu(s) entièrement chargé(s) (en cas d'utilisation) ;
- indicateur de charge de l'accu lithium-ion opérationnel.
Essai fonctionnel
- pas d'odeurs suspectes ;
- ouverture et fermeture ou rentrée et sortie sans problèmes en actionnant la poignée-étoile ;
- pas de bruits inhabituels ;
- pas de poursuite du mouvement des bras de lames, des bras de l'écarteur ou du piston du vérin en cas d'interruption de l'actionnement de la soupape durant la procédure (commande homme mort).
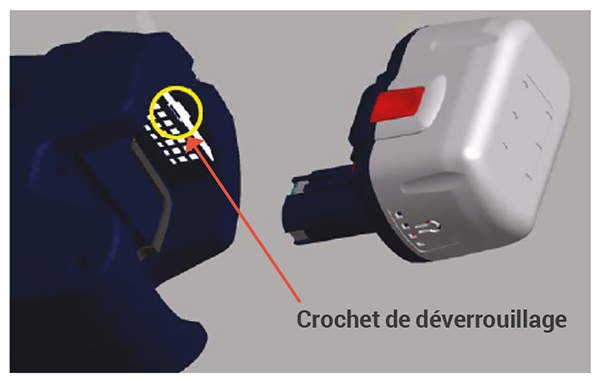
Contrôle des filtres
À réaliser au moins une fois par an : inspection visuelle du filtre sans démontage. S'il est encrassé faire une demande de maintenance.
Batterie - Chargeurs
Ne pas découper, ni écraser :
- les câbles conducteurs de courant ;
- des pièces précontraintes et durcies, comme par ex. ressorts, acier à ressort, colonnes de direction et cylindres ;
- des canalisations sous pression (gaz ou liquide) ;
- des matériaux composites (acier, béton) ;
- des corps explosifs tels que des cartouches d'airbag, par exemple.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 14 DES20-2
TRONÇONNEUSE THERMIQUE

| Famille : | Équipement de protection |
| Type : | Tronçonnage |
| Tronçonneuse thermique : | « MS 250 » Stihl |
| Poids : | 5 kg |
| Longueur guide : | 40 ou 45 cm |
| Carburant : | Mélange 3-4 % |
| Contenance : | 0,47 l |
| Autonomie : | ≈ 1 h |
Tronçonnage bois.
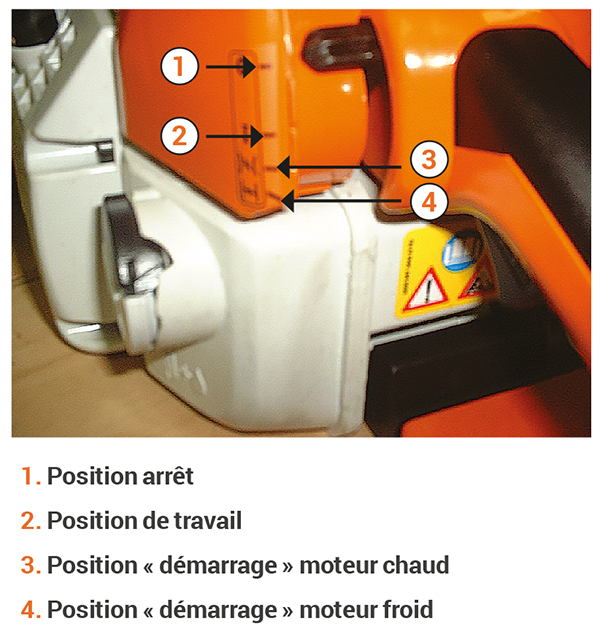
Desserrer les 2 écrous (avec la clef à bougie fournie).
Tourner la vis centrale dans un sens ou dans l'autre pour tendre
ou détendre la chaîne.
Vérifier la tension de la chaîne pendant le travail car elle peut se détendre par dilatation due à l'échauffement.
Tension de la chaîne : une fois tendue en tirant fermement dessus, la chaîne doit avoir deux à trois maillons qui sortent du guide.
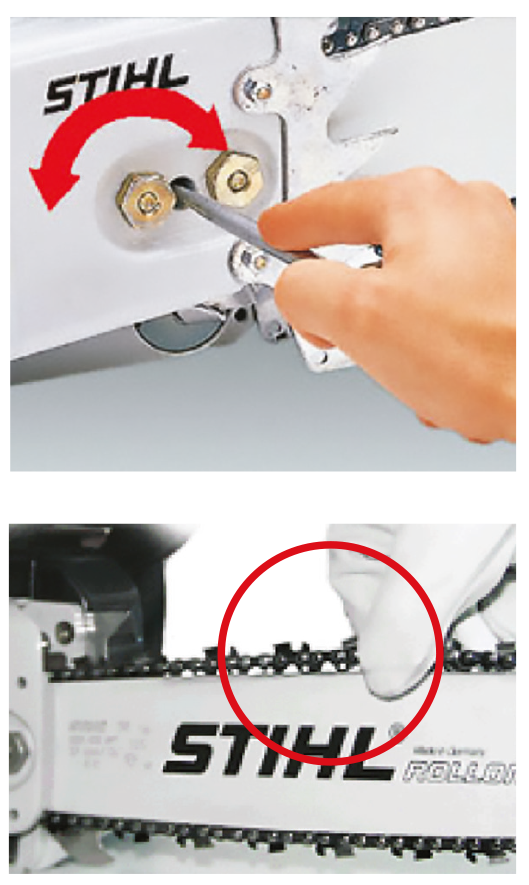
Nettoyer la machine après chaque utilisation, refaire le niveau de carburant et huile graissage de chaine, vérifier l'état et la tension de la chaîne.
Système 1/4 de tour pour ouvrir/fermer les réservoirs.

Déverrouiller le frein de chaîne.
Déposer les 2 écrous (avec la clef à bougie fournie).
Détendre la chaîne.
Changer la chaîne : attention au sens de rotation de la chaîne.
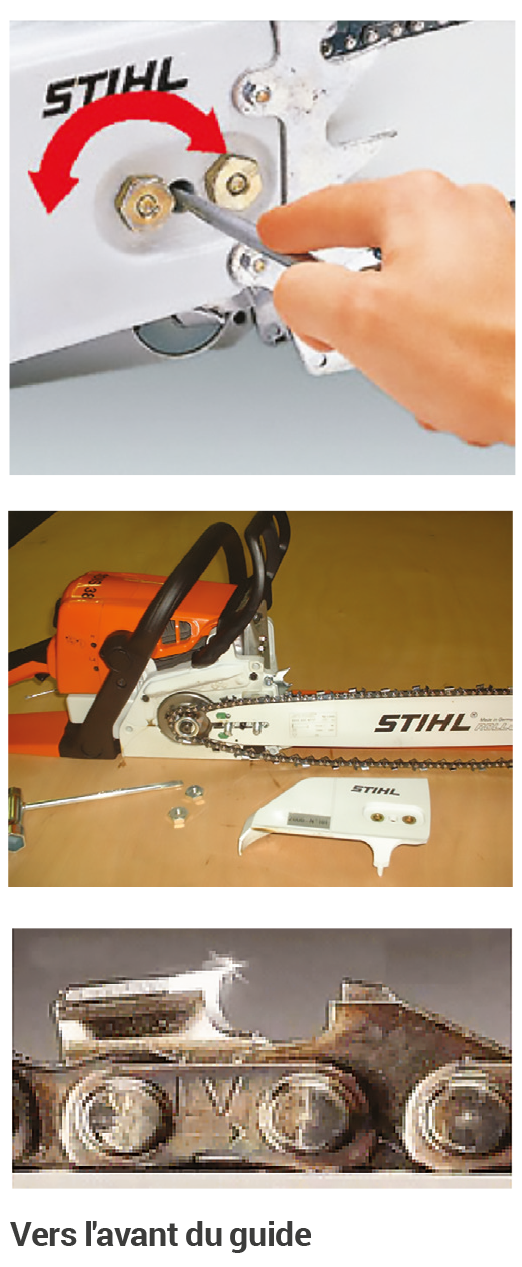
- Veillez à bien lire le livret technique de ce matériel (joint avec) avant toute utilisation.
- Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse à chaîne, les EPI du lot tronçonnage doivent impérativement être portés : casque et lunettes de protection, veste de protection, jambières de protection et gants de protection (Norme EN 381).
- Chaque tronçonneuse est livrée avec une clef à bougie et une chaine de rechange.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 15 LAN04
LDV CLASSE 500 AUTOMATIQUE

| Famille : | Lances |
| Type : | Lances à main |
| Lance automatique MACH 3 avec tête de lance à pression régulée MIDFORCE de la marque Leader |
| Ouverture/fermeture et réglage des débits par poignée unique à 6 positions, débit variable de 100 à 600 l/min |
| Lance conforme à la norme EN 15182-2 type 4 |
| Gâchette de blocage des jets |
| Demi-raccord DSP de diamètre 40 monté sur rotule |
| Poids 2,7 kg |
- Extinction/protection/ventilation
- Refroidissement de victime
La LDV 500 est conforme à la norme européenne EN15182-2 type 4, c'est donc une lance mixte à débit et jet réglable avec un dispositif de contrôle de la pression intégré.


L'ouverture, la fermeture et le réglage des débits est assuré par un boisseau coulissant en acier inoxydable.
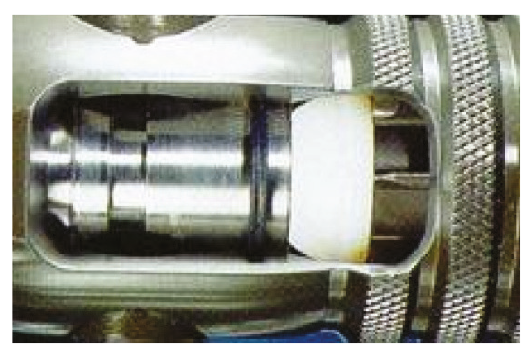
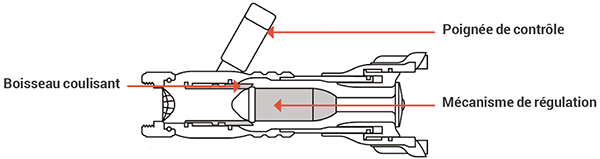
La tête MIDFORCE fonctionne à une pression de référence de 6 bar.
Elle peut fonctionner en position basse pression à 3 bar.
Elle permet le réglage des jets :
- droit ;
- diffusé étroit (attaque) ;
- diffusé large (protection) ;
- purge.
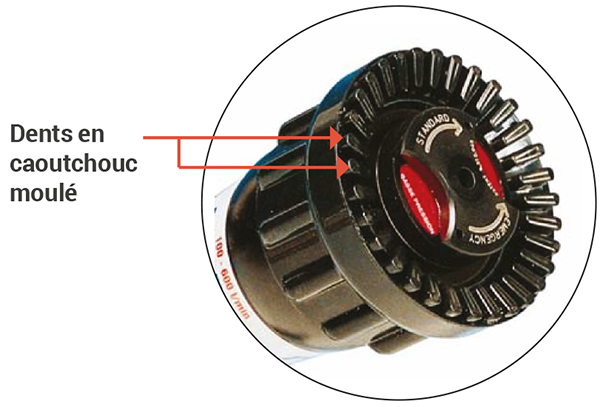
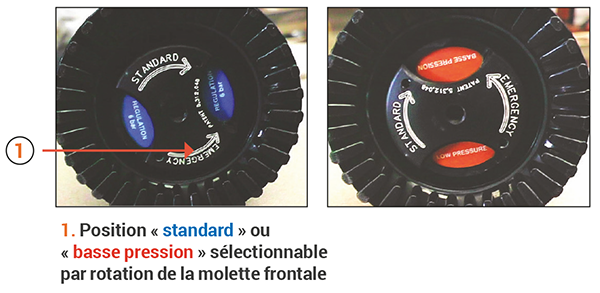

Nettoyer la lance après chaque utilisation (filtre d'entrée, tête de lance, mettre la position purge pour faire sortir les saletés). Vérifier le libre fonctionnement de la poignée d'ouverture/fermeture 1, la rotation de la molette frontale 2, rotation de la tête de lance 3, fonctionnement de la gâchette 4, état des dents 5, fuites, etc.

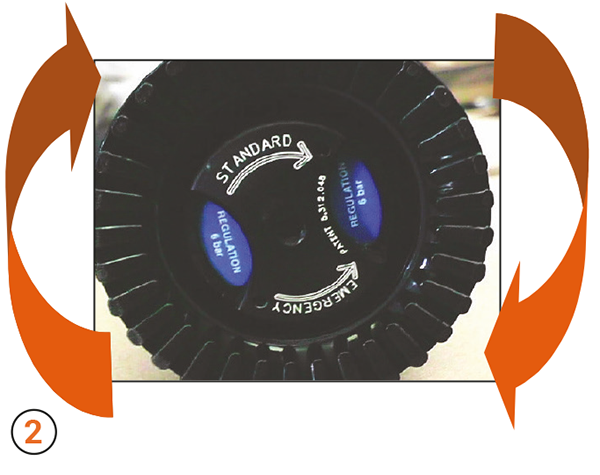

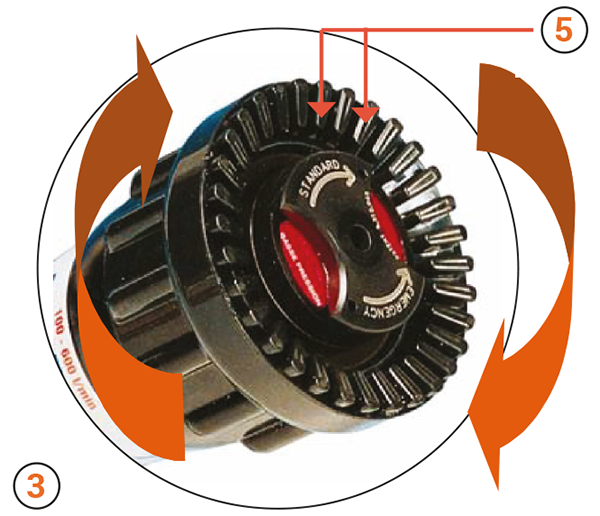
- À 600 l/min avec pression de référence à 6 bar environ (en position normale de la molette frontale), portée du jet droit environ 40 mètres.
- La position basse pression de la molette frontale permet à la LDV de conserver un débit de 400 à 600 litres minutes environ même si la pression à la lance est inférieure à 6 bar (mais la portée et la qualité des gouttelettes sont moins efficaces qu'en position standard).
- Possibilité de mettre un adaptateur polymousse ; le débit moyen d'utilisation doit être de 250 l/min (débit maximum d'utilisation : 400 l/min).
- Si deux LDV avec polymousse sont en manoeuvre le débit d'utilisation doit être de 400 l/min (200 l/min par LDV).


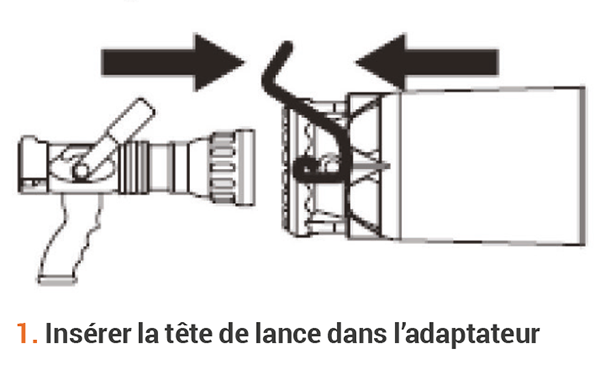
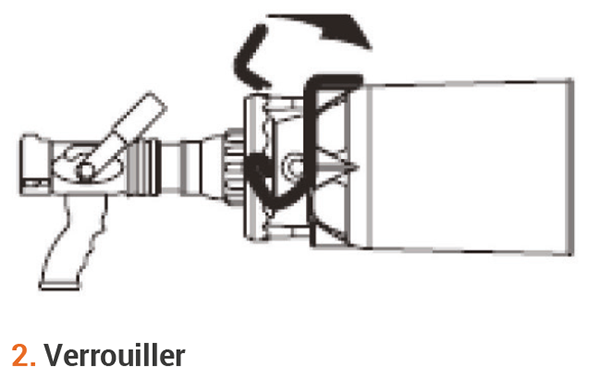
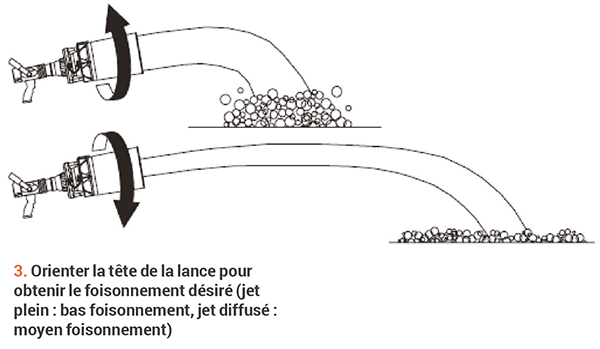
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 16 LAN05
GUIDE TECHNIQUE LES LANCES
- Permettre de former et de diriger un jet d'eau sur un foyer d'incendie tout en permettant au porte-lance de faire varier sa forme et de régler son débit.
- Utiliser quatre types de jets et adapter la quantité d'eau à l'intensité du feu ; en fonction de l'évolution de l'intervention (marche générale des opérations).
- Actions de la LDV en opération pendant :
- les sauvetages pour baisser l'intensité du feu ou le rayonnement ;
- l'extinction pour :
- diminuer la température du foyer,
- partager les éléments brûlés,
- neutraliser le comburant au foyer (étouffement),
- inerter les fumées (par vaporisation),
- désenfumer les locaux et neutraliser les foyers résiduels lors des déblais.
C'est une lance à régulation automatique de pression, avec poignée de contrôle du débit manoeuvrable par le porte-lance sans altération de la qualité du jet. Elle fonctionne par le principe d'un boisseau coulissant. Le principe de régulation permet de garantir une portée de lance toujours optimum même en cas de pression de refoulement minimale (3 bar) par un système de rotation de la molette frontale sur certains modèles.
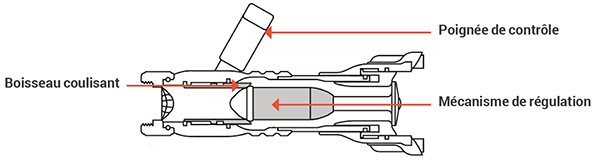
C'est une lance d'incendie à débit variable par sélection manuelle équipée d'un robinet à boisseau sphérique en acier inox avec siège de boisseau en téflon. La bague de sélection des débits doit permettre d'obtenir une large plage de débits composée de quatre positions (Quadrafog Diam 40 : 100, 250, 350, 500 l/min).
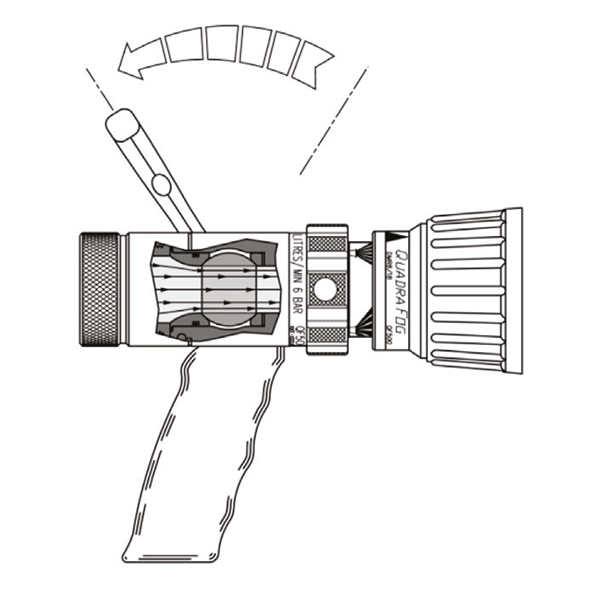
Il est utilisé pour les attaques à distance et permet ainsi de mettre le binôme d'attaque hors de portée du rayonnement, grâce à l'éloignement par rapport au foyer. Il peut obtenir un effet mécanique, destructeur et pénétrant. Il produit des grosses gouttes concentrées. Un jet droit est bien réglé lorsqu'il arrive compact au foyer, il faut éliminer l'« effet diabolo » (appelé : jet droit reconstitué) sur une DMR et mettre la pression adéquate.
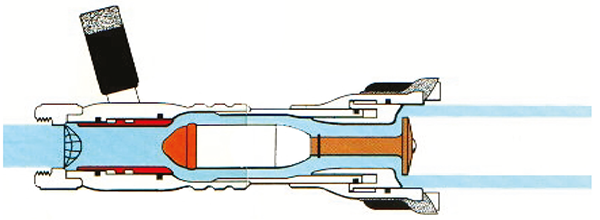
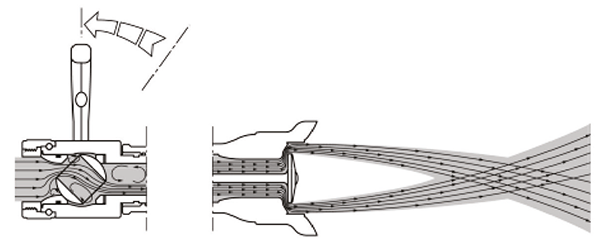
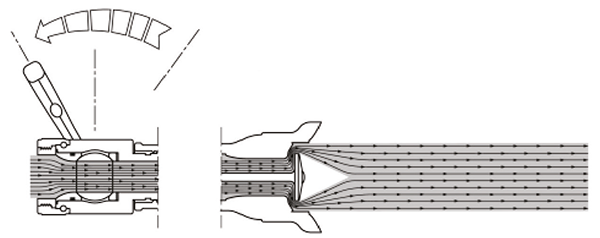
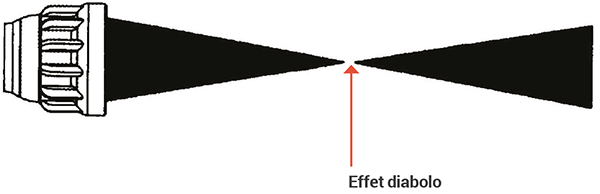
Il permet d'atteindre des foyers éloignés tout en protégeant le binôme.
Lors de l'utilisation du jet d'attaque, il produit des grosses gouttes en périphérie pour la protection et des gouttes fines au centre du cône pour absorber la chaleur du foyer. La vitesse élevée des fines gouttelettes permet un pouvoir de pénétration, absorbe l'énergie, diminue la température du foyer tout en protégeant le porte lance par la distance.
De plus, un mouvement d'air de l'arrière du porte lance vers l'avant permet l'arrivée d'air frais.
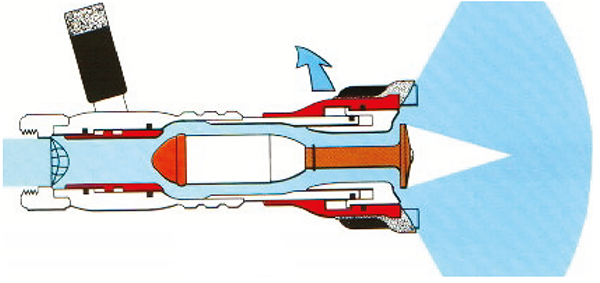
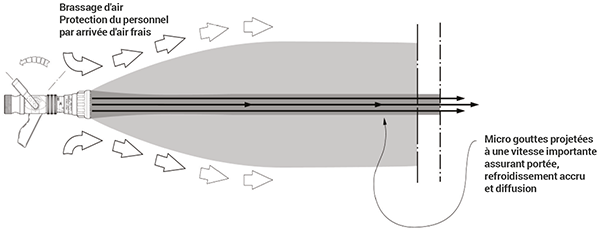
Il assure la protection optimale du binôme d'attaque, en cas de retour de flamme ou d'embrasement généralisé éclair.
Il peut être utilisé en cas de fort dégagement de chaleur, pour se rapprocher du foyer, protéger des biens, canaliser des vapeurs ou diluer des produits.
Lors de son utilisation, il produit des gouttelettes très fines.
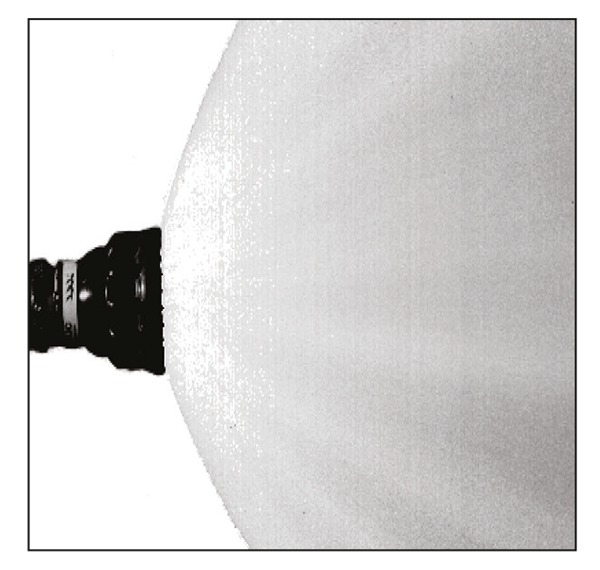
Il a pour but :
- d'évacuer les débris qui auraient pu passer à travers le filtre se trouvant à l'entrée de la lance ;
- de mettre la lance en oeuvre l'hiver contre les risques de gel ;
- de terminer l'extinction sur les foyers résiduels lors des déblais ;
- de refroidir un brûlé, sans aggraver le siège des lésion (eau sans pression).
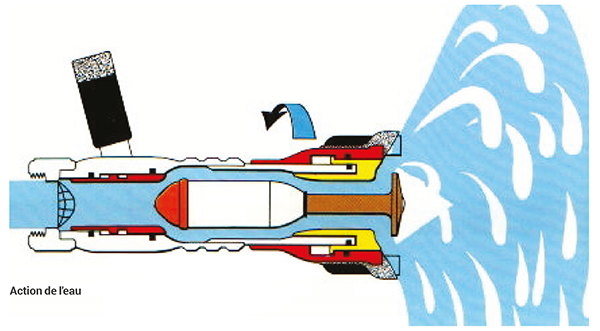
Dans certaines situations, las lances ne disposent que de pressions extrêmement basses :
Exemples :
- lances en haut d'une échelle ;
- réseau d'eau mal alimenté ;
- utilisation en IGH ou colonne sèche ;
- etc.
Le système double régulation de pression sur une lance automatique va permettre de remédier à ces problèmes d'alimentaion (efficacité limitée en débit et portée).
Portée lance DMRS sous 6 bar.
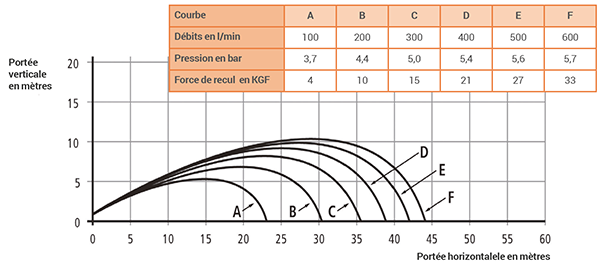
Portée lance DMRS sous 3 bar.
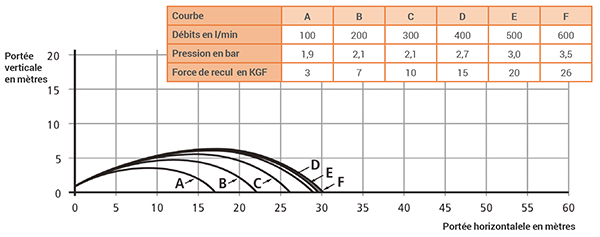
FM 17 LAN30
LANCE CANON PORTABLE PARTNER

| Famille : | Lances |
| Type : | Autres lances |
| Lance canon portable | |
| Fabriquant : | Leader |
| Débit maxi : | 2 000 l/min |
| Poids : | 10 kg environ |
| Pression médiane : | 7 bar |
| Pattes de stabilisations (pliantes) équipés de pointes au carbure de tungstène. | |
| Oscillation automatique avec réglage d'angle. | |
| Angle d'élévation réglable. | |
| Fermeture automatique en cas de glissement. | |
| Livrée avec collecteur d'alimentation 1x65/2x65 | |
| En option : | polymousse |
Extinction à l'air libre.
Le canon doit être installé (systématiquement avec les pattes dépliées) le plus à plat possible et ancré avec une sangle, choisir une surface où les pointes crocheront, s'assurer que le ou les tuyaux ne soulève(ent) pas le canon, au besoin, réduire le débit. Le canon ne doit pas rester sans surveillance. Ne pas déplacer le canon pendant le travail.
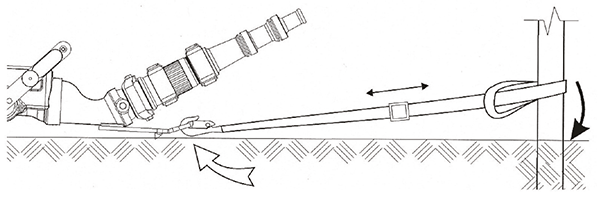
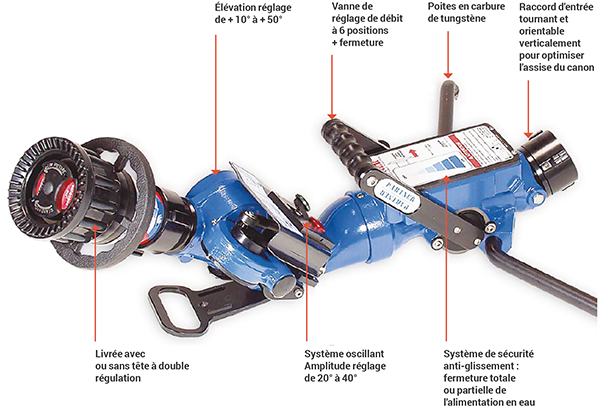
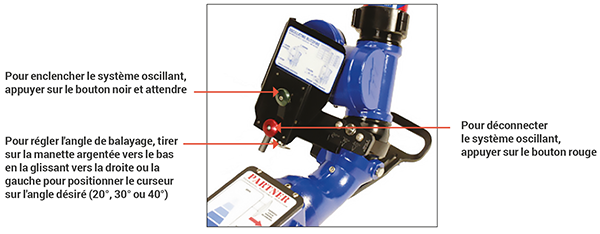
Vérifier régulièrement :
- la vanne de sécurité :
- à sec, ouvrir la poignée de réglage des débits et vérifier qu'elle ne se referme pas ;
- une fois ouverte, faire bouger le canon latéralement avec le pied pour vérifier que la sécurité fonctionne ;
- pour réinitialiser, placer la poignée en position fermée puis rouvrir ;
- l'état des pointes d'accroches.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 18 LAN06
LANCE CANON PORTABLE ET TRANSFORMABLE VECTOR

| Famille : | Lances |
| Type : | Autres lances |
| Lance canon portable | |
| Fabriquant : | Leader |
| Débit maxi : | 5 000 l/min |
| Poids : | 20 kg environ |
| Pression médiane : | 4,8 à 8,3 bar |
| Alimentation : | 1 ou 2 x 65 |
| Pattes de stabilisation (pliantes) équipées de pointes au carbure de tungstène. | |
| Angle d'élévation réglable. | |
| Fermeture automatique en cas de soulèvement. | |
| Adaptable sur véhicule. | |
| En option : | polymousse |
Extinction à l'air libre.
Le canon doit être installé (systématiquement avec les pattes dépliées) le plus à plat possible et ancré avec une sangle, choisir une surface où les pointes crocheront, s'assurer que le ou les tuyaux ne soulève(ent) pas le canon, au besoin, réduire le débit. Le canon ne doit pas rester sans surveillance. Ne pas déplacer le canon pendant le travail.
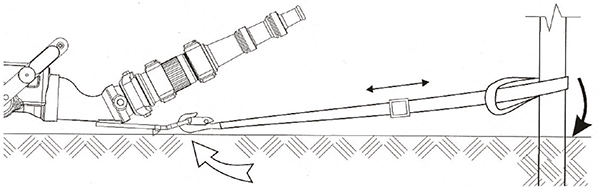
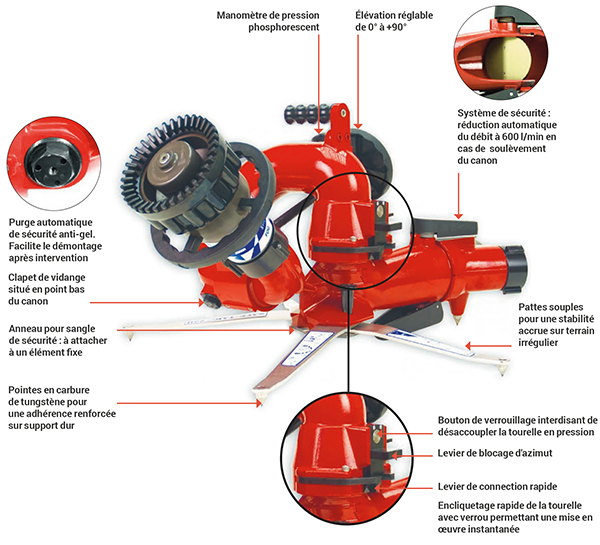
Vérifier régulièrement :
- le fonctionnement de la vanne de sécurité ;
- l'état des pointes d'accroches.
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 19 VEN01-1
VENTILATEUR THERMIQUE PETIT MODÈLE

| Famille : | Équipements ventilation |
| Type : | Ventilateurs |
| Ventilateur MT 236 de marque Leader | |
| Débit d'air : | 36 000 m3/h |
| Poids : | 38 kg |
| Cylindrée : | 6 CV |
| Carburant : | sans plomb autonomie 1 h 30 (capacité ≈ 3,6 l) |
| Huile : | type SAE 20W-50 (capacité ≈ 0,6 l) |
Ventilation par pression positive ou désenfumage des locaux (exutoire au minimum égal à l'ouvrant)
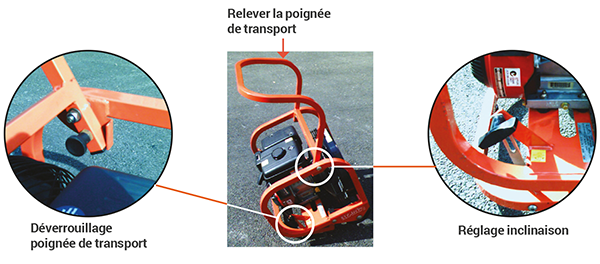
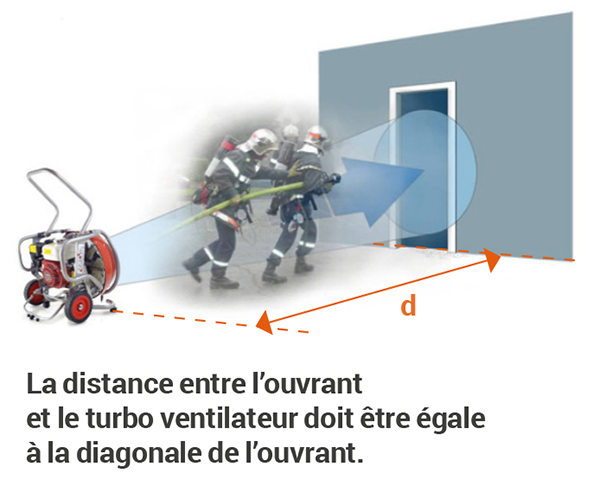
S'assurer que le ventilateur est dans une position stable, sur un sol non glissant et qu'il n'y a pas de débris entre le ventilateur et l'orifice d'entrée d'air.
Ne pas utiliser de cales pour augmenter l'inclinaison.

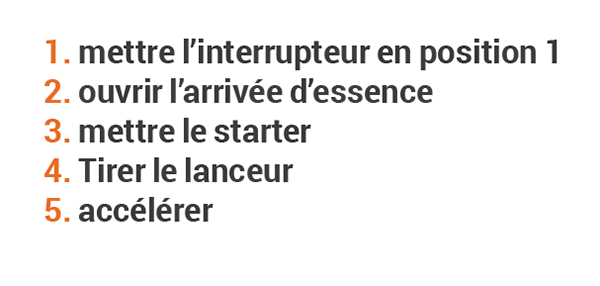
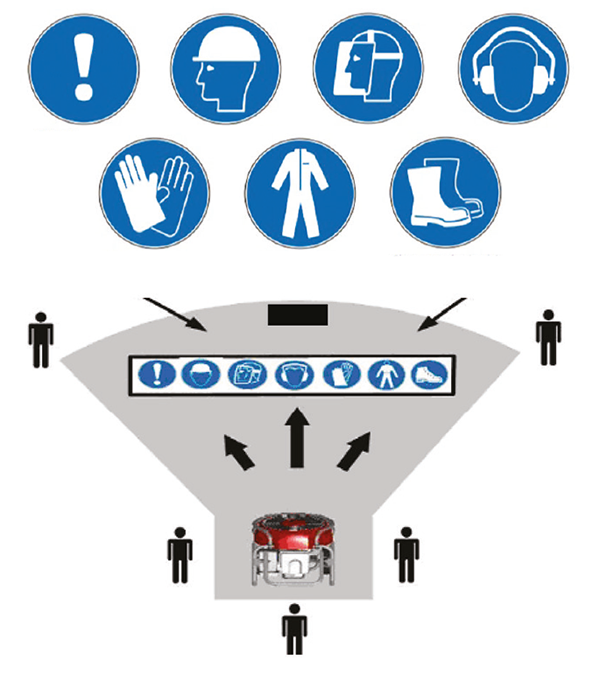
Nettoyer le ventilateur après chaque utilisation, refaire le niveau de carburant, vérifier l'état des pales, grille, enveloppe, patins, tubulures, poignées de réglage et déverouillage, etc.
En option : housse de protection et tuyau d'échappement.


 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 20 VEN01-2
VENTILATEUR THERMIQUE PETIT MODÈLE

| Famille : | Équipements ventilation |
| Type : | Ventilateurs |
| Ventilateur MT 236 «easy» de marque Leader | |
| Débit d'air : | 36 000 m3/h |
| Poids : | 38 kg |
| Cylindrée : | 6 CV |
| Carburant : | sans plomb autonomie 1 h 30 (capacité ≈ 3,6 l) |
| Huile : | type SAE 20W-50 (capacité ≈ 0,6 l) |
Ventilation par pression positive ou désenfumage des locaux (exutoire au minimum égal à l'ouvrant)
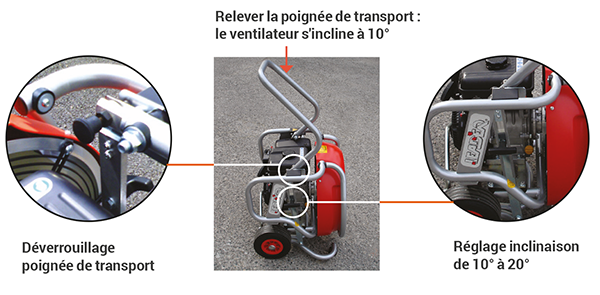
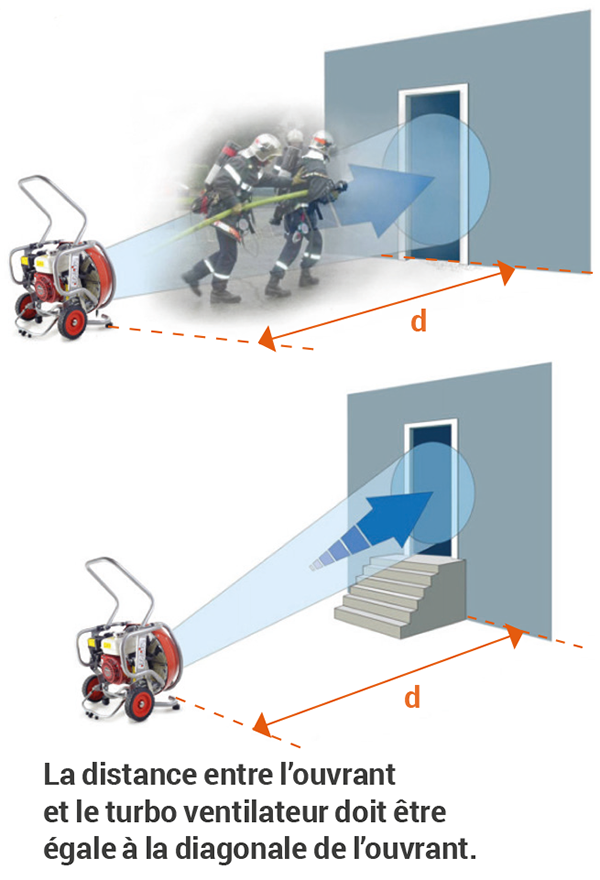
S'assurer que le ventilateur est dans une position stable, sur un sol non glissant et qu'il n'y a pas de débris entre le ventilateur et l'orifice d'entrée d'air.
Ne pas utiliser de cales pour augmenter l'inclinaison.

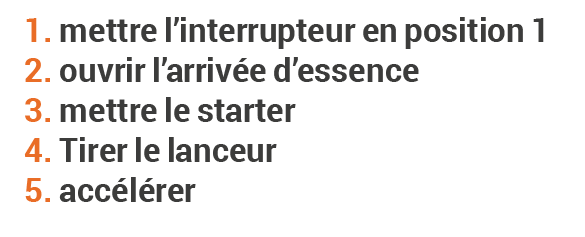
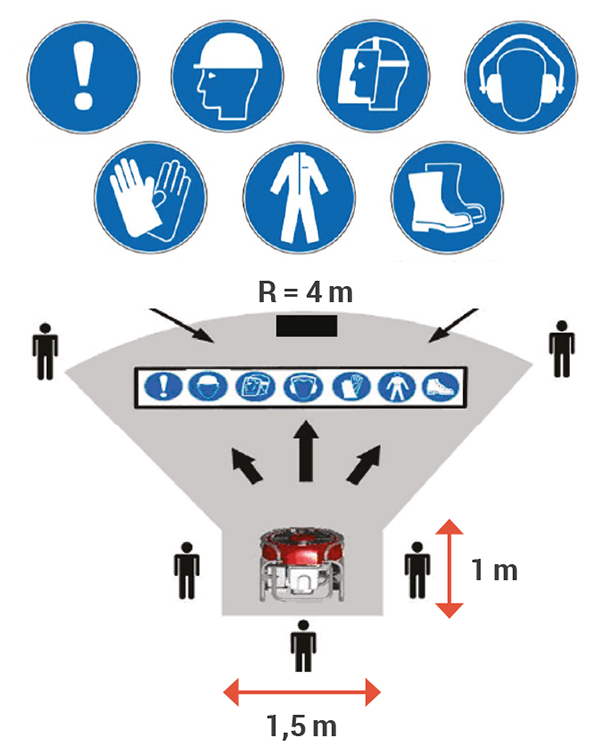
Nettoyer le ventilateur après chaque utilisation, refaire le niveau de carburant, vérifier l'état des pales, grille, enveloppe, patins, tubulures, poignées de réglage et déverouillage, etc.
Le ventilateur est livré avec sa housse de protection et un tuyau d'échappement.

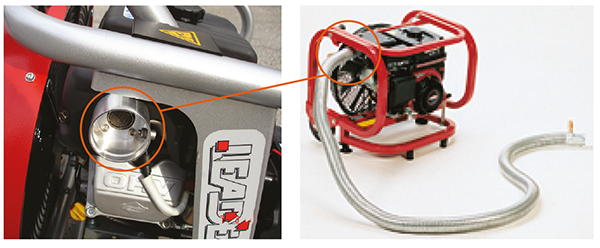
Possibilité d'adapter une béquille pour incliner vers le bas le turbo ventilateur (option).

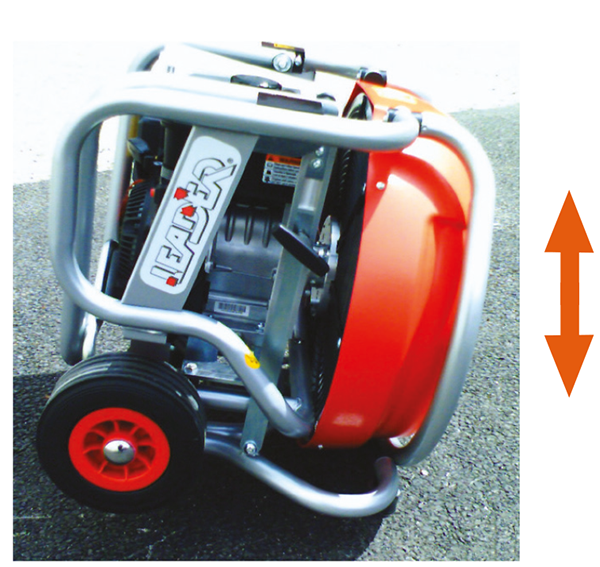
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.
FM 21 ECL30
VALISE ÉCLAIRAGE BABY 37°

| Famille : | Éclairage |
| Type : | Projecteurs et accessoires |
| Prix d'achat : | 900 € TTC (garantie 3 ans) |
| Date de mise en application : |
| Classement ATEX : | Non |
| Source lumineuse : | Led blanche 3 500 lumens utiles (équivalent halogène 600 W) |
| Puissance : | 30 W maximum |
| Alimentation : | Batterie rechargeable Lithium (LiFePO4) |
| Tête allumage : | 727 LEDs |
| Durée de vie de la tête : | > 50 000 h |
| Dimensions : | 280 mm x 245 mm x 13 mm |
| Poids : | 4,5 kg |
| Protection : | IP-65 |
| Durée maximum de charge : | 4 heures env. le chargeur est intégré dans la valise |
| Température de fonctionnement : | - 25° à + 45 °C |
| Température de stockage : | - 30° à + 50 °C |
| Pied orientable : | - 30° à + 90° |
| Puissance sélectionnée | 100 % (30 W) | 50 % (15 W) | 15 % (4,5 W) |
| Autonomie | > 3 h | > 8 h | > 24 h |
Éclairage de chantier, de zone.
Protection collective.
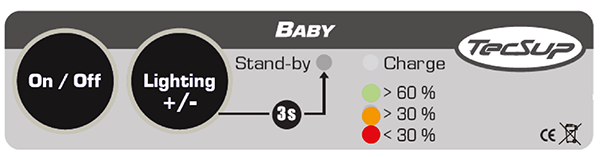
Commande l'allumage instantané, la puissance maximum est atteinte en moins de 3 secondes.
Commande la puissance de l'éclairage (E) et les différents modes. Le changement de mode se fait par des pressions sur le bouton
- mode 100 % soit 3 500 lumens pendant 3 h 30 puis bascule automatique à 50 %. L'utilisateur peut forcer en appuyant sur le bouton « lighting » pour rester à 100 %.
- mode 50 % soit 1750 lumens
- mode 15 % soit 525 lumens
- mode balise clignotante
- mode SOS en morse (signal lumineux clignotant)
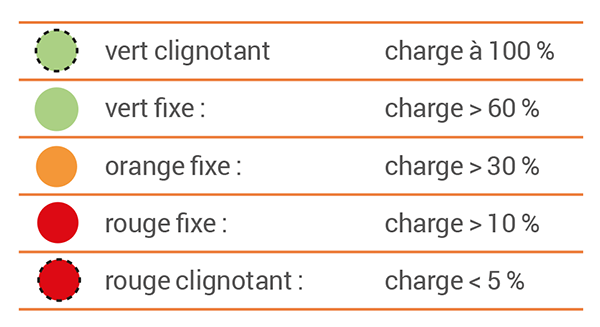
Le cordon d'alimentation se trouve à l'intérieur de la valise. La lampe peut fonctionner en étant branchée sur le secteur ou sur un groupe électrogène.
Ne pas utiliser la valise d'éclairage dans des lieux avec des risques d'explosion.
Ne jamais diriger le faisceau lumineux directement dans les yeux.
Mettre les bouchon d'obturation des deux contacteurs.
Nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et humide.
Nettoyage régulier de la vitre avec un détergent pour vitre mais surtout sans abrasif.
Vérifier le bon fonctionnement, l'absence de fissures sur le bloc et de la vitre, le déflecteur.
Ne pas démonter le bloc déflecteur ou ouvrir la batterie.
Pour optimiser la durée de vie des batteries, ne pas stocker le projecteur batterie déchargée.
Minimiser l'exposition du pack batterie à des températures élevées.
Code erreur (toutes les 2 secondes)
Pieces détachées et accessoires disponibles Cordon d'alimentation.
 |
1 clignotant rouge : | l'intérieur du Baby est trop chaud, la consigne d'éclairage est au maximum de 50 % |
  |
2 clignotants rouge : | la dalle Led est trop chaude (premier niveau) , la consigne d'éclairage est au maximum de 50 % |
   |
3 clignotants rouge : | la dalle Led est trop chaude (deuxième niveau) , la consigne d'éclairage est au maximum de 25 % (peut aller jusqu'à l'extinction complète) |
 Maintenance
Maintenance
En cas de doute sur l'utilisation ou l'état de ce matériel, en cas de choc... contacter les techniciens du groupement équipements :
- par mail : ge.maintenance.materiel@sdis38.fr
- ou par téléphone au 522 751.
En cas de demande de maintenance, il est nécessaire :
- de faire une demande dans MATHICES, onglet : « Matériel - demande de réparation ». On doit retrouver, avec le code-barres ou n° de série de l'objet, la nature du dysfonctionnement ou du problème rencontré… ;
- d'attendre (sauf urgence) que le service maintenance valide la demande ;
- de transmettre le matériel identifié à la plateforme logistique, avec tous ses accessoires accompagné du bon de restitution.